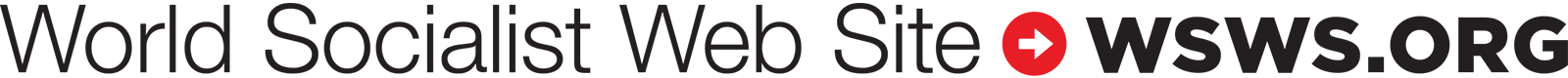Cette conférence fut présentée le 7 janvier 1998 à l'Université d'été sur le marxisme et les problèmes fondamentaux du 20e siècle, organisée par le Parti de l'égalité socialiste (Australie) à Sydney, du 3 au 10 janvier 1998.
Bill Van Auken fait partie de l'équipe de rédaction du World Socialist Web Site et est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les luttes des masses opprimées en Amérique latine, en Afrique du Sud, et au Moyen-Orient, tout au long de la période d'après-guerre.
La parution en français de cette analyse critique du castrisme est d'autant plus pertinente que de nouveaux dirigeants nationalistes, en particulier le président vénézuélien Hugo Chavez, sont chaudement applaudis aujourd'hui par toute la « gauche » petite-bourgeoise internationale. Celle-ci voit en Chavez et Cie — tout comme en Castro à une époque précédente — un substitut à la mobilisation politique indépendante de la classe ouvrière.
Le castrisme a été l’objet d'une confusion immense, due en grande partie à la tendance révisionniste pabliste qui est née au sein de la Quatrième Internationale. Les pablistes ont présenté — et certains continuent à présenter — le castrisme comme une nouvelle voie vers le socialisme et comme une confirmation qu’il est possible d’accomplir la révolution socialiste et de fonder un Etat ouvrier sans la participation consciente de la classe ouvrière.
Sous Joseph Hansen aux Etats-Unis et Ernest Mandel en Europe, les révisionnistes pablistes abandonnèrent la lutte visant à former une avant-garde révolutionnaire dans la classe ouvrière, cédant ainsi les tâches historiques du prolétariat, dans les pays économiquement arriérés, aux nationalistes petit-bourgeois.
En ce faisant, ils contribuèrent à préparer certaines des défaites les plus terribles subies par la classe ouvrière pendant la seconde moitié du 20e siècle.
Le Comité international de la Quatrième Internationale a mené une lutte implacable contre cette perspective, défendant et développant ainsi les armes théoriques et politiques forgées par le marxisme pendant toute la période précédente. Cette lutte impliquait les questions les plus essentielles concernant les tâches des marxistes.
Notre mouvement a lutté contre tous ceux qui considéraient le marxisme uniquement comme un moyen de découvrir, de décrire, et de s’adapter à des processus objectifs soi-disant inéluctables contraignant d’autres forces politiques que la classe ouvrière à diriger la lutte pour le socialisme. Il a défendu la perspective que l’unique voie vers le socialisme était de construire des partis révolutionnaires, basés sur le prolétariat international, dans une lutte implacable contre les bureaucraties dominantes et les directions petites-bourgeoises, aussi puissantes et populaires qu’elles puissent paraître.
En parlant du castrisme 35 ans plus tard, nous sommes en droit de demander qui a eu raison dans ce conflit. Le castrisme a-t-il percé une nouvelle voie vers le socialisme ou bien s’est-il révélé être une impasse et un piège pour la classe ouvrière ? Quelles ont été les conséquences de la renonciation par les pablistes du rôle de la classe ouvrière et de son avant-garde révolutionnaire consciente ? Dans cette conférence, nous saisirons l'occasion de réexaminer cette expérience stratégique et ses enseignements pour le mouvement ouvrier.
Le culte du Che
Il convient de commencer notre analyse avec les commémorations récentes du 30e anniversaire de l'exécution d'Ernesto « Che » Guevara, propagandiste et praticien le plus proéminent de la perspective de lutte de guérilla à laquelle on identifie le castrisme. Nous avons assisté récemment à un regain d'intérêt en la personne du Che, d'un genre auquel le guérillero, né en Argentine, ne se serait jamais attendu, même dans ses pires cauchemars.
Le Che a fait l'objet d'une commercialisation qui jure avec sa réputation de radical. On a fait de son image même une marchandise. Le fabricant de montres suisse, Swatch, a créé un modèle « révolution » arborant le visage du guérillero. Son visage a même servi pour des publicités de ski, pour décorer des CDs de musique rock, et même pour vendre de la bière.
En Argentine, le gouvernement de Carlos Menem, favori de Washington pour son adhésion aux règles du Fonds monétaire international (FMI) et pour son soutien enthousiaste à la guerre de 1991 contre l'Irak, a même fait sortir un timbre commémoratif célébrant le Che comme un « grand Argentin »
Le régime castriste s'y est mis, aussi. Il a récemment rapatrié la dépouille de Guevara depuis la Bolivie pour l'enterrer en grande pompe à Cuba. Le gouvernement cubain organise des circuits touristiques sur le thème du Che pour des gauchistes nostalgiques étrangers et vend des T-shirts et des bibelots « Che », offrant ainsi une nouvelle source de devises étrangères pour l'économie cubaine en détresse.
Pourquoi le Che est-il si facilement converti en icône inoffensive, et néanmoins profitable ? Les qualités citées par ses admirateurs sont bien connues — bravoure physique, abnégation, ascétisme, le fait qu’il soit mort pour une cause. Tous ces traits peuvent être dignes d’admiration. Il ne fait pas de doute que ces qualités présentent un contraste frappant avec l’éthique sociale dominante de notre temps, où la valeur d'une personne se détermine par la quantité de ses avoirs en bourse. Mais ces qualités, en elles-mêmes, n'indiquent en rien le caractère politique ou de classe de ceux qui les possèdent. Des sectes religieuses et même des mouvements fascistes peuvent prétendre avoir produit des martyrs ayant des qualités semblables, dans des luttes poursuivant des objectifs complètement réactionnaires.
Un examen critique de la carrière de Guevara montre que ses conceptions politiques n'avaient rien à voir avec le marxisme et que les panacées de la lutte armée et de la guerre de guérilla, auxquelles il était identifié, étaient fondamentalement hostiles à la lutte révolutionnaire socialiste de la classe ouvrière.
Au milieu du récent regain d'intérêt à l’égard de Guevara, plusieurs biographies du leader de guérilla ont été publiées. Celles de l'auteur mexicain Jorge Castaneda et de l'Américain John Lee Anderson, bien qu’elles proposent en aucune façon une analyse politique marxiste, fournissent néanmoins des précisions utiles sur la trajectoire de Guevara et de la révolution cubaine.
Ce qui ressort très clairement du récit détaillé de la carrière de Guevara dans ces livres est la superficialité sans bornes et les résultats tragiques de sa perspective politique.
Pendant qu’étaient publiés ces récits factuels, il y a eu une nouvelle tentative, de la part de diverses tendances petites-bourgeoises de gauche, de décrire Guevara comme un leader révolutionnaire et un théoricien dont l'exemple et les conceptions continuent à donner une perspective significative à la lutte contre le capitalisme. A la différence des biographes, ces groupes ne donnent pas de nouveaux aperçus ou de nouveaux détails. Ils mélangent une nostalgie malsaine pour l'âge d'or du gauchisme petit-bourgeois avec ce qui est indubitablement une falsification des véritables opinions de Guevara et de leurs conséquences politiques.
Certains, tel le Parti ouvrier socialiste (SWP) aux Etats-Unis, font écho, sans critique, aux commémorations officielles du gouvernement cubain. D'autres, tels le vieux vaurien pabliste Livio Maitan en Italie ou le MAS moreniste en Argentine, tentent de dépeindre Guevara comme ayant incarné une alternative révolutionnaire à la fois au stalinisme et au régime castriste lui-même.
Dans une analyse récente de la question cubaine, les morenistes font l'éloge du slogan guévariste d'« Un, deux, de nombreux Vietnam » et déclarent: « Même avec des méthodes désastreuses, les focos de guérilla, l’isolementvis-à-vis le mouvement de masse, l'opposition à la construction des partis révolutionnaires ouvriers, il exprimait la nécessité d'étendre la révolution à l'échelle internationale. »
Comment est-ce qu’une perspective nécessaire et révolutionnaire peut s’exprimer au moyen de méthodes désastreuses — cela les morenistes ne se donnent pas la peine de l’expliquer. Cette tendance, comme toutes les tendances pablistes, a fait carrière en tentant de démontrer comment différentes forces sociales — le péronisme, le stalinisme, la lutte de guérilla « sont l’expression » de la lutte pour le socialisme.
En effet, à une époque antérieure, les morenistes réussirent même à trouver cette expression dans le dictateur cubain que Castro avait renversé, Fulgencio Batista. Le proclamant « le Perón de Cuba », ils applaudirent les travailleurs cubains pour n’avoir pas suivi un appel à la grève générale émanant du mouvement du 26 juillet de Castro. Après la victoire de Castro, cependant, ils mirent son portrait à côté de celui du Général Perón sur l’entête de leur journal.
Nonobstant l’alchimie politique des morenistes, les méthodes désastreuses de Guevara étaient l’expression fidèle de sa perspective politique — ou pour être plus précis, de son manque de perspective réelle.
Les morenistes, comme toutes les autres tendances pablistes, n’ont aucune envie de soumettre le castrisme et le guévarisme à une analyse de classe, de rechercher leurs origines et leur développement historiques, ou de faire un bilan de l’expérience de l’Amérique latine avec la lutte de guérilla de ces presque quatre dernières décennies.
Cette tâche critique ne peut être accomplie que par notre mouvement, basé sur la lutte qu’il a menée pendant toute cette période pour l’indépendance et l’unité internationale de la classe ouvrière.
Le socialisme prolétarien contre le nationalisme petit-bourgeois
Les révisionnistes pablistes, comme les ex-gauchistes petits-bourgeois en général, sont hostiles à une telle approche. Ils nourrissent les espoirs fervents d’un renouveau du castrisme. Ils ont tous été enthousiasmés par l’apparition de l’Armée de libération nationale au Chiapas, au Mexique, et ont aussi applaudi les actions du Mouvement révolutionnaire de Tupac Amaru quand ils ont occupé l’ambassade japonaise à Lima, il y a un peu plus d’un an.
Notre mouvement ne s’est pas joint aux célébrations de cette apparence de renouveau du guevarisme et de la formule politique creuse de la « lutte armée ». Nous avons une longue histoire de luttes contre de telles conceptions, ayant reconnu qu’elles expriment non pas les luttes socialistes et révolutionnaires du prolétariat, mais plutôt la politique nationaliste de la petite bourgeoisie. Elles ne tentent pas de résoudre les questions brûlantes de l’orientation révolutionnaire de l’avant-garde ouvrière, mais plutôt de nier en bloc le rôle révolutionnaire de cette classe et ainsi de leurrer des couches estudiantines radicalisées, ainsi que des travailleurs et des paysans, et de les écarter de la lutte pour le socialisme.
Elles obscurcissent, plutôt qu’elles n’éclairent, les problèmes stratégiques de la révolution socialiste élaborés par Trotsky dans sa théorie de la révolution permanente. Des slogans tels que « le devoir du révolutionnaire est de faire la révolution », « la lutte armée », et « la guerre populaire prolongée » laissent sans réponse la question de savoir quelle classe jouera le rôle dirigeant dans la révolution, quel sera le rapport entre la révolution dans un seul pays et la révolution mondiale, et quelles relations s’établiront entre la lutte des travailleurs et des masses opprimées des pays économiquement arriérés et celle des travailleurs des pays capitalistes avancés.
Derrière leurs discours radicaux, ces mouvements ont des conceptions bien définies sur ces questions. Invariablement, elles tendent vers la suppression de la lutte indépendante et révolutionnaire du prolétariat, et la subordination des masses opprimées en bloc aux besoins de la bourgeoisie nationale.
Dans ce sens, malgré le radicalisme de surface de pareils mouvements, ils sont, en dernière analyse, parmi les dernières défenses de l’impérialisme contre la révolution socialiste. C’est ce caractère essentiel du nationalisme petit-bourgeois et de la lutte de guérilla qui permet d’entrevoir une réponse à la question de savoir comment le capitalisme a pu apprivoiser l’image de Guevara à ses fins propres.
Si l’on examine attentivement la politique du MRTA péruvien et des zapatistes mexicains, ce n’est qu’une manifestation différente de l’accommodement avec l’impérialisme tenté par tous les régimes et les mouvements nationalistes bourgeois. Le groupe armé Tupac Amaru a occupé l’ambassade japonaise dans le but de faire pression sur l’impérialisme japonais et de le contraindre à influencer et adoucir la politique du régime Fujimori. Le but final du groupe, communiqué à certains des otages, était de forcer la négociation d’un accord par lequel le groupe se transformerait en parti politique petit-bourgeois légal.
Quant au mouvement zapatiste, il a été universellement acclaméprécisément parce qu'il avait renoncé, dès le départ, à tout objectif révolutionnaire. Les vagues revendications du Subcomandante Marcos étaient pour la démocratisation, pour mettre fin à la corruption, et pour davantage de droits culturels pour la population indigène. Ces revendications auraient pu être et ont été adoptées non seulement par la gauche petite-bourgeoise, mais aussi par le PRI au pouvoir et même par le parti d'opposition de droite, le PAN. Marcos et les zapatistes, plutôt que d'offrir une perspective révolutionnaire aux travailleurs et aux paysans opprimés du Mexique, sont devenus un instrument de plus pour les règlements de compte à l'intérieur de la bourgeoisie mexicaine.
Le rôle politique de la petite bourgeoisie
Que voulons-nous dire exactement quand nous décrivons ces différents mouvements comme étant « nationalistes petits-bourgeois » ? Ce n'est pas simplement une épithète dont les marxistes accablent leurs opposants politiques. C'est une définition scientifique des intérêts de classe et des méthodes qui caractérisent ces mouvements. Marx, en se basant sur l'expérience de la révolution de 1848, et Trotsky, dans sa théorie de la révolution permanente, ont démontré que la petite bourgeoisie est incapable d’une action indépendante et cohérente. Ses oscillations reflètent sa position sociale intermédiaire. Prise entre les deux principales classes sociales et se divisant constamment entre exploiteurs et exploités, elle doit suivre l’une ou l’autre de ces classes – soit la bourgeoisie soit le prolétariat.
Dans la période d’après-guerre, l’impérialisme a créé et fini par dépendre d’une nouvelle couche sociale désignée par « classe moyenne ». Dans les pays capitalistes avancés, il s’agissait des fonctionnaires qui peuplaient les bureaucraties gouvernementales et les bureaux des grandes sociétés, administraient les services sociaux des États-providence nouvellement établis, et dirigeaient les médias de masse.
Une strate analogue est apparue dans les pays opprimés, et c’est entre les mains de cette couche sociale que l’impérialisme a remis le pouvoir pendant la période de la décolonisation. En Amérique latine, comme dans d’autres régions du globe, opprimées par l’impérialisme, les occasions qui se présentaient à cette couche sociale étaient beaucoup plus limitées que celles offertes à leurs homologues dans les pays capitalistes avancés. Des milliers d’étudiants sortaient des universités sans l’espoir de faire carrière dans une profession libérale. Dans beaucoup de cas, ceux qui avaient une profession libérale ou qui essayaient de gagner leur vie à la tête d’une petite entreprise ne vivaient guère mieux que le travailleur moyen. C’est cette strate sociale qui formait la principale base sociale de la politique nationaliste petite-bourgeoise.
Il y avait donc une base objective de classe pour l’émergence des théories pablistes d’une « nouvelle réalité mondiale », selon lesquelles la lutte pour le socialisme serait menée, non pas par la classe ouvrière et son avant-garde consciente et révolutionnaire, mais plutôt par la petite bourgeoisie radicalisée. Ces formulations révisionnistes reflétaient en dernière analyse à la fois les impulsions de cette couche sociale, et aussi le besoin ressenti par l’impérialisme d’un tampon qui le protègerait de la menace de révolution prolétaire.
Les origines de la révolution cubaine
Comme tout évènement majeur, la révolution dirigée par Fidel Castro en 1959 avait des racines profondes dans des développements historiques antérieurs. Ces racines historiques, généralement laissées de côté par les fans de Castro parmi les pablistes et la gauche petite-bourgeoise en général, doivent être étudiées pour comprendre le contenu de classe et l’importance politique du castrisme.
L’histoire de Cuba fut marquée principalement par le caractère avorté de la lutte pour son indépendance, qui enleva l’île aux possessions coloniales du colonialisme espagnol moribond, pour ensuite la laisser au niveau d’une quasi-colonie politique et économique des Etats-Unis.
Les Etats-Unis intervinrent à Cuba en 1898 au terme d’une guerre d’indépendance qui dura 30 ans. L’intervention fut courte et décisive. Les Espagnols perdirent leur colonie dans le Traité de Paris, une négociation à laquelle les Cubains eux-mêmes ne participèrent pas.
Ce processus aboutit à la fondation de la République cubaine, dite de l'Amendement de Platt. Ce texte, qui portait le nom du sénateur américain qui l'avait écrit, fut imposé comme amendement à la première constitution cubaine. Il interdisait à la république cubaine prétendument indépendante tout traité international qui porterait préjudice aux intérêts américains. Il donnait aussi aux Etats-Unis le droit d'intervenir par la force armée « pour la préservation de l'indépendance cubaine, l'entretien d'un gouvernement capable de protéger la vie, la propriété, et les libertés individuelles, et pour répondre à ses obligations envers Cuba imposées par le Traité de Paris ». Les Etats-Unis allaient à maintes reprises faire usage de ce « droit » pendant la première moitié du vingtième siècle.
La dépendance de Cuba vis-à-vis de l'impérialisme américain n'était pas seulement une dépendance formelle imposée par l'amendement de Platt. Elle se basait sur l'exportation cubaine de sucre vers le marché américain. Ce seul produit fournissait la grande majorité des revenus d'exportation de l'île et était presque uniquement destiné aux Etats-Unis. La monoculture du sucre condamnait la majorité de la population à l’arriération, à la pauvreté, et au chômage chronique.
Les relations sociales et politiques prédominantes à Cuba étaient liées au caractère inachevé de la lutte démocratique bourgeoise pour l'indépendance nationale. Si le statut quasi-colonial de Cuba était parmi les plus crûment évidents au monde, il était loin d'être unique.
La Quatrième Internationale devait lancer cette mise en garde, à la veille de la Deuxième guerre mondiale, « Les Etats nationaux attardés ne peuvent plus compter sur un développement démocratique indépendant. Cerné par un capitalisme décadent et empêtré dans les contradictions impérialistes, l’Etat attardé n'aura qu'une indépendance quasi-fictive et son régime politique, sous l’influence des contradictions internes de classe et les pressions externes, ne manquera pas de s’incliner vers la dictature contre le peuple. »
Un autre déclaration, de la même année, soulignait qu'il n'y avait aucune possibilité de mettre fin à l'oppression impérialiste sinon par la révolution socialiste mondiale: « Les espoirs de libération des peuples coloniaux sont donc liés de façon encore plus étroite qu'avant à l'émancipation des travailleurs du monde entier. Les colonies ne seront libérées politiquement, économiquement, et culturellement que lorsque les travailleurs des pays capitalistes avancés mettront fin au régime capitaliste et commenceront, avec les peuples économiquement arriérés, à réorganiser l'économie mondiale sur une nouvelle échelle, basée sur les besoins sociaux et non pas les profits des monopoles. »
Comme nous le verrons, l'histoire cubaine a démontré la validité de cette thèse, bien que négativement. Sans une telle lutte unitaire et internationale des travailleurs, la véritable libération économique, politique, et culturelle s'est avérée impossible.
Les relations américano-cubaines avaient créé un establishment politique bourgeois remarquable par son impuissance, sa corruption extrême, et ses éruptions fréquentes de violence. La domination américaine de l'économie, jointe à la prédominance des immigrés dans les milieux bourgeois et des propriétaires terriens, donna également naissance à un nationalisme cubain empreint d'un anti-américanisme extrême et même de tendances xénophobes.
Une autre perspective se dégagea, cependant. En 1925 le Parti communiste cubain se forma et intégra la Troisième Internationale. Son personnage le plus éminent était Julio Antonio Mella, un étudiant en droit qui était devenu le leader d'un mouvement de réforme universitaire au début des années 1920 et qui avait essayé d'orienter les étudiants vers la classe ouvrière.
Mella et ses camarades dirigèrent la lutte contre la dictature de Gerardo Machado, que Mella décrivait comme « un Mussolini tropical ». Emprisonné par la dictature, les pressions populaires le libérèrent et il quitta le pays, et voyagea en Union soviétique, en Europe, et finalement au Mexique.
Mella rompit avec le Parti communiste au Mexique en 1929, et déclara son soutien à la lutte de Trotsky contre la bureaucratie stalinienne. Peu de temps après, il fut assassiné.
Mella faisait partie d'un large mouvement d'étudiants et d'intellectuels cubains qui voulaient mettre fin au système politique corrompu du pays et à sa domination par l'impérialisme américain. Mais il renonça aux conceptions nationalistes qui prédominaient alors et adopta la perspective de l'internationalisme socialiste.
Le stalinisme allait empêcher la classe ouvrière d'arriver à une résolution des problèmes historiques de Cuba basée sur cette perspective. On peut donc dire que le stalinisme avait préparé l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro longtemps avant que ce dernier et le Parti communiste cubain aient jamais considéré la possibilité de joindre leurs forces. En supprimant la perspective pour laquelle Mella et la première génération de marxistes cubains avaient lutté, le stalinisme favorisa le développement du nationalisme petit-bourgeois gauchiste.
Dans la première conférence de cette université d’été, David North a longuement discuté le fait que l'histoire ne consiste pas seulement en des réponses aux questions « que s'est-il passé ? » et « qui a gagné ? » mais qu’il s’agit plutôt de savoir quelles étaient les alternatives existantes et quelles furent les conséquences des alternatives choisies et de celles qui ne le furent pas. Que se serait-il passé si l'Opposition de gauche avait prédominé? On peut poser la même question en relation à la question cubaine, bien qu'à une plus petite échelle.
Il y a des limites, bien sûr, à ce que l'on peut dire avec assurance sur « ce qui aurait pu se passer ». On ne peut pas affirmer avec certitude, par exemple, que s’il y avait eu un authentique Parti communiste à Cuba, une révolution socialiste se serait produite en telle ou telle année. Cependant, on peut dire avec certitude que si un véritable parti révolutionnaire de la classe ouvrière avait existé, à la différence de l'appareil politique corrompu du stalinisme cubain, l'émergence de la tendance spécifique nommée castrisme aurait été impossible.
A la suite de la dégénérescence stalinienne du Parti communiste cubain, le pays passa par une crise révolutionnaire profonde. Une insurrection nationale se produisit en 1933, forçant le dictateur Machado à fuir le pays. Le point culminant de ce mouvement fut une grève générale de la classe ouvrière qui s’empara des usines, des raffineries de sucres, et des plantations.
Alors que la grève générale gagnait en intensité et s’étendait dans le pays, le Parti communiste stalinien cubain (PC), qui dominait les syndicats, donna l'ordre de reprendre le travail, prétextant que la grève faisait peser la menace d'une intervention américaine. Alors que la vaste majorité des travailleurs refusait de tenir compte de cet appel, le PC entama des pourparlers secrets avec le dictateur Machado, obtenant des concessions pour le parti en échange de son attitude « responsable » pour chercher à mettre fin à la grève.
Ce pacte, dont la courte durée n'est imputable qu'au fait que l'insurrection força Machado à s'exiler, allait servir de modèle pour le PC pendant les 25 prochaines années. Les staliniens conservèrent leur domination du mouvement ouvrier, tout en forgeant une série d'alliances avec des partis conservateurs bourgeois et même des régimes militaires. Dans les années 1940, les staliniens entrèrent au gouvernement de « l'homme fort » désigné par les Etats-Unis, Batista.
Castro et le castrisme
Le stalinisme étant méprisé pour sa collaboration avec les partis de droite et les dictatures, la rhétorique de l'anti-impérialisme et de la révolution sociale devint de plus en plus le monopole de nationalistes radicalisés des classes moyennes, notamment parmi les étudiants de l'Université de La Havane. C'est dans cet environnement de serre chaude que Fidel Castro commença sa carrière politique.
Fils d'une famille de propriétaires terriens espagnols, Castro fit ses premiers pas en politique comme étudiant dans un lycée jésuite. Il s'y trouva sous l'influence de prêtres espagnols qui soutenaient le fascisme de Franco. Il lut tous les ouvrages de José Antonio Primo de Rivera, le fondateur de la Phalange fasciste espagnole et était, selon ses camarades, fortement attiré par l'idéologie fasciste.
A la fin des années 1940 et début 1950, Castro participa aux activités des gangs armés d'étudiants qui dominaient l'université. L'idéologie de ces gangs était à la fois nationaliste et explicitement anti-communiste.
Castro commença à lutter contre Batista comme membre du Parti Ortodoxo bourgeois. Il se présenta comme candidat à la législature cubaine en 1952, mais le coup d’état de Batista cette année-là barra le chemin à ses ambitions parlementaires. Il commença alors à organiser un petit groupe de fidèles pour une action armée. Il mena un assaut sur les casernes à Moncada en juillet 1953. Les 200 participants furent tous tués ou emprisonnés.
Castro était loin d'être le seul à organiser de telles actions. Tout au long de cette période, des membres de différents partis et de différentes factions petites-bourgeoises attaquèrent des casernes, tentèrent des assassinats, et même occupèrent le palais de Batista. Il n'y a rien dans les déclarations politiques de Castro pendant cette période avant la révolution de 1959 qui le sépare du nationalisme cubain anti-Batista le plus ordinaire. Son discours le plus célèbre, « L'histoire m'absoudra », préparé pour sa défense au procès sur l'assaut de Moncada, consiste en dénonciations de la répression de la dictature et en une liste de réformes démocratiques assez modérées.
Après un court séjour en prison, Castro partit au Mexique d'où, à la fin de 1956, il organisa le débarquement à Cuba de quelque 80 hommes. Comme à Moncada, l'opération fut une catastrophe - à peine une douzaine d'hommes survécurent aux premiers heurts avec les forces répressives de Batista. Cependant, deux ans à peine plus tard Castro devait prendre le pouvoir.
Le pouvoir tomba littéralement aux mains des guérilleros de Castro parce qu'il n'existait aucune autre force politique crédible sur l'île.
Ce vide politique était le fait, avant tout, de l'absence de toute avant-garde révolutionnaire de la classe ouvrière cubaine. Malgré les limitations du réformisme castriste, sa politique sociale était bien plus avancée que celle prônée par les staliniens. De plus, ses actions armées, malgré leurs maigres succès, lui assuraient un large soutien populaire, alors que les staliniens cubains étaient perçus comme étant des complices de la dictature.
Les premières intentions de Castro étaient d'arriver à un arrangement avec les Etats-Unis. Lors de son premier voyage aux Etats-Unis, quatre mois après son arrivée au pouvoir, Castro déclara: « J'ai déclaré de manière claire et définitive que nous ne sommes pas des communistes. La porte est ouverte aux investissements privés qui contribuent au développement de l'industrie à Cuba. Il nous est absolument impossible de progresser si nous ne parvenons pas à nous entendre avec les Etats-Unis. »
Le mouvement de Castro, cependant, s'était engagé à faire une réforme agraire limitée ainsi qu’à certaines mesures sociales visant à aider le peuple cubain. Dans ses premiers mois, il avait décrété la redistribution des terres en friche, une réduction des loyers, des augmentations de salaire, et diverses mesures généralisant l'accès à l'éducation et aux soins médicaux.
Washington ne voulait rien entendre.
Les Etats-Unis tentèrent de discipliner Castro par la pression économique pure et simple. Dans un conflit en spirale avec le régime cubain, les Etats-Unis stoppèrent leurs importations de sucre cubain - la principale source de revenus du pays - puis refusèrent de lui vendre du pétrole.
Le régime cubain riposta par des nationalisations, d’abord de la propriété américaine, ensuite des entreprises cubaines, et en se tournant vers la bureaucratie soviétique pour avoir de l’aide.
La politique extérieure américaine était rigidement idéologique et revancharde. La Grande-Bretagne avait réagi à de telles situations très différemment – les leaders africains tels Nkrumah, Kuanda, et Kenyatta étaient courtisés malgré leurs discours radicaux et même « socialistes », préservant ainsi l’influence et les intérêts de l’impérialisme britannique dans la région.
Ironiquement, l’arrogance et la stupidité américaines furent parmi les piliers centraux du régime castriste de ces 40 dernières années. Elles lui ont permis de se présenter comme l'incarnation du nationalisme cubain et de dénoncer toute opposition comme étant un outil de l'impérialisme yankee.
En se tournant vers Moscou, Castro forgea une alliance avec les staliniens cubains. Les pablistes, et la gauche petite-bourgeoise en général, applaudirent ce geste comme une indication de plus de la radicalisation de la révolution et de son caractère socialiste. Il n’en n’était rien. Comme nous l'avons vu, le Parti Socialiste Populaire (PSP) --le nom du parti stalinien cubain à l'époque--était une force politique complètement réactionnaire et discréditée. Il représentait une partie de l'establishment politique bourgeois à Cuba, ayant fidèlement servi même le régime de Batista.
Se trouvant inopinément catapulté au pouvoir, Castro se tourna par nécessité vers le PSP. Il n’avait ni parti, ni programme, ni une vraie armée. Les staliniens cubains lui fournirent un appareil et une idéologie par desquels il pouvait régner.
Castro réinterpréterait par la suite son propre passé politique, déclarant qu’il était devenu « marxiste-léniniste » longtemps avant le coup d’état de Batista, mais « pas exactement » un communiste. Toutes ses aventures politiques - depuis son temps avec les gangs anti-communistes à l’Université de La Havane jusqu’à sa campagne électorale comme candidat d’un parti bourgeois - furent expliquées comme de simples initiatives tactiques visant à préparer les conditions pour une révolution socialiste.
Que trouvait Castro—tout comme les autres nationalistes bourgeois de gauche--dans le « marxisme-léninisme? » Il est clair qu’ils ne cherchaient pas une perspective scientifique pour guider la lutte des travailleurs pour leur propre émancipation sociale et politique. Mais c’était en même temps bien plus qu’un simple prétexte pour obtenir le soutien de Moscou.
Ils comprenaient le marxisme-léninisme qu’ils apprenaient des staliniens comme une politique promouvant l’utilisation de l’Etat pour effectuer des changements voulus à l’ordre social. Ils y voyaient aussi la justification de leur propre contrôle illimité sur l’Etat, dirigé par un « parti révolutionnaire » omnipotent couronné par un leader national infaillible et irremplaçable. Il faut rappeler que Chiang Kai Shek avait aussi pris les staliniens comme modèle pour le régime interne de son parti, le Kuomintang.
Le mythe de la guérilla
Comme presque tous les régimes et tendances nationalistes qui sont nés pendant l’après-guerre, le castrisme reposait sur une série de mythes concernant ses origines et son développement. Le besoin de mythes leur est incontournable, du fait qu’ils reposent sur la petite bourgeoisie ou la bourgeoisie nationale, tout en prétendant représenter les intérêts des masses opprimées.
Après leur arrivée au pouvoir, Castro et ses fidèles dépeignirent leur victoire comme le résultat exclusivement de la lutte armée menée par les guérilleros des montagnes de la Sierra Maestra: une victoire militaire contre l’impérialisme et la bourgeoisie locale remportée par une petite force grâce à la volonté et à la détermination. A peine un mois après le renversement de Batista, Che Guevara écrivait:
« Nous avons démontré qu’un petit groupe d’hommes déterminés, qui ont le soutien du peuple, et qui ne craignent pas la mort [...] peuvent venir à bout d’une armée régulière. [...] Il y a une autre leçon pour nos frères en Amérique [latine], qui sont économiquement dans la même catégorie agraire que nous, qui est que nous devons faire des révolutions agraires, lutter dans les champs, et de là conduire la révolution aux villes, et non pas la faire dans ces dernières. »
Cette conception, qui devint l’explication officielle de la révolution cubaine, était une déformation radicale des faits. Au cours des six années pendant lesquelles Batista était au pouvoir, 20,000 Cubains furent tués par le régime. Parmi ceux-là, 19,000 furent tués dans les villes. Des actes de sabotage, des grèves politiques, et d’autres formes de résistance, la plupart hors du contrôle du mouvement castriste du 26 juillet, étaient largement répandus et donnèrent l’impulsion principale à la chute du régime.
Les guérilleros castristes étaient, au plus, de quelques milliers d’hommes. Il n’y eut aucune bataille militaire concluante et la bataille la plus grande ne vit combattre, au plus, que 200 guérilleros. Batista perdit le soutien à la fois de la bourgeoisie cubaine—dont une bonne partie soutenait Castro--et de Washington, qui imposa un embargo d’armes sur son régime. Privé de ce soutien, le régime se désintégra rapidement.
A l’intérieur de Cuba, ce mythe de la défaite de l’impérialisme américain et des classes dirigeantes nationales par les guérilleros castristes, du fait uniquement de leur audace et de leur prouesse militaire, servait un objectif politique bien défini. Il justifiait la consolidation d’un régime qui plaçait tout le pouvoir de l’Etat incontestablement entre les mains de Castro lui-même.
Le mythe développé par Castro et Guevara serait exporté, avec des résultats désastreux. La soi-disant « voie cubaine » était présentée à travers l’Amérique latine comme la seule forme possible de lutte révolutionnaire. Des milliers de jeunes en Amérique latine allèrent à leur mort après avoir reçu la promesse que tout ce qu’il fallait pour renverser des gouvernements et mettre fin à l’oppression sociale était du courage et quelques armes.
L’écrit le plus célèbre de Guevara, « Guerra de Guerrillas » (guerre de guérilla) était le manuel d’usage de cette stratégie condamnée d’avance. Il résumait ce que Guevara décrivait comme les trois grandes leçons de l’expérience cubaine pour la « mécanique des mouvements révolutionnaires en Amérique: »
1) Les forces populaires peuvent gagner une guerre contre l’armée.
2) Il n’est pas nécessaire que toutes les conditions soient réunies pour faire une révolution ; le foco insurrectionel [l’unité de guérilla] peut les créer.
3) Dans les Amériques sous-développées, le terrain de la lutte armée doit principalement être les zones rurales.
Ce qu’il y avait d’analyse politique dans ces écrits était radicalement faux. La voie du développement en Amérique latine était depuis longtemps capitaliste. La fondation essentielle de l’oppression en Amérique latine n’était pas, comme disait Guevara, les latifundia--c’est-à-dire la concentration des terres aux mains d’un petit nombre de propriétaires--mais des relations capitalistes de travail salarié et de profit. Alors même que Guevara écrivait ces lignes, le continent subissait de plein fouet d’importants changements structurels qui prolétarisaient encore plus la population et avaient pour conséquence une migration massive des zones rurales vers les villes.
Rien de ceci n’était analysé. La préparation révolutionnaire était limitée à un processus impressionniste de choix d’une région rurale bien adaptée à une guerre de guérilla. Ceux qui suivirent cette perspective se virent terrés dans des jungles et des arrière-pays, condamnés à des combats au corps à corps avec les armées latino-américaines.
Ce qui ressort constamment dans la politique de Guevara est le rejet de la classe ouvrière comme classe révolutionnaire et le mépris pour la capacité des travailleurs et des masses opprimées de devenir politiquement conscients et de lutter pour leur propre libération.
En proposant la campagne comme seule arène possible à la lutte armée, il ne s’agissait pas de mobiliser les paysans autour de revendications sociales. Au contraire, la conception de Guevara était d’utiliser la violence pour « obliger la dictature à utiliser la violence, démasquant ainsi sa véritable nature comme dictature des classes sociales réactionnaires. » C’est-à-dire que le but des unités de guérilleros était de provoquer la répression contre les paysans, qui étaient supposés répondre en soutenant la lutte contre le gouvernement.
Pour une telle lutte, on n’avait besoin ni de théorie ni de politique, et encore moins d’intervenir activement dans les luttes des travailleurs et des masses opprimées. En préparant la construction de groupes de guérilleros à travers l’Amérique latine, Guevara insista sur l’exclusion de toute controverse ou discussion politiques. L’unité devait se baser seulement sur l’assentiment à la tactique de la « lutte armée ».
Le désastre du Guévarisme
Les résultats furent, comme on pouvait le prévoir, désastreux. Guevara mit en place ses premiers groupes de guérilleros dans son Argentine natale, sous la direction du journaliste Jorge Masetti. Dans sa biographie de Guevara, Anderson donne des détails particulièrement terrifiants de ce désastre. Les guérilleros ne virent jamais le combat. Certains se perdirent et seraient apparemment morts de faim dans la campagne; d’autres furent capturés par la police. Avant la décimation de son groupe, cependant, Masetti avait ordonné l’exécution de trois de ses membres pour de prétendues infractions à la discipline. L’auteur cite un des guérilleros ayant survécu, qui remarque que les trois hommes condamnés étaient tous juifs. Il se trouve que Masetti, avant de s’aligner sur le castrisme, avait été membre d’un groupe nationaliste d’extrême-droite et anti-sémite en Argentine.
Le groupe de Guevara en Bolivie connut une fin semblable. L’élément le plus remarquable de son activité était son indifférence envers la situation politique et sociale dans le pays. Les mineurs d’étain, la force la plus puissante de la révolution bolivienne de 1951, participaient à des grèves et à des confrontations avec l’armée dans les mois précédant l’arrivée de Guevara en Bolivie. Dans son journal intime, Guevara remarque ces évènements simplement comme toile de fond de ses propres activités. Il n’avait aucune perspective ni politique à présenter aux travailleurs boliviens. Quant aux paysans boliviens, leur réaction à l’initiation de la lutte armée n’était pas de soutenir les guérilleros, mais de les livrer à l’armée.
En Bolivie, les castristes avaient compté sur le soutien du Parti communiste pro-moscovite. Ce soutien ne se fit jamais sentir, et beaucoup d’observateurs attaquèrent les staliniens et la bureaucratie de Moscou elle-même pour avoir condamné les guérilleros à un isolement total et peut-être même pour avoir donné au gouvernement américain des renseignements sur l’emplacement du Che.
C’est tout à fait possible. Le secrétaire général du PC bolivien, Monje, était apparemment en contact avec le KGB; il partit vivre de façon permanente à Moscou peu de temps après la mort de Guevara. Une chose qui ressort de la biographie de Castaneda est de voir que les principaux partis communistes d’Amérique latine étaient dominés de façon extraordinaire par de telles personnes, dans bien des cas, des hommes qui avaient joué un rôle direct dans l’assassinat de Trotsky en 1940. Il établit aussi, à partir de documents récemment devenus disponibles dans les archives soviétiques, que ces partis étaient financés par des subventions directes depuis Moscou. La bureaucratie soviétique se payait des agences politiques fiables dont le but était d’aider sa quête pour une coexistence tranquille avec Washington.
Mais finalement on a l’impression qu’une telle trahison n’était pas vraiment si nécessaire. L’idée qu’une révolution se ferait grâce à l’arrivée d’une vingtaine d’hommes armés dans une région où ils n’avaient aucun antécédent politique, aucun soutien ni même un programme politique ou une perspective politique à développer, était condamnée d’avance. On a un certain aperçu du caractère lamentable de cette aventure en apprenant que, pendant ses derniers jours, cerné par l’armée bolivienne, Guevara projetait de faire appel au soutien international ... en adressant des lettres à Bertrand Russell et à Jean-Paul Sartre.
Cuba et la Quatrième Internationale
La révolution cubaine fut un tournant critique dans l’histoire de la Quatrième Internationale.
Après avoir dirigé la lutte contre le pablisme en 1953, la section américaine, le Socialist Workers Party (SWP), se réunifia avec la principale tendance pabliste dirigée par Ernest Mandel dix ans plus tard. Cette réunification se basa principalement sur une évaluation commune du castrisme et du rôle du nationalisme petit-bourgeois. Le SWP et les pablistes déterminèrent, au vu de la nationalisation de la majorité des forces productives à Cuba, que Cuba était devenu un Etat ouvrier. De plus, ils avancèrent la perspective que le castrisme pourrait devenir une tendance internationale, donnant naissance à un nouveau leadership révolutionnaire de la classe ouvrière internationale.
Cette perspective avait des implications allant bien au-delà de Cuba. Comme Trotsky l’avait fait remarquer pendant le débat sur la définition de l'Etat soviétique en 1939-40, toute définition sociologique recouvre un pronostic historique. La désignation de Cuba comme Etat ouvrier représentait une rupture avec toute la conception historique et théorique de la révolution socialiste développée depuis Marx.
A Cuba, le pouvoir était tombé aux mains d'une armée de guérilleros d'un caractère clairement nationaliste et petit-bourgeois, sans attaches sérieuses aux travailleurs. Les travailleurs eux-mêmes n'avaient joué aucun rôle sérieux dans la formation du nouveau régime, et ils n'avait pas plus établi de manière d'exercer un contrôle démocratique sur l'Etat nouvellement constitué.
Désigner un tel Etat d’« Etat ouvrier » avait d'immenses ramifications. Cela signifiait l'abandon de toute la lutte menée par le mouvement marxiste pour l'indépendance politique et d'organisation de la classe ouvrière. Cela indiquait au contraire que la voie vers le socialisme était la subordination des travailleurs aux leaders politiques petit-bourgeois. Ce serait les castristes, les armées de guérilleros et d'autres nationalistes rattachés à la petite bourgeoisie, qui dirigeraient la révolution socialiste, non pas la classe ouvrière éduquée et organisée par les partis de la Quatrième Internationale. C'était le principal pronostic historique qui se dégageait de la définition sociologique d'un Etat ouvrier cubain émise par les pablistes.
La perspective élaborée par Joseph Hansen du SWP sur la question de Cuba reposait sur une grossière vulgarisation du marxisme. Il prenait comme point de départ la décision antérieure du mouvement trotskyste d'utiliser la définition très conditionnelle et un peu improvisée « d'Etat ouvrier déformé » pour décrire la Chine et les Etats-tampons d'Europe de l'Est.
Dans ces précédentes discussions, le SWP avait mis l'accent sur l'adjectif « déformé », pour indiquer que ces Etats n'étaient pas historiquement viables. Il s’était opposé à la tentative de Pablo d’utiliser cette définition comme un moyen de doter le stalinisme d’un potentiel révolutionnaire.
Hansen, cependant, même plus crûment que Pablo, tenta de démontrer que le fait que Cuba répondait à une série de critères abstraits--surtout la nationalisation économique-- le plaçait prétendument dans la catégorie des Etats ouvriers.
La classe ouvrière n'avait pas fait la révolution, et elle n'exerçait aucun contrôle sur l'appareil d'Etat après la révolution. Mais ces faits étaient relégués à une position de vagues critères normatifs auxquels la révolution cubaine ne répondait pas encore, montrant qu’il était nécessaire qu'elle fasse des progrès et qu’il fallait d’autant plus la soutenir inconditionnellement.
Comme Hansen l’écrivit à l'époque: « Le gouvernement cubain n'a pas encore institué de formes démocratiques de pouvoir prolétaire comme des conseils ouvriers, de soldats, ou de paysans. Mais il a cependant fait des pas dans une direction socialiste il a donné des preuves de ses tendances démocratiques. Il n'a pas hésité à armer le peuple et instituer une milice populaire. Il a garanti la liberté d'expression à tous les groupes qui soutiennent la révolution. A cet égard, il présente un contraste bienvenu avec les autres Etats non capitalistes, qui ont été entachés de stalinisme.
« Si la révolution cubaine pouvait se développer librement, sa tendance démocratique l'amènerait sans doute à la création rapide de formes prolétaires démocratiques adaptées à ses propres besoins. Une des plus fortes raisons pour soutenir vigoureusement cette révolution est donc de donner à cette tendance la possibilité maximale d'opérer. »
La réalité cubaine était très différente du scénario en rose dépeint pas Hansen. Les trotskystes cubains, par exemple, furent réprimés sans merci, leurs chefs emprisonnés et leur presse détruite. L'île a depuis longtemps un des chiffres les plus élevés de prisonniers politiques au monde, dont un bon nombre sont d'anciens camarades de Castro dans le mouvement du 26 juillet.
Du point de vue théorique, l'aspect le plus trompeur de l'analyse de Hansen était sa suggestion que, s'il évoluait dégagé de toute contrainte extérieure, le régime castriste instituerait « des formes prolétaires démocratiques », c'est-à-dire ces conseils ouvriers ou, pour utiliser le terme forgé par la révolution russe, des soviets.
De telles organes de pouvoir ouvrier, cependant, ne sont pas institués ou accordés par les autorités supérieures d'un régime créé par des nationalistes petit-bourgeois. De telles institutions - qu'elles soient créées par Castro, Khadafi, ou Saddam Hussein - ne sont jamais rien de plus qu'une devanture pour un régime bonapartiste. D’authentiques conseils ouvriers ou soviets ne peuvent être créés que par les travailleurs eux-mêmes, comme moyen d'organiser les masses, de renverser le capitalisme, et d'établir un nouvel Etat basé sur le pouvoir prolétaire.
Lénine et les bolcheviques n'ont pas accordé les soviets aux travailleurs après être arrivés au pouvoir. Ils ont au contraire dirigé la lutte pour le pouvoir au sein de ces organes que le prolétariat russe lui-même avait créés au cours du développement de sa lutte de classe et grâce au développement de la conscience de classe politique produite par l'intervention dans la durée des marxistes russes.
Les pablistes ont adopté la position que les nationalisations de Castro et l'auto-proclamation de son marxisme-léninisme, constituaient la confirmation de la révolution permanente.
En réalité Cuba, comme tant d'autres pays opprimés dans les décennies qui ont suivi la Deuxième guerre mondiale, ne confirmait que négativement la théorie de la révolution permanente. C'est-à-dire que là où il manquait un parti révolutionnaire à la classe ouvrière, qui se trouvait donc incapable d'offrir une alternative politique aux masses opprimées, les représentants de la bourgeoisie nationale et de la petite bourgeoisie ont pu agir pour imposer leurs propres solutions. Nasser, Nehru, Peron, Ben Bella, Sukarno, les baasistes et, dans une période plus tardive, les intégristes islamiques en Iran et les sandinistes aux Nicaragua, sont tous des exemples de ce processus. Dans presque tous ces cas, des nationalisations ont également eu lieu.
Dans un document adressé au SWP par la Socialist Labour League (SLL) en 1961, les trotskystes britanniques critiquèrent durement l'adulation par Hansen des leaders nationalistes petit-bourgeois.
« Ce n'est pas la tâche des trotskistes d'applaudir de tels leaders nationalistes », écrivirent-ils. « S’ils sont en mesure de disposer du soutien des masses c’est uniquement du fait de la trahison de la démocratie sociale et particulièrement du stalinisme, et ils deviennent ainsi des tampons entre l'impérialisme et les masses de travailleurs et de paysans. La possibilité de l'aide économique de l'URSS leur permet souvent d'obtenir de meilleurs conditions dans leurs négociations avec l'impérialisme et permet parfois même aux éléments plus radicaux parmi les leaders bourgeois et petit-bourgeois d'attaquer les biens des impérialistes et ainsi de renforcer leur soutien parmi les masses. Mais, pour nous, dans chaque cas la question essentielle dans ces pays est que la classe ouvrière puisse conquérir son indépendance politique en construisant un parti marxiste, dirigeant les paysans pauvres vers la création de soviets, et reconnaissant les rapports nécessaires avec la révolution socialiste internationale. A notre avis, les trotskystes ne devraient en aucun cas substituer à cela l’espoir que les nationalistes puissent devenir des socialistes. »
Ceux qui sont au fait de la dégénérescence ultérieure du Workers Revolutionary Party britannique reconnaîtront que ce passage est une accusation directe de la ligne de Healy, Banda, et Slaughter, à peine une décennie plus tard, envers l’OLP et différents régimes arabes. Ceci ne fait que démontrer la justesse de l’analyse, et le fait que l’attaque révisionniste sur la Quatrième Internationale était basée sur des forces objectives de classe. Ayant abandonné la lutte contre le pablisme, la direction de la section britannique allait être victime des mêmes forces qui avaient fatalement touché le SWP.
L’enjeu de la proclamation de Cuba comme Etat ouvrier, et de sa révolution comme nouvelle voie vers le socialisme, c’était la renonciation de la perspective de la révolution permanente. La classe ouvrière n’avait plus un rôle dirigeant à jouer dans les pays attardés, et on n’avait plus à lutter pour l’éveil de la conscience socialiste de cette classe. Au lieu de cela, des bandes de guérilleros, basés sur les paysans, pouvaient faire naître le socialisme sans l’aide des travailleurs, voire même malgré eux.
Ceci marquait un rejet des fondements les plus essentiels du marxisme. La lutte pour le socialisme était séparée du prolétariat. La libération de la classe ouvrière n’était pas la tâche de cette classe elle-même. Elle devenait plutôt la spectatrice muette des actions de guérilleros héroïques.
En considérant cette perspective, on peut comprendre clairement les bases de classe de l'engouement durable de la gauche petite-bourgeoise dans son ensemble avec Fidel Castro. Ce qu'ils voient dans Castro, c'est la capacité de la petite bourgeoisie à dominer la classe ouvrière et à jouer un rôle apparemment indépendant. Cuba, pour eux, démontrait que l'intellectuel de gauche, l'étudiant gauchiste, ou le manifestant des classes moyennes n'avaient pas à se subordonner à la classe ouvrière et à la lutte difficile et prolongée pour le développement de la conscience socialiste parmi les travailleurs. Ils pouvaient simplement révolutionner la société par leur propre activité spontanée.
En combattant cette attaque révisionniste sur le marxisme, la SLL faisait remonter le conflit sur Cuba à des questions fondamentales de méthode. Elle démontrait que le SWP faisait ce que Trotsky avait nommé « le culte du fait accompli », c'est-à-dire qu'ils s'adaptaient à une prétendue réalité déterminée par la structure sociale existante, les organisations politiques existantes de la classe ouvrière et les formes de conscience bourgeoise qui prédominaient parmi de larges couches de travailleurs et de personnes opprimées. Le tout était traité comme une série de facteurs objectifs et déterminants, entièrement séparés de la lutte consciente du parti révolutionnaire prolétarien.
La méthode du SWP était de contempler passivement ces « faits » et de s'adapter aux organisations existantes, en cherchant la stratégie qui offrait le plus de chances d'un succès rapide. Ils devinrent ainsi des apologues pour ces organisations, justifiant chacune de leurs actions en disant que, vu les circonstances, que pouvaient-elles faire? Ces « circonstances » excluaient cependant toujours la lutte consciente des trotskystes pour mobiliser la classe ouvrière indépendamment sur la base de son propre programme socialiste et internationaliste.
La SLL défendait les conquêtes théoriques du mouvement trotskyste dans sa lutte contre le stalinisme. Elle insistait pour dire que les expériences stratégiques de toute l'époque impérialiste avaient démontré que des mouvements politiques qui se basaient sur d'autres classes que la classe ouvrière ne peuvent pas mener à bien les luttes pour la libération de l'oppression impérialiste et de l’arriération économique et culturelle dans les pays coloniaux ou anciennement coloniaux.
Ces luttes ne pouvaient aboutir que par la conquête du pouvoir par la classe ouvrière et l'extension de la révolution socialiste mondiale. La tâche principale qui découlait de cette analyse était la construction de partis indépendants révolutionnaires de la classe ouvrière, basés sur une lutte contre toutes les tendances opportunistes, particulièrement les staliniens, qui essayaient de subordonner la classe ouvrière au nationalisme et aux partis nationalistes.
Surtout, le pablisme niait que l'accomplissement de la révolution socialiste nécessitait le développement d'un haut niveau de conscience politique socialiste dans les sections les plus avancées de la classe ouvrière. Du point de vue pabliste, la conscience politique des travailleurs était, en dernière analyse, une question sans grande importance. S'il leur arrivait de considérer que la classe ouvrière avait une relation à la révolution socialiste, c'était simplement en tant que force objective dirigée et manipulée par d'autres.
La résolution rédigée par les pablistes après la réunification avec le SWP énumérait les implications politiques des révisions théoriques développées sur la question cubaine: « La faiblesse de l’ennemi dans les pays arriérés laisse ouverte la possibilité d’arriver au pouvoir même avec un instrument contondant. » C'est-à-dire qu’il était possible d’établir des états ouvriers sans même construire des partis de la classe ouvrière.
Dans ces pays, déclaraient-ils, et particulièrement en Amérique latine, les conditions de pauvreté massive et la faiblesse relative des structures de l'état bourgeois « créent des situations où la faillite d'une vague révolutionnaire ne produit pas automatiquement une relative stabilisation sociale ou économique, même temporaire. Une succession apparemment inépuisables de luttes de masses continue ... La faiblesse de l'ennemi offre à la révolution de plus importants moyens de récupérer après des défaites temporaires que dans les pays impérialistes. »
C'était une déformation grossière de la théorie de la révolution permanente de Trotsky. Quand Trotsky désignait la faiblesse de la bourgeoisie dans la Russie tsariste, ce n'était pas dans un vide intemporel, mais plutôt en relation à la domination de l'impérialisme d'un côté, et de la force objective de la classe ouvrière russe, peu nombreuse mais concentrée. La bourgeoisie n'était jamais trop faible pour écraser ou contrôler la démocratie petite-bourgeoise. Elle était faible en ce sens qu'elle confrontait un prolétariat jeune, à la tête duquel marchait un parti révolutionnaire.
Les pablistes, cependant, avaient rejeté le rôle du prolétariat industriel et avaient donné la tâche de faire la révolution à précisément de telles forces petites-bourgeoises.
Leur théorie des « instruments contondants » et des « luttes de masses inépuisables » fut élaborée à la veille du début d'une série de coups d’Etat soutenus par Washington--commençant par celui du général Castelo Branco au Brésil--qui plongeraient l'Amérique latine dans une décennie de répression cauchemardesque, dont l'ombre plane toujours sur le continent.
Non seulement les pablistes n’avaient pas préparé la classe ouvrière à de tels évènements, mais ils avaient facilité ces évènements en insistant pour dire que d'autres forces que la classe ouvrière pouvaient faire la révolution et en approuvant la perspective castriste d'actions armées entreprises par des bandes isolées de guérilleros.
Le pablisme et la crise de la direction ouvrière
Pourquoi le castrisme devint-il un tel pôle d'attraction en Amérique latine? Si l'histoire a réfuté la théorie selon laquelle les conditions préalables existaient pour une lutte de guérilleros à travers le continent, il y avait une chose que tous ces pays avaient en commun. Les représentants politiques dominants de la classe ouvrière, particulièrement les partis communistes staliniens, n'offraient pas de voie pour aller de l'avant dans une situation de crise révolutionnaire grandissante.
La prétendue « nouvelle réalité » célébrée par les pablistes--l'émergence d'une tendance nationaliste radicale dirigée par la petite-bourgeoise, telle le castrisme--était essentiellement une manifestation de la crise non résolue de l'orientation politique de la classe ouvrière. Ils la présentaient, cependant, comme une résolution de cette crise, désavouant l’objectif stratégique de la Quatrième Internationale. Abandonnant une orientation indépendante vers la classe ouvrière et la lutte pour construire un parti qui pourrait briser la domination politique de la bureaucratie, ils réduisirent le rôle de la Quatrième Internationale à celui de conseiller et d'assistant aux nationalistes petit-bourgeois et aux staliniens, essayant de les influencer et de les pousser subtilement vers la gauche.
Comment cette perspective se réalisa-t-elle en pratique ? En 1968 les pablistes eurent leur Neuvième Congrès, immédiatement après le désastre bolivien de Guevara, à la veille de grandes luttes de classe en Amérique latine. Leurs instructions aux partis membres du Secrétariat Unifié en Amérique latine étaient d'abandonner la classe ouvrière et de mener des luttes de guérilla.
Leur communiqué disait: « Même dans le cas de pays où il pourrait y avoir d'abord de grandes mobilisations des classes urbaines, la guerre civile prendra des formes variées, et l'axe principal d'une période entière sera la guérilla rurale, un terme dont le sens principal est géographique et militaire, et qui n'implique pas exclusivement (ou même principalement) une composition paysanne. »
Leur résolution continuait: « La seule perspective réaliste en Amérique latine est la lutte armée, qui peut durer bien des années. On ne peut concevoir la préparation technique comme simplement un aspect du travail politique, mais plutôt comme l'aspect fondamental à l'échelle internationale et l’un des aspects fondamentaux dans ces pays où les conditions minimales n'existent pas encore. »
Les instructions n'auraient pas pu être plus explicites. Au cas où quiconque dans les sections latino-américaines aurait pu avoir des doutes sur la question de savoir s'ils avaient un soutien suffisant parmi les paysans, ou le soutien politique nécessaire pour mener une insurrection dans les campagnes, la résolution assurait qu'aucun soutien paysan n'était nécessaire et que la situation politique n'avait rien à voir. On avait simplement à faire la « préparation technique » de la lutte armée.
Le résultat fut la liquidation politique et la destruction physique des cadres dirigés par les pablistes en Amérique latine.
En Argentine, par exemple, la section officielle du Secrétariat Unifié se reconstitua en ERP avant de rompre formellement avec les pablistes. Elle s'engagea dans l'enlèvement et la demande de rançon d’hommes d'affaires, ajoutant simplement des revendications telles des augmentations de salaire et de meilleures conditions pour les travailleurs.
Quel fut l'effet de telles actions? On enseignait aux travailleurs que leur rôle n'était pas de lutter pour mettre fin au capitalisme. Ils devaient simplement agir en spectateurs reconnaissants, tandis que des guérilleros héroïques luttaient pour eux.
Au Chili, les travailleurs menèrent une offensive soutenue, qui fut finalement étranglée par le gouvernement d'Unité Populaire d'Allende, dont la politique prépara le chemin pour la dictature de Pinochet. En Argentine, le Cordobazo de 1969, pendant lequel les travailleurs de Cordoba prirent contrôle de la ville, inaugura une offensive soutenue qui fut réprimée par les péronistes et puis liquidée par la dictature de Videla. En Bolivie, les mineurs se soulevèrent mais se trouvèrent subordonnés par leurs dirigeants politiques à une section prétendument de gauche et nationaliste de l'armée, dirigée par le général Torres. Comme on pouvait le prévoir, Torres céda bientôt le pouvoir à ses collègues plus traditionnels, qui usèrent d'une répression sans merci contre les travailleurs boliviens.
En se tournant vers le castrisme, les pablistes avaient abandonné et la classe ouvrière et la lutte pour la libérer de la domination des vieilles bureaucraties. Tout comme Castro avait soi-disant confirmé la révolution permanente, il avait aussi rendu superflue cette lutte essentielle.
Hansen, du SWP, avança cette thèse avec son cynisme et son manque de finesse habituels, proclamant que Castro avait triomphé du rôle contre-révolutionnaire du stalinisme.
« Incapable de faire sauter l'obstacle stalinien, la révolution a fait un important retour sur elle-même et a fait un détour. Ce détour nous a conduit dans des contrées très accidentées, telles la Sierra Maestra de Cuba, mais il est clair que l'on est à présent en train de contourner le barrage routier stalinien.
« On n'a pas besoin de se tourner vers Moscou pour notre orientation. C'est la principale leçon à tirer de l'expérience cubaine. Pour rompre finalement avec l'hypnose stalinienne, il a fallu ramper à quatre pattes à travers les jungles de la Sierra Maestra. »
Cette conclusion eut des implications politiques bien définies, qui dépassaient largement Cuba. Si l'on pouvait simplement « contourner le barrage routier stalinien » grâce à une guerre de guérilla menée par des nationalistes petit-bourgeois, la lutte difficile et soutenue menée par la Quatrième Internationale pour briser l'emprise du stalinisme sur la classe ouvrière était non seulement superflue, mais même contreproductive.
L'effet net de cette perspective fut non pas de briser, mais plutôt de renforcer l'emprise du stalinisme sur le mouvement ouvrier dans les pays opprimés et particulièrement en Amérique latine. Elle contribua à éloigner toute une génération de jeunes latino-américains de toute lutte au sein de la classe ouvrière. Ce virage vers la lutte de guérilla fut un soutien inespéré aux staliniens et aux autres directions bureaucratiques, isolant les éléments les plus révolutionnaires de la jeunesse et une section des ouvriers radicalisés et renforçant ainsi le contrôle des bureaucraties sur le mouvement ouvrier.
En fin de compte, l'adaptation pabliste au nationalisme petit-bourgeois contribua à garantir que la classe ouvrière n'aurait pas d'orientation révolutionnaire développée en entrant dans les grandes luttes de classe de la fin des années 1960 et début 1970. Les aventures de guérilla qu'ils recommandaient donnèrent aux armées et à l'impérialisme le prétexte nécessaire pour instaurer la dictature. Ainsi la tendance révisionniste a joué un rôle essentiel dans la préparation des défaites les plus sanglantes de l'histoire des travailleurs en Amérique latine.
Bilan de la guérilla
Que sont devenus les mouvements guévaristes-castristes que les pablistes déclaraient être les nouveaux instruments de la révolution socialiste? Tracer leur évolution concrète signifie révéler le caractère de classe de ces mouvements depuis leurs origines.
Le FALN vénézuélien était un des principaux mouvements de guérilla dans les années 1960, formé avec le soutien cubain. Citons une déclaration d'un des leaders du mouvement pendant cette période.
« Quand nous parlons de la libération du Venezuela nous voulons dire la libération de toute l'Amérique latine; nous ne reconnaissons pas de frontières en Amérique latine. Nos frontières sont des frontières idéologiques. Nous interprétons la solidarité internationale d'une façon vraiment révolutionnaire, et nous avons donc résolu de combattre, combattre l'impérialisme jusqu'à ce qu'il n'existe plus; nous sommes décidés de ne pas déposer les armes avant que l'impérialisme nord-américain en particulier ne soit réduit à l'impuissance. »
L'auteur de ces lignes était Teodoro Petkoff. Il a non seulement déposé les armes, mais il est devenu depuis Ministre du Plan au Venezuela et le principal architecte de l'application des programmes d'austérité du FMI. Après sa proclamation de solidarité continentale et d'une lutte à mort contre l'impérialisme yankee, Petkoff s'occupe à présent de réduire les salaires et de privatiser les entreprises d'état, à fin de mieux concurrencer les autres pays de la région dans la lutte pour obtenir des capitaux de l'étranger. Il est pressenti pour être le principal candidat à l'élection présidentielle au Venezuela cette année.
Son cas a valeur d'exemple. Les guérilleros Tupamaro de l'Uruguay font à présent partie du Frente Amplio, un front électoral bourgeois qui gère les conditions de désintégration sociale de la capitale, Montevideo. Le mouvement M-19 est arrivé à un arrangement avec le gouvernement colombien qui lui assurait non seulement des sièges au parlement, mais aussi l'occasion de troquer leurs armes pour des prêts bancaires afin de créer de petites entreprises.
Au début des années 1980, le régime castriste et ses défenseurs prétendirent qu'en Amérique centrale, l'arrivée au pouvoir des Sandinistes au Nicaragua et l'éruption de la guerre civile d'El Salvador offrait une nouvelle confirmation de leur perspective.
Qu'est-il devenu de tous ces mouvements? Les Sandinistes, le FMLN d'El Salvador, l'URNG au Guatemala ont tous signé des pactes avec les forces responsables du meurtre de centaines de milliers de travailleurs et de paysans. Castro a aidé à négocier ces pactes dans les négociations de Contadora et Esquipulas, qui ont consolidé le pouvoir aux mains de sections de la bourgeoisie soutenues par les Etats-Unis, qui ont transformé les cadres des prétendus mouvements de libération en députés parlementaires, en officiers militaires, et en policiers des nouveaux régimes. Tous ces groupes se sont scindés en factions diverses, se dénonçant mutuellement—à raison--pour leurs trahisons politiques et leur corruption financière.
Entre-temps, les masses de la région font face à des conditions de pauvreté et d'oppression autant, voire plus sévères que celles qui propulsèrent les vagues révolutionnaires dans la région il y a 20 ans. L'effet net de ces mouvements nationalistes petit-bourgeois influencés par Castro fut de semer la démoralisation au sein d’une couche de travailleurs, de jeunes, et de paysans les plus militants.
Cuba aujourd’hui
Que dire du Cuba ? Quel est le résultat final de la nouvelle voie vers le socialisme proclamée par le régime de Castro et par les pablistes il y a 35 ans ?
Pendant 30 ans l’île a survécu grâce aux énormes subventions versées par la bureaucratie de Moscou. Selon les admirateurs de Castro et les estimations américaines, les subventions économiques versées par l’URSS à Cuba s’élevaient à entre $3 et $5 milliards par an. Le mécanisme pour ces subventions était l’achat, par le bloc soviétique, de produits agricoles cubains, particulièrement de sucre, à des prix supérieurs à celui du marché mondial – parfois 12 fois supérieurs ! – et la vente du pétrole à des prix en dessous du marché mondial. Avec cet arrangement, Cuba était arrivé à un stade où il achetait du sucre de la République Dominicaine voisine, et revendait le pétrole soviétique sur les marchés internationaux pour obtenir des devises.
La dépendance sur les subventions soviétiques a eu l’effet de consolider la monoculture du sucre, fondation historique de son arriération économique et de son oppression. Tout comme avant la révolution de 1959, les exportations du Cuba, dont 83 pourcent allaient en URSS et en Europe de l’est, consistaient en sucre, tabac, nickel, et quelques autres produits agricoles. Du bloc soviétique, il importait des produits de consommation manufacturés et des machines, ainsi qu’une bonne partie de son alimentation.
Aucun des ajustements ou des changements abrupts de politique économique de l’infaillible « lider maximo » Fidel Castro n’a changé cette relation essentielle. Finalement, les importantes réformes gagnées par le peuple cubain en matière de santé, d’éducation et de nutrition ont été soutenues par ces subventions. Maintenant que le régime fait appel à l’investissement direct de l’étranger, ces réformes sont systématiquement rongées.
Castro est entré dans un pacte faustien avec la bureaucratie soviétique, fonctionnant comme un pion dans les relations soviético-américaines en échange de subventions du Kremlin. Fatalement, le diable est venu prendre ce qui lui est dû.
La dissolution de l’URSS fut une catastrophe économique pour Cuba. La réponse du régime castriste fut d’encourager davantage d’investissement en provenance de l’étranger et de permettre le développement d’une stratification sociale grandissante à l’intérieur du pays même.
Le ministre des affaires étrangères Roberto Robaina a récemment expliqué la politique de Cuba dans une interview pour le journal de l’Etat, Granma : « Ce qui se passe à Cuba, c’est une ouverture économique avec entière garantie pour les investisseurs étrangers. Cette ouverture est stratégique et s’amplifie et s’approfondit chaque jour. […]
« Mitsubishi Motors, Castrol, Unilever, Sherrit Gordon, Grupo Sol, Total, Melia Hotels, Domos, ING Bank, Rolex, DHL, Lloyds, Canon, Bayer, ce sont tous des noms à succès dans l’univers des affaires et on les trouve à Cuba. Certaines de ces firmes ont le plus grand capital au monde et ils nous ont fait confiance.
« La facilité de l’investissement, la sécurité et le respect, les garanties de rapatriement des profits, la disponibilité de personnels excellents, les logements, le désir d’avancer, le sérieux des négociations, et la loyauté des partenaires cubains sont certains des éléments les plus appréciés par ceux qui ont choisi de rejoindre Cuba ».
S’il ne l’a pas dit dans Granma, on dit sans doute en privé à ces investisseurs qu’à Cuba le travail est payé à des prix parmi les plus bas de l’hémisphère, et que l’absence de grèves est assurée par un état policier formé par les staliniens.
Le régime castriste a l’habitude de dire qu’il recherche l’investissement des capitalistes étrangers pour sauver « les conquêtes sociales » de la Révolution Cubaine. La réalité est que le régime de Castro, comme les régimes bourgeois à travers l’ancien monde colonial, est en train de vendre de la main d’œuvre bon marché aux multinationales.
Dans le cas de Cuba, ce processus prend une forme très directe et centralisée. Le travail cubain est vendu aux entreprises étrangères, qui paient le gouvernement cubain en devises étrangères. Le gouvernement embauche les travailleurs nécessaires et leur paie une fraction de cette somme en pesos, la devise locale. Les entreprises étrangères conservent le droit de licencier les travailleurs.
La montée de l’inégalité sociale se nourrit aussi d’une économie parallèle à base de dollars. La plus grande source de devises étrangères à Cuba provient de l’envoi par des exilés cubains, installés pour la plupart aux Etats-Unis, d’argent à leurs familles. Que peut-on dire d’une révolution qui dépend économiquement de ceux qu’elle a récemment dénoncés comme étant des « gusanos » (des vers) contre-révolutionnaires ?
D’autres devises étrangères entrent dans le pays par le biais du tourisme, que le régime castriste a mis au centre de sa planification économique. Le résultat est ce que certains ont appelé un apartheid touristique. De nouveaux hôtels, restaurants, et magasins se construisent, réservés uniquement aux étrangers et dont l’accès est interdit aux Cubains ordinaires. La prostitution s’étend. L’immense majorité de la population vit dans la pauvreté.
Le régime castriste met toutes les difficultés économiques de l’île sur le compte de l’embargo américain. La politique américaine est, sans l’ombre d’un doute, l’exercice brutal et irrationnel de la puissance impérialiste envers un petit pays opprimé. Mais cette politique est en place depuis 35 ans. Entre-temps, Cuba a eu des relations économiques avec presque tous les autres grands pays du monde.
La crise cubaine est fondamentalement le produit du caractère bourgeois de la révolution elle-même. Elle n’a résolu aucun des problèmes historiques de la société cubaine. Ces contradictions ont été simplement cachées par les subventions massives de la bureaucratie soviétique.
Peu de pays au monde ont vu un tel exode de réfugiés. Dans les premières années de la révolution, c’était largement des couches bourgeoises ou de la classe moyenne aisée. Mais ceux qui dans les années 80 et 90 fuyaient à bord de radeaux et dans des chambres à air étaient motivés par les mêmes forces qui faisaient fuir des milliers de personnes de Haiti, du Mexique, et de bien d’autres pays: le désir d’échapper à la faim et à l’oppression.
En plus de cette situation, il y a un régime qui étouffe les aspirations des masses de travailleurs cubains. Castro règne à travers une dictature politique organisée sur un tracé militaire. L’institution essentielle de l’état est l’armée, qui dirige la plupart des entreprises économiques de Cuba.
Castro est enchâssé dans la constitution cubaine comme président à vie. S’opposer à lui est donc non seulement « contre-révolutionnaire », mais aussi anticonstitutionnel. Il est à la fois chef de l’Etat, chef du gouvernement, premier secrétaire du Parti Communiste et commandant en chef des armées. Bref, tout pouvoir est concentré entre ses mains et il impose son diktat personnel sur chaque décision importante. A présent que Castro est septuagénaire, la succession devient une question de plus en plus pressante. Son frère Raul occupe toutes les positions de second dans le gouvernement, l'armée, et le parti.
Dans la mesure où Cuba était identifié au socialisme--une idée promue par les impérialistes d'un côté et le régime castriste et ses partisans radicaux de l'autre--ceci avait l'effet de discréditer la conception d'une alternative socialiste au capitalisme, particulièrement en Amérique latine.
Résumé
La Première Internationale sous Marx a adopté le slogan que « La libération des travailleurs sera la tâche des travailleurs eux-mêmes ». C’est-à-dire que le socialisme est, en dernière analyse, l’auto-détermination de la classe ouvrière. On ne peut pas l’accorder aux travailleurs ; une autre classe agissant au nom des travailleurs ne peut pas la gagner pour eux. Le socialisme ne peut être le produit que de la lutte consciente de la classe ouvrière, organisée démocratiquement en classe par elle-même, luttant pour transformer la société pour elle-même et pour le bien de toute l’humanité.
Le Comité international a défendu cette perspective contre toutes les théories en vogue dans les années 1960 et 1970 qui niaient le rôle révolutionnaire de la classe ouvrière et qui disaient avoir découvert d’autres raccourcis, plus révolutionnaires et plus commodes, pour arriver au socialisme. Plus de trente ans après, rien ne reste de ces théories. L’histoire a puissamment donné raison à la lutte entreprise par le CIQI.
Nous voulons rappeler ce que Joseph Hansen a dit sur la lutte intransigeante du Comité international et son refus de s’incliner devant le castrisme. Cette position, a-t-il prévenu, serait « un suicide politique en Amérique latine ». Que s’est-il passé, en fait ? Le révisionnisme pabliste et son soutien au castrisme ont encouragé une génération de jeunes radicalisés à tenter des aventures suicidaires dont la classe ouvrière a payé le prix le plus lourd.
Que se serait-il passé si, au lieu de s’adapter au castrisme, les forces influencées par le pablisme avaient soumis le nationalisme petit-bourgeois à une critique sans merci ?
Certainement le résultat aurait pu être un isolement temporaire, du moins vis-à-vis des mouvements dominés par la petite bourgeoisie, mais ils auraient ainsi éduqué les sections les plus avancées des travailleurs et des jeunes. Cette lutte aurait pu préparer une formation politique capable de mobiliser la classe ouvrière dans une lutte révolutionnaire. Au lieu de tomber sous la domination de dictatures militaires qui ont contribué à stabiliser un temps le capitalisme mondial, l’Amérique latine aurait pu donner une impulsion puissante à la révolution socialiste mondiale.
Les leçons centrales que nous devons tirer de cette expérience stratégique concernent les responsabilités essentielles des marxistes. Leur tâche n’est pas de découvrir et de s’adapter à d’autres forces qui accompliront spontanément la révolution socialiste. Elle est plutôt de construire des partis indépendants et révolutionnaires de la classe ouvrière, des sections du Comité international de la Quatrième Internationale, qui se basent sur une rigueur théorique implacable et disent la vérité aux travailleurs.
Les conditions objectives en Amérique latine et à travers le monde sont en train de mûrir vers une situation où la lutte entreprise par le mouvement trotskyste rencontrera le mouvement révolutionnaire de millions de personnes. Les leçons que le mouvement trotskyste a assimilées des luttes pour le socialisme au 20e siècle deviendront décisives pour leur réalisation au 21e.