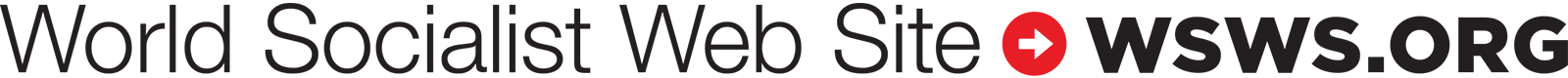Ceci est la deuxième partie d'un article en deux parties marquant la signature de l'armistice qui a mis fin aux combats pendant la guerre de Corée qui ont duré trois ans et enraciné la division de la péninsule coréenne issue de la guerre froide. La première partie est disponible ici .
Dès le début, les forces d'occupation américaines avaient dû écraser la résistance de la classe ouvrière et de la paysannerie coréennes. La colère des travailleurs explosa dans la seconde moitié de 1946, commençant par une grève générale de quelque 8 000 cheminots le 23 septembre à Busan qui s'est propagée dans tout le pays, impliquant jusqu'à 251 000 travailleurs. La hausse de l'inflation et des prix alimentaires ainsi que le chômage ont alimenté le mécontentement.
L'opposition à l'occupation américaine a également alimenté la colère des travailleurs. Le 1er octobre dans la ville de Daegu, un manifestant fut tué par la police, déclenchant des manifestations de masse et des attaques d'ouvriers et de paysans contre les symboles de leur oppression: policiers, propriétaires terriens et responsables gouvernementaux, dont beaucoup avaient collaboré avec les Japonais. Le soulèvement a duré jusqu'à la mi-novembre avant d'être violemment réprimé par l'armée américaine et la police coréenne, qui était de fait une force militaire sud-coréenne, et des organisations terroristes de droite.
L'hostilité à l'occupation américaine et au régime de droite qu'elle avait établi, truffé d'anciens collaborateurs japonais, a stimulé de nouveaux soulèvements populaires. L'un des plus importants a eu lieu sur l'île de Jeju où la foule a manifesté contre les projets américains d'organiser des élections séparées en 1948. Une campagne militaire pour écraser les habitants de l'île a eu lieu du 3 avril 1948 à mai 1949. Les estimations varient quant au nombre exact de victimes, mais des dizaines des milliers de personnes ont été tuées. Beaucoup d'autres ont été arrêtées et torturées, le tout avec le soutien du gouvernement militaire américain.
Au total, on estime que 100 000 à 200 000 Coréens opposés à l'occupation américaine et à l'établissement d'un État séparé avaient été assassinés avant même le début de la guerre de Corée. Les historiens estiment que 200 000 personnes supplémentaires, accusées d'être de gauche, ont été assassinées au début de la guerre.
Le régime profondément impopulaire de Rhee, assiégé par la classe ouvrière et la paysannerie du Sud, prétendait être le gouvernement légitime de toute la Corée et braillait en faveur de la guerre contre le Nord. Tout au long de l'été et de l'automne 1949, de nombreux affrontements ont eu lieu le long de la frontière, presque tous initiés par le Sud. Les affrontements se poursuivirent jusqu'en 1950.
Rhee renforça également l'armée en préparation de la guerre. Il a notamment fait venir de nombreux officiers coréens qui avaient servi comme collaborateurs dans l'armée japonaise du Kwantung, dont beaucoup avaient été responsables d'attaques contre les combattants partisans de l'indépendance coréenne.
Les affirmations des États-Unis que l'intervention militaire de la Corée du Nord en Corée du Sud en juin 1950 n'a pas été provoquée est tout simplement un mensonge, et un mensonge absurde.
Truman «perd» la Chine et la politique de refoulement
La brutalité de l'occupation américaine est allée de pair avec la crainte de Washington de perdre sa position dominante en Asie. Cette peur a été grandement aggravée par la révolution chinoise, qui a porté un coup massif à l'impérialisme américain et s'est répercutée dans toute l'Asie.
En 1949, la guerre civile entre les forces du Parti communiste chinois (PCC) stalinien et le Kuomintang (KMT) au pouvoir du généralissime Tchang Kaï-chek atteignit son stade critique final, lorsque le régime pro-américain du KMT s'est désintégré et que Tchang s'est enfui à Taiwan. Ce ne fut pas une insurrection de la classe ouvrière, comme la Révolution d'Octobre, mais une victoire militaire qui aboutit à la fondation de la République populaire de Chine en octobre 1949.
La «perte de la Chine» par l'administration Truman allait jouer un rôle important dans la décision de passer d'une politique d'endiguement à celui du refoulement et avec ses alliés, d'envahir la Corée en 1950. Elle avait précédemment retiré ses troupes en juin 1949, après le retrait de l'Union soviétique en Décembre 1948.
Truman fut l’objet d’une attaque importante à Washington. William Knowland, sénateur républicain de Californie et fervent partisan de Tchang Kaï-chek et des nationalistes chinois, dénonça Truman, affirmant que son administration «aidait, encourageait et soutenait la propagation du communisme en Asie» pour son incapacité et pour n’avoir pas pris plus de mesures contre le PCC. [1]
Le gouvernement de Truman réagit en finalisant en avril 1950 le document 68 du Conseil de sécurité nationale (NSC 68), qui appelait à un renforcement massif de l'armée américaine en vue de la guerre avec l'Union soviétique. Il a spécifiquement mis à l'ordre du jour la politique de refoulement et l'utilisation de l'armée pour renverser les gouvernements alignés sur les Soviétiques, déclarant qu'«il est clair qu'un renforcement substantiel et rapide des forces dans le monde libre est nécessaire pour soutenir une politique ferme visant à bloquer et faire reculer la volonté du Kremlin de dominer le monde». [2]
La guerre éclate
Lorsque des combats à grande échelle ont éclaté en Corée le 25 juin 1950, l'absence totale de soutien au régime de Rhee dans le Sud est rapidement devenue une évidence. L'armée nord-coréenne déferla sur le sud, écrasant et poussant l'armée sud-coréenne vers le coin sud-est de la péninsule.
Les États-Unis exploitèrent la guerre qu'ils avaient fomenté au cours des cinq années précédentes comme justification d'une invasion sous le couvert des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. L'objectif de Washington était la destruction de la Corée du Nord comme prélude à une invasion de la Chine avec l'intention d'y écraser la révolution.
En même temps, l'Union soviétique retirait son soutien à la Corée du Nord, permettant aux États-Unis de prendre toute la péninsule. En fait, dans les semaines qui ont précédé le début de la guerre, Staline avait dit au dirigeant nord-coréen Kim Il-sung, qui cherchait alors le soutien de Moscou dans une guerre pour unifier la Corée: «Si vous recevez une correction, Je ne lèverai pas le petit doigt.» [3]
Lors du vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur le déploiement de forces militaires en Corée, l'Union soviétique, qui aurait pu opposer son veto aux résolutions, était absente. Le prétexte était un boycott soviétique pour protester contre l’accueil de la République de Chine – le régime établi à Taiwan par les forces vaincues du Kuomintang – plutôt que la République populaire de Chine au Conseil de sécurité.
Les États-Unis ont envahi Incheon le 15 septembre 1950 et ont changé la direction de la guerre. Le 7 octobre, les forces américaines ont repoussé l'armée nord-coréenne jusqu’au 38e parallèle, puis se sont dirigées vers la rivière Yalu, qui longeait la frontière nord, avec une menace claire d'envahir la Chine. Sachant que la République populaire de Chine, en place depuis à peine un an et dont l’existence était menacée, le PCC a pu mobiliser un soutien populaire pour l'Armée des volontaires du peuple qui est entrée en Corée pour défendre le Nord.
Les forces américaines et chinoises se sont affrontées lors de la bataille du lac Changjin (connu sous son nom japonais de réservoir de Chosin), qui fit rage du 27 novembre au 13 décembre 1950. Le résultat a été une énorme défaite pour l'armée américaine, qui a été repoussée vers la ville portuaire de Hungnam en Corée du Nord et contraintse d'évacuer par la mer. La défaite a sérieusement perturbé les plans américains non seulement en Corée, mais pour toute la stratégie du refoulement. Des voix de l’élite américaine appelèrent à la guerre nucléaire en réponse.
Le général Douglas MacArthur, alors à la tête des forces américaines, demanda le pouvoir discrétionnaire de larguer des bombes atomiques comme il l'entendait. Il déclarera plus tard qu'il avait l'intention de larguer «entre 30 et 50 bombes atomiques [...] étalées sur la gorge de la Mandchourie» tout en débarquant des troupes nationalistes chinoises sur le continent chinois. [4]
Ce n'étaient pas simplement les divagations d'un fou. L'administration Truman a envisagé l'utilisation d'armes atomiques à la fois en Corée du Nord et en Chine à plusieurs reprises pendant la guerre, surtout pendant le mois d’avril 1951 où elle aurait été à deux doigts de s’en servir. Des bombes non assemblées furent transportées à Okinawa. Truman approuva le transfert du contrôle présidentiel des bombes au contrôle militaire le 6 avril mais sans que cela soit suivi d’effet.
Washington, cependant, ne voulait pas risquer une guerre nucléaire avec l'Union soviétique, qui avait testé avec succès sa propre bombe atomique en août 1949. Alors que Staline avait effectivement retiré le soutien au Nord avant la guerre, il était choqué par l'intensité de l’invasion américaine de la Corée. Il fournit de l'aide et des armes aux armées nord-coréenne et chinoise pour s'assurer que les États-Unis ne renverseraient pas le pouvoir chinois, considéré comme un tampon important entre les États-Unis en Asie et l'Union soviétique. L’aide comprenait des contributions sous la forme d'avions de chasse et de pilotes.
Atrocités américaines et sud-coréennes
Bien que de bombes atomiques n'aient pas été larguées, les atrocités commises par les forces américaines et sud-coréennes étaient monnaie courante. Hommes, femmes et enfants, prisonniers de guerre comme civils, étaient souvent forcés de creuser leur propre tombe avant d'être abattus. Beaucoup de ces meurtres ont été commis par des troupes sud-coréennes sous les yeux des forces américaines, se contentant de permettre à leur allié de faire le sale boulot de terroriser la population.
Les chiffres exacts sur le nombre de personnes assassinées ne sont pas connus car ils ont été dissimulés par Washington et Séoul et par les gouvernements sud-coréens successifs. Cependant, de nombreux massacres ont été révélés. Dans un exemple, des soldats sud-coréens ont assassiné 7 000 prisonniers politiques à Daejeon entre le 4 et le 6 juillet 1950. Dans un autre massacre relativement plus connu, des soldats américains ont assassiné jusqu'à 400 réfugiés le même mois à No Gun Ri (Nogeun-ri), près de Daejeon.
Beaucoup de ces atrocités ont été relevées par des journalistes, dont la couverture de la guerre a suscité l'indignation internationale et mis à nu les mensonges américains sur le conflit. En janvier 1951, Washington réagit en plaçant les journalistes américains sous la juridiction des militaires, bloquant et censurant ainsi toute couverture défavorable.
La réponse du mouvement trotskyste
Dès le début de la guerre, le mouvement trotskyste s'est opposé à la guerre et a exigé le retrait immédiat des troupes américaines et alliées de Corée. James P. Cannon, chef du Socialist Workers Party (SWP) aux États-Unis, a écrit une lettre ouverte passionnée à l'administration Truman et au Congrès en juillet 1950, dans laquelle il les a dénoncés comme «une bande de scélérats» et «des traîtres à l’espèce humaine». Canon a poursuivi:
L'intervention américaine en Corée est une invasion impérialiste brutale, pas différente de la guerre française contre l'Indochine ou de l'assaut hollandais contre l'Indonésie. Des garçons américains sont envoyés à 10 000 milles pour tuer et être tués, non pas pour libérer le peuple coréen, mais pour le conquérir et le subjuguer. C'est scandaleux. C'est monstrueux.
L'ensemble du peuple coréen – à l'exception des quelques agents à la solde du régime fantoche de Rhee – combat les envahisseurs impérialistes. C'est pourquoi les dépêches de presse coréennes se plaignent de plus en plus des tactiques d'«infiltration», de l'augmentation des activités de la «guérilla», du front de combat «fluide», de la «morosité» et du «manque de fiabilité» des «indigènes»…
L'explosion en Corée du 25 juin, comme les événements l'ont prouvé, a exprimé le désir profond des Coréens eux-mêmes d'unifier leur pays, de se débarrasser de la domination étrangère et de conquérir leur indépendance nationale complète. Il est vrai que le Kremlin cherche à profiter de cette lutte à ses propres fins réactionnaires et la vendrait demain s'il pouvait obtenir un autre accord avec Washington. Mais la lutte elle-même bénéficie du soutien écrasant et sans réserve du peuple coréen. Cela fait partie du puissant soulèvement des centaines de millions d’habitants des pays colonisés de toute l'Asie contre l'impérialisme occidental. C'est la vraie vérité, le vrai problème. Les esclaves coloniaux ne veulent plus être esclaves. [5]
Dans le même temps, la guerre de Corée a fourni une mise à nu de la position de Max Shachtman et de ceux qui ont rompu avec le SWP et le mouvement trotskyste en 1940, en affirmant que l'Union soviétique n'était plus un État ouvrier et en refusant par conséquent de défendre ce qui restait des acquis de la Révolution russe arrachés à l'impérialisme. Léon Trotsky ainsi que la direction du SWP établie au cours de la lutte politique en 1939-1940 ont déclaré que ceux qui ont déclaré l'Union soviétique était un capitalisme d'État s'adaptaient à l'impérialisme.
Une décennie plus tard, Shachtman et son Parti des travailleurs ont ouvertement soutenu l'invasion américaine de la Corée, déclarant qu'il s'agissait de la défense de la «démocratie» contre le totalitarisme stalinien, ont rédigé de tracts «socialistes» qui ont ensuite être largués par l'armée américaine sur les positions des Coréens du Nord et de la Chine les incitant à se rendre.
Pourparlers de trêve
Après le retrait des États-Unis du Nord, la guerre allait faire rage pendant encore deux ans et demi, les lignes de front étant largement contenues autour du 38e parallèle. Initiés par le représentant soviétique à l'ONU Adam Malik, les pourparlers de trêve commencèrent à Panmunjeom le 10 juillet 1951. Certains historiens ont soutenu que la guerre aurait pu se terminer cette année-là, mais les États-Unis avaient tout intérêt à maintenir le conflit. Dans les conditions de la chasse aux sorcières maccarthyste aux États-Unis, la guerre a servi un objectif précis, justifiant les attaques des anticommunistes contre l'opposition politique au capitalisme et la répression des mouvements ouvriers, que ce soit au pays ou à l'étranger.
Dans le Nord, la majeure partie de la population a survécu en vivant dans des grottes à la suite de raids aériens incessants. Dans les dernières semaines de la guerre, les États-Unis ont même bombardé des barrages d'irrigation qui fournissaient de l'eau pour 75 pour cent de la production alimentaire du Nord. Dans son livre Korea's Grievous War (La guerre douloureuse de Corée), l'historienne Sukyoung Hwang écrit: «La guerre aérienne en Corée a capitalisé sur les sentiments humains fondamentaux de peur. Les chasseurs-bombardiers américains se livraient régulièrement à des bombardements terroristes contre des villes et des villages nord-coréens, jurant d'inspirer une peur toute-puissante à la population locale.» [6]
Aux États-Unis, le mécontentement public face à la guerre grandissait. En janvier 1953, le président Dwight Eisenhower est arrivé au pouvoir, s'engageant à mettre fin à la guerre. Les combats cessèrent définitivement avec l'armistice du 27 juillet 1953. Les États-Unis avaient mené une guerre génocidaire contre la population coréenne, décimant la péninsule. Entre 4 et 5 millions de personnes ont été tuées, dont environ la moitié étaient des civils. Au total, les États-Unis ont largué 635 000 tonnes de bombes et 32 000 tonnes de napalm sur la Corée, ce qui en fait de celle-ci l'un des pays les plus bombardés de l'histoire. Par comparaison, les États-Unis ont largué environ 500 000 tonnes de bombes sur tout le théâtre d’opérations du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale.
Conclusion
Après l'armistice, l'impérialisme américain a continué à considérer la Corée du Sud comme une base d'opérations critique non seulement contre la Corée du Nord, mais aussi contre la Chine et l'Union soviétique. Il a soutenu le régime autoritaire de Rhee, puis pendant trois décennies la dictature militaire qui prit le pouvoir en 1961 sous Park Chung-hee . Les États-Unis ont aidé à créer une base industrielle en Corée du Sud pour l'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché et, en même temps, ont maintenu l'isolement diplomatique et économique de la Corée du Nord.
Sur fond d'une vague croissante de grèves et de protestations dans les années 1980, le régime a mené des réformes limitées ouvrant la voie à des élections ouvertes et à la légalisation de l'opposition libérale bourgeoise à la dictature. Malgré toutes les affirmations selon lesquelles la Corée du Sud est désormais une démocratie dynamique, l'appareil d'État de la dictature, en particulier l'armée, la police et les services de renseignement, imprégnés d'un anticommunisme viscéral, reste largement en place. Le parti de droite People Power Party (PPP), qui soutient l'actuel président sud-coréen Yoon Suk-yeol, trouve ses origines dans le parti de la dictature de Park.
La Corée du Nord reste de plus en plus isolée à la suite de la crise du stalinisme et le tournant vers la restauration capitaliste avec l'effondrement des régimes staliniens en Europe de l'Est, la dissolution de l'Union soviétique en 1991 et l'adhésion ouverte à la restructuration pro-marché par le Parti communiste chinois et ses homologues en Indochine. Le soutien économique de l'Union soviétique en particulier s'est rapidement tari, plongeant la Corée du Nord dans une profonde crise économique.
Loin d'abjurer la restauration capitaliste, le régime nord-coréen confronté à une aggravation de la crise économique s'est donné beaucoup de mal pour encourager les investissements étrangers, mettant même en place une série de zones de libre-échange restées largement vides. Alors que la main-d'œuvre nord-coréenne ultra-bon marché est attrayante, les entreprises mondiales, y compris en Corée du Sud, hésitent à investir dans des conditions où les États-Unis ont maintenu et renforcé leur blocus économique et diplomatique du pays.
La Corée reste au cœur de la stratégie américaine en Asie du Nord-Est. Une Corée divisée et la soi-disant « menace » nord-coréenne fournissent un prétexte utile pour maintenir une importante présence militaire américaine sur des bases au Japon et en Corée du Sud. Dans les années 1990, l'administration du président sud-coréen Kim Dae-jung a poussé sa politique Sunshine pour ouvrir la Corée du Nord aux investissements étrangers et à la construction de voies de transport, de communication et de pipeline à travers la péninsule coréenne.
La politique Sunshine a toujours été soumise aux conditions de Washington. Alors que l'administration Clinton a provisoirement adopté cette approche, elle a insisté pour que la Corée du Nord démantèle unilatéralement son programme et ses installations nucléaires, n'offrant en retour que de vagues promesses de négociations de paix et la fin de décennies d'isolement. Cependant, l'administration Bush, lors de son entrée en fonction en 2001, a saboté la politique Sunshine, poussant la Corée du Nord sur la voie du développement d'un arsenal nucléaire. Washington a répondu par des sanctions économiques paralysantes qui ont été maintenues et renforcées par les présidents Obama, Trump et Biden.
Aujourd'hui, la Corée du Sud est en première ligne d'une guerre en préparation avec la Chine, alors que l'impérialisme américain - déjà en guerre contre la Russie en Ukraine - tente désespérément et imprudemment de maintenir son hégémonie mondiale. Les bases américaines en Corée du Sud sont stratégiquement situées pour la guerre contre la Chine et la Russie. À ce jour, Washington prendrait le contrôle opérationnel de l'armée massive de la Corée du Sud en cas de guerre.
De plus, sous prétexte de la menace nord-coréenne, les États-Unis ont intégré la Corée du Sud et le Japon dans leur système de missiles anti-balistiques en Asie. En Corée du Sud, ils ont stationné une batterie THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) qui fait partie intégrante de sa planification stratégique pour une guerre nucléaire avec la Chine.
Au cours de la dernière décennie, l'impérialisme américain a transformé l'Asie du Nord-Est en une poudrière, exacerbant les tensions sur la péninsule coréenne et attisé les conflits territoriaux dans les mers de Chine orientale et méridionale. Alors même qu'ils intensifient leur guerre contre la Russie, les États-Unis incitent délibérément la Chine à attaquer Taïwan en remettant en question la politique d'une seule Chine - la base des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine - qui reconnaît l'île comme faisant partie de la Chine.
Les leçons de la guerre de Corée ne doivent pas être oubliées. C'est une démonstration graphique de la cruauté avec laquelle l'impérialisme américain poursuivra ses intérêts économiques et stratégiques au mépris total de la vie et de la souffrance humaines. Les États-Unis ont préparé le terrain pour une nouvelle guerre mondiale qui implique déjà la Russie et ont la Chine dans sa ligne de mire. A côté d'un tel conflit entre puissances nucléaires, les horreurs de la guerre de Corée feraient pâle figure.
L'Armageddon nucléaire peut et doit être stoppé par la seule force sociale capable de le faire: la classe ouvrière internationale sur la base d'un programme socialiste visant à abolir le capitalisme et sa division en faillite du monde en États-nations rivaux. C'est la perspective politique pour laquelle seul le Comité international de la Quatrième Internationale se bat.
Fin
Notes
[1] Cité dans: Robert Mann, A Grand Delusion: America’s Descent into Vietnam, Basic Books 2001, p. 26
[2] United States Objectives and Programs for National Security (National Security Council Paper-68), URL: https://info.publicintelligence.net/US-NSC-68.pdf.
[3] George Herring, The American Century and Beyond: U.S. Foreign Relations, 1893-2015, Oxford University Press 2017, p. 340.
[4] Cité dans: Cumings, The Origins of the Korean War, Volume 2: The Roaring of the Cataract 1947-1950, Yuksabipyungsa 2002, p. 750.
[5] James P. Cannon, Cannon to Truman in 1950: US out of Korea, URL: https://www.themilitant.com/2013/7712/771257.html
[6] Su-kyoung Hwang, Korea’s Grievous War, University of Pennsylvania Press 2016, p. 139.
(Article paru en anglais le 28 juillet 2023)