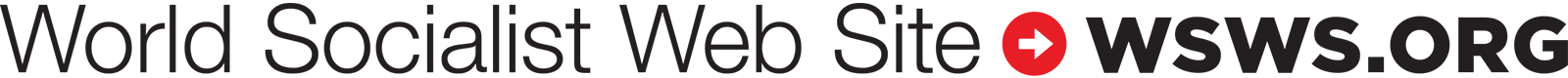Les responsables de l'Union européenne (UE) ont réagi jeudi aux droits de douane imposés au monde par l'administration Trump en se préparant à infliger des dizaines de milliards d'euros de tarifs sur les produits américains. Alors que Washington impose des taxes douanières de 20 pour cent sur tous les produits européens et de 25 pour cent sur les exportations automobiles, les relations entre les États-Unis et l'UE connaissent une rupture historique et une guerre commerciale est lancée qui menace de provoquer des attaques sans précédent contre les travailleurs américains, européens et internationaux.
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s'est exprimée vendredi matin depuis l'Ouzbékistan où elle participait à un sommet Asie centrale-UE. Elle a appelé Washington à des négociations tout en menaçant d'imposer une première série de droits de douane européens de 26 milliards d'euros. Demandant à Trump de «passer de la confrontation à la négociation», elle a déclaré: «Nous finalisons déjà un premier train de contre-mesures en réponse aux droits de douane sur l'acier. Et nous nous préparons désormais à d'autres contre-mesures pour protéger nos intérêts et nos entreprises en cas d'échec des négociations.»
Les biens et emplois en jeu sont considérables. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et l'UE ont atteint 1 600 milliards d'euros en 2023, dont 851 milliards d'euros de biens et 746 milliards d'euros de services. Si l'Europe a enregistré un excédent commercial de 153 milliards d'euros pour les biens, principalement dans les secteurs e l’automobile, des machines, de l'aérospatiale et des produits pharmaceutiques, elle a enregistré un déficit de 109 milliards d'euros pour les services, principalement dû aux achats de services auprès des banques et entreprises technologiques américaines. Les États-Unis et l'UE ont investi globalement plus de 5 000 milliards d'euros sur leurs marchés financiers réciproques.
La première vague de tarifs imposée par l'UE vise les produits américains comme les jeans, les motos Harley-Davidson, l'acier, l'aluminium et les produits agricoles. L'UE pourrait également invoquer son instrument anti-coercition (ACI), une loi de 2023 visant à coordonner les mesures de guerre commerciale contre les pays qui selon elle cherchent à exercer une coercition économique sur elle. Cela permettrait aux pays de l'UE de réduire les paiements aux banques et entreprises technologiques américaines pour les services financiers ou les droits de propriété intellectuelle.
Pour l'instant, l'incertitude règne dans les cercles dirigeants européens quant au type d'accord qu'ils peuvent négocier avec Trump et quant à la rapidité et l’intensité avec lesquelles les mesures de guerre commerciale vont saper l'économie européenne.
La banque néerlandaise ING estime qu'un tarif douanier américain de 25 pour cent réduirait de 19 pour cent les exportations de biens de l'UE vers les États-Unis. La valeur de ces pertes de ventes, environ 100 milliards d'euros, représente 0,87 pour cent du produit intérieur brut (PIB) de l'UE. Mais les répercussions économiques seraient bien plus vastes : les travailleurs des secteurs concernés seraient licenciés, leurs revenus et leur pouvoir d'achat s'effondreraient ; et les États-Unis et l'UE pourraient s'imposer mutuellement de nouvelles vagues de tarifs. ING a déclaré qu'il était « impossible » pour l'instant de quantifier l'effondrement économique que provoquerait ce « tsunami tarifaire ».
Les analystes financiers s'inquiètent des exportations automobiles allemandes, les droits de douane risquant de les exclure largement des marchés américains. «Les droits de douane sur les exportations automobiles représentent un défi majeur pour l'économie allemande», a déclaré Daniel Parker de Capital Economics. «Stuttgart, la Haute-Bavière et la région de Brunswick, qui comprend Wolfsburg, devraient être les plus durement touchées.» Les usines automobiles et les fournisseurs de pièces détachées en Allemagne et dans toute l'Europe, notamment en Slovaquie, en Hongrie et en Autriche, seraient eux aussi durement touchés.
Les responsables de l’UE, ainsi que de larges pans de l’establishment politique et des entreprises européennes, appellent Trump à la raison et à conclure un accord qui réconcilie les intérêts américains et européens.
Le président du Conseil de l'UE et ancien Premier ministre portugais, António Costa, a déclaré à Euronews :
Les relations commerciales [États-Unis-UE] représentent 30 pour cent du commerce mondial et 40 pour cent du PIB mondial. Elles n'affecteront donc pas seulement l'Europe et les États-Unis, mais tout le monde. C'est donc une grave erreur. […] Nous devons réagir avec fermeté, mais aussi avec intelligence. Cela signifie que nous devons parvenir à une solution négociée […] dans l'intérêt commun et mutuel des États-Unis et de l'Europe.
Quels que soient les accords conclus par l'UE avec Trump, ils ne rétabliront pas l'alliance américano-européenne ni l'équilibre économique tel qu'ils existaient dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale. Non seulement les intérêts impérialistes américains et européens s'opposent, mais les mesures de guerre commerciale aggraveront considérablement les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les travailleurs des deux côtés de l'Atlantique.
La politique étrangère de l'administration Trump est indéniablement hostile à l'Europe. Au-delà de ses tarifs douaniers, elle menace de prendre le Groenland au Danemark et vise à piller des centaines de milliards de dollars de ressources minérales ukrainiennes que l'UE espérait elle aussi s'approprier à l’issue du conflit russo-ukrainien. Le conflit entre les États-Unis et l'UE ne découle toutefois pas juste de l'état d'esprit du président d'extrême droite américain, mais de contradictions inter-impérialistes ayant des racines objectives entre l'Amérique et l'Europe.
La guerre commerciale de Trump marque une éruption de tensions entre États-Unis et Europe qui ont dégénéré par deux fois en guerres mondiales au XXe siècle. Elle vise à remédier au déclin économique relatif des États-Unis, en réduisant leurs déficits budgétaires et commerciaux croissants tout en défendant la domination militaire américaine par la consolidation de leurs chaînes d'approvisionnement militaires. Les puissances européennes, quant à elles, discutent depuis près de dix ans de comment consolider leur industrie et développer des forces militaires capables de rivaliser avec celles des États-Unis.
Alors que les gouvernements des deux côtés de l'Atlantique se préparent officiellement à des négociations, les déclarations hostiles se multiplient de part et d'autre. Hier, le ministre allemand de l'Économie par intérim, Robert Habeck, a dénoncé les tarifs de Trump, les comparant à l'invasion russe de l'Ukraine, à laquelle l'UE s'était opposée militairement. Ces droits de douane rappelaient «le début de notre mandat, notamment avec la guerre d'agression contre l'Ukraine et la situation menaçante du gaz naturel».
Jeudi, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a rencontré les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Bruxelles. Ceux-ci ont convenu d'un objectif de 5 pour cent du PIB pour l'armée, ce qui impliquerait des attaques sociales brutales contre les travailleurs européens. Mais des responsables américains se sont opposés au projet de l'UE de renforcer son industrie de défense par un plan de réarmement de 800 milliards d'euros, dont l’objectif est de mettre fin aux achats de systèmes d'armement américains par l'UE. Des diplomates européens ont exigé d'être consultés sur le projet américain de transférer des systèmes d'armement d'Europe vers le Pacifique pour cibler la Chine.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot s'était rendu en Chine la semaine dernière pour resserrer les liens avec Pékin sur la politique commerciale. Il avait demandé à son homologue chinois Wang Yi de contribuer à la levée des droits de douane imposés par la Chine sur les boissons alcoolisées françaises après le vote de la France en faveur de tarifs douaniers européens sur les véhicules électriques chinois, et de faire pression sur Moscou pour qu'elle inclue les puissances européennes dans les négociations avec l'Ukraine. Wang avait plaidé pour «le multilatéralisme plutôt que l'unilatéralisme» dans les affaires internationales, Barrot lui, avait déclaré que «plusieurs principes majeurs, notamment ceux du multilatéralisme, sont ébranlés».
Tandis que les conflits s'intensifient entre les puissances impérialistes, les travailleurs des deux côtés de l'Atlantique sont confrontés à des risques similaires d'atteintes croissantes à leurs droits sociaux et démocratiques fondamentaux. La première phase de la guerre commerciale menace les travailleurs américains de hausses de prix et licenciements dévastateurs, les travailleurs européens eux, sont ménacés de vastes pertes d'emplois. L'UE estime que 5 millions d'emplois en Europe dépendent des exportations vers les États-Unis et que 2,4 millions d'emplois américains dépendent des exportations vers l'Europe.
La guerre commerciale met la classe ouvrière face à face avec l'incompatibilité fondamentale d’une vie économique moderne et de forces productives mondialisées avec le système capitaliste des États-nations. Face à l'assaut social et économique à venir, il est crucial de rejeter les tentatives de la bourgeoisie de diviser la classe ouvrière selon des critères nationaux et d’inciter les travailleurs à soutenir la politique de guerre commerciale de leur propre gouvernement capitaliste.
Des luttes de classe explosives surgiront à mesure que les travailleurs s'opposeront aux attaques sociales découlant de la guerre commerciale et de la militarisation. L'enjeu crucial est d'unifier ces luttes au-delà des frontières nationales, notamment en unissant les travailleurs américains et européens dans une lutte socialiste de la classe ouvrière pour arracher le contrôle de la production économique des mains des oligarchies capitalistes rivales et pour la subordonner aux besoins de la société, et non au profit privé.
(Article paru en anglais le 4 avril 2025)