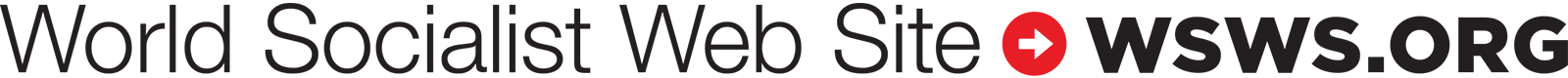Conférence tenue le 10 janvier 1998 à Sidney (Australie) dans le cadre de l’université internationale sur le marxisme et les problèmes fondamentaux du vingtième siècle.
Deux questions épineuses
Il y a dans l’histoire du mouvement marxiste deux problèmes politiques ou « questions » qui ont été à l’origine de controverses d’une exceptionnelle persistance et qui s’étendent sur plus d’un siècle : la « question nationale » et la « question syndicale ».
Pourquoi ces questions sont-elles si persistantes ? Existe-t-il un rapport entre ces deux questions ? Il me semble que la réponse est àchercher dans l’étude des conditions historiques àpartir desquelles s’est développé le mouvement ouvrier moderne. L’Etat-nation bourgeois, tel qu’il est sorti des luttes démocratiques révolutionnaires du dix-huitième et du dix-neuvième siècle, a donné l’impulsion économique et le cadre politique au développement de la classe ouvrière européenne et américaine. Le processus de consolidation des Etats nationaux était lié, bien que sous différentes formes et à divers degrés, à des problèmes démocratiques d’une grande importance pour la classe ouvrière.
L’attitude de la classe ouvrière envers la nation ne pouvait être que d’un caractère éminemment complexe, contradictoire et ambivalent. D’une part, l’augmentation en nombre et en force de la classe ouvrière et l’amélioration de son niveau de vie étaient d’une façon générale liées à la consolidation de l’Etat-nation et au développement de son pouvoir économique et industriel. Mais dans le même temps, le développement des luttes économiques et sociales de la classe ouvrière la mettait en contradiction avec l’Etat-nation qui servait, en fin de compte, les intérêts de classe de la bourgeoisie.
Le caractère épineux de la question nationale à l’intérieur du mouvement marxiste était surtout dû à la complexité du rapport entre les ouvriers et l’Etat-nation bourgeois. Nulle part au monde a-t-on assisté à un passage facile et organique des masses d’une conscience nationale à une conscience socialiste et internationale. Au cours d’une vie humaine, les expériences de jeunesse continuent d’exercer une puissante influence sur le reste de la vie. On remarque un phénomène analogue dans l’évolution historique de la conscience sociale des classes. L’attachement historique de la classe ouvrière au nationalisme s’explique par les conditions dans lesquelles elle est apparue et par les luttes des années formatrices. La conscience sociale est en retard sur un être social hautement complexe et contradictoire, ou pour mieux dire, elle ne le reflète pas directement et immédiatement d’une façon scientifique. De même, l’influence du nationalisme sur le mouvement ouvrier ne recule pas dans la même mesure et à la même vitesse que se renforce la prépondérance de l’économie mondiale sur l’Etat-nation et le caractère international de la lutte des classes.
La persistance de l’oppression nationale au vingtième siècle – bien que sa cause essentielle soit de caractère socio-économique – a renforcé des formes de conscience nationale. Mais malgré la force des influences nationales, les marxistes ont la responsabilité de baser leur programme non sur l’attrait de vieux préjugés et sur des conceptions dépassées, mais sur une analyse scientifique de la réalité sociale. L’adaptation d’un programme politique aux préjugés en vogue pour obtenir un avantage tactique à court terme est une des caractéristiques de l’opportunisme. Elle provient de calculs pratiques et conjoncturels et non de considérations historiques, scientifiques et relevant des principes.
Niant les conséquences politiques et économiques de la globalisation de la production sur l’Etat-nation, les opportunistes attribuent en général à cette forme politique historiquement dépassée un potentiel progressiste qu’elle ne possède pas du tout. Ils persistent àglorifier les revendications d’auto-détermination nationale malgré le fait qu’elles soient devenues le mot d’ordre de tous les mouvements chauvins et réactionnaires dans le monde.
Les marxistes ne nient pas l’importance de l’Etat-nation. Bien qu’il constitue, du point de vue du développement et de l’intégration mondiale des forces productives, un obstacle au progrès humain, il n’en demeure pas moins un facteur puissant dans la politique mondiale. Le mouvement socialiste tient compte des réalités politiques dans l’élaboration de sa tactique. Dans la mesure où l’Etat-nation subsiste comme unité de base de l’organisation politique et sociale de la société bourgeoise, la question nationale – on devrait peut-être parler dans l’actuelle étape historique de « problème national » – continue d’exister. Mais la tactique marxiste découle d’une compréhension scientifique du caractère historiquement dépassé de l’Etat-nation. Le mouvement trotskyste s’efforce à travers sa tactique de mettre en œuvre la stratégie fondamentale de la IVe Internationale comme parti mondial de la révolution socialiste. C’est cette insistance sur la suprématie de la stratégie internationale qui distingue le Comité International de la IVeInternationale de tous les groupes nationaux-réformistes et opportunistes.
Ces considérations de principe jouent avec tout autant de force dans la question des syndicats. Il s’agit là du rôle joué par ces très vieilles formes d’organisation prolétaire dans l’évolution des luttes révolutionnaires de la classe ouvrière pour le socialisme. Le prolétariat moderne est apparu dans le contexte du développement historique de l’Etat-nation. Ses organisations et ses activités ont pris forme dans le cadre de l’Etat-nation. Ce fut surtout le cas des syndicats, dont les progrès et la prospérité dépendaient, dans une large mesure, des réussites commerciales et industrielles de « leur » Etat-nation. De même qu’il existe des raisons historiques pour l’attitude ambivalente de la classe ouvrière envers l’Etat-nation, il existe des raisons objectives profondes pour l’ambivalence, l’hostilité même, des syndicats envers le socialisme. Il s’agit d’un problème qui a pendant plus d’un siècle causé d’énormes problèmes au mouvement socialiste.
Il n’était bien sûr pas possible de prévoir dès les premières années de leur existence la gravité des problèmes qui devaient hanter les rapports entre les partis marxistes et les syndicats. L’attitude adoptée par les marxistes envers les syndicats reflétait inévitablement les conditions et circonstances de l’époque. La question des syndicats ne se pose pas de la même façon en 1998 qu’en 1847. Il s’est passé beaucoup de choses au cours du dernier siècle et demi qui ont permis au mouvement socialiste de faire ample connaissance avec les syndicats. Celui-ci a appris beaucoup de choses sur leur nature, bien qu’on ne trouve aucune trace de ce savoir accumulé dans les pages de la presse « radicale » de gauche.
Pour une bonne partie de son histoire, le mouvement socialiste a fait la cour aux syndicats. Mais malgré tout son zèle vis-à-vis les syndicats, cette idylle s’est largement soldée par un échec. Malgré d’innombrables professions d’affection et de sollicitude, les prétendants socialistes ont régulièrement reçu de l’objet de leurs désirs des gifles, voire des poignards dans le dos. Et même lorsque les socialistes ont cherché à créer leurs propres syndicats et à leur donner une impeccable formation marxiste, leurs rejetons les ont repayés par la plus vile ingratitude. Dès que l’occasion s’est présentée, ils n’ont en général montré que dédain pour les nobles idéaux de leurs aînés socialistes et se sont repus au râtelier capitaliste.
Les socialistes doivent-ils se soumettre à l’autorité des syndicats ?
On pourrait croire qu’il y a quelque chose à apprendre de tant d’expériences désastreuses. Mais comme les vieux fous des contes de Boccace, les vieux radicaux édentés d’aujourd’hui ne sont que trop heureux de jouer et de rejouer le rôle du cocu. Ainsi, les organisations « de gauche » actuelles insistent pour dire que le mouvement socialiste a l’obligation d’être attentif aux besoins et aux caprices des syndicats. Les socialistes, insistent-ils, doivent reconnaître les syndicats comme l’organisation ouvrière par excellence, la forme qui correspond le mieux aux intérêts sociaux de la classe ouvrière. Selon eux, les syndicats constituent l’authentique et incontestable direction de la classe ouvrière, le principal et ultime arbitre de son destin historique. Mettre en question l’autorité des syndicats sur la classe ouvrière, questionner tant soit peu le soi-disant droit « naturel » des syndicats de parler au nom de la classe ouvrière est un sacrilège politique. Il est impossible, selon ces radicaux, de concevoir un véritable mouvement ouvrier qui ne soit pas dominé ou formellement dirigé par les syndicats. La lutte des classes ne peut être effectivement menée que sur la base des syndicats. Et finalement, le développement d’un mouvement socialiste de masse, dans la mesure où il subsiste un espoir qu’il voie le jour, exige que l’on « gagne » les syndicats, ou du moins une partie importante d’entre eux, à une perspective socialiste.
Le Comité international rejette chacune de ces affirmations qui sont réfutées tant par l’analyse théorique que par l’expérience historique. Aux yeux de nos adversaires politiques, notre refus de nous prosterner devant l’autorité des syndicats constitue un crime de lèse-majesté. Nous nous en soucions fort peu, ayant pris l’habitude depuis des décennies de nous opposer à l’opinion publique « de gauche » ou pour mieux dire, petite-bourgeoise. Nous considérons son acrimonieuse antipathie comme le meilleur signe que le Comité international est dans la bonne voie.
La position des radicaux repose sur une prémisse essentielle : du fait qu’ils ont une masse d’adhérents, les syndicats sont des « organisations ouvrières ». Celui qui défie l’autorité des syndicats se dresse donc, par définition, contre la classe ouvrière. Le problème avec cette prémisse est qu’elle réduit les syndicats à une abstraction vide et non historique. Il est certainement vrai que dans les syndicats il y a une masse d’ouvriers. Mais on peut en dire autant de beaucoup d’autres organisations aux Etats-Unis : la fraternité des Elks, les francs-maçons, les anciens combattants, l’Église catholique.
De plus, évoquer le grand nombre d’adhérents ouvriers des syndicats ne dispense pas d’une analyse précise de la composition sociale de ces organisations, surtout de leurs couches dirigeantes, de la bureaucratie qui les domine. Une appartenance nombreuse des ouvriers aux syndicats ne signifie pas forcément que ceux-ci agissent dans leurs intérêts. Il faut en effet examiner s’il existe à l’intérieur des syndicats un conflit objectif entre les intérêts de la masse de leurs membres et ceux de la bureaucratie qui les dirige et à quel point la politique des syndicats reflète non les intérêts de la première, mais plutôt ceux de la seconde.
Même si l’on admettait que les syndicats sont des « organisations ouvrières », l’usage d’une telle définition n’ajoute rien à nos connaissances politiques à leur sujet. Après tout, on pourrait continuer le jeu des définitions et demander : « Et qu’entend-on précisément par une organisation ouvrière » ? Il ne serait guère satisfaisant de répondre : « Des ouvriers organisés » ! Si l’on veut comprendre la nature des syndicats, la question essentielle est : « Quel est le rapport de ces organisations avec la lutte des classes en général, et avec l’émancipation des ouvriers de l’exploitation capitaliste en particulier ? »
Il faut ici dépasser une terminologie vide de sens et élaborer une définition plus en profondeur, basée sur une analyse historique précise du rôle joué par les syndicats dans les luttes de la classe ouvrière et du mouvement socialiste. Le but d’une telle analyse n’est pas simplement de fournir des exemples de leurs crimes ou de leurs réalisations, selon ce que l’on recherche. Il s’agit plutôt de découvrir l’essence de ce phénomène social, c’est-à-dire les lois sous-jacentes qui se manifestent de façon pratique dans l’action et la politique des syndicats.
Pourquoi les syndicats trahissent-ils la classe ouvrière ?
Nos adversaires radicaux n’ont jamais tenté une telle analyse ; ils sont donc tout à fait incapables de donner ne serait-ce qu’un début de réponse à la question la plus élémentaire et la plus évidente : « Pourquoi les syndicats ont-ils si misérablement échoué à défendre, sans même parler d’améliorer, le niveau de vie de la classe ouvrière ? » Le dernier quart de siècle a vu, non seulement aux Etats-Unis mais dans le monde entier, une chute abrupte dans la position sociale de la classe ouvrière. Les syndicats ont été incapables de défendre la classe ouvrière contre l’assaut du capital. Cet échec, visible à l’échelle mondiale et sur des décennies, nous contraint à en rechercher les causes profondes dans l’environnement socio-économique qui est celui des syndicats aujourd’hui et, plus fondamentalement, dans la nature même de ces syndicats. Autrement dit, en supposant que l’environnement soit soudainement devenu hostile après 1973, qu’y avait-il chez les syndicats qui les rendait si vulnérables à ce changement et si incapables de s’adapter aux nouvelles conditions ?
Considérons la réponse de la Spartacist League. Lors d’une furieuse attaque contre le Socialist Equality Party parue dans quatre numéros de leur journal et longue de plusieurs milliers de mots, où l’on relève une forte proportion d’adverbes et d’adjectifs injurieux, les spartacistes nient avec véhémence qu’il y ait des raisons objectives qui expliquent l’échec des syndicats. Tout doit au contraire s’expliquer par « la politique défaitiste et traître des dirigeants trompeurs de l’AFL-CIO ». On ne peut guère imaginer d’explication plus simpliste. Un paléontologue pourrait aussi bien dire que les dinosaures se sont éteints parce qu’ils n’avaient plus envie de vivre. Les spartacistes ont négligé d’expliquer pourquoi les dinosaures à la tête de l’AFL-CIO ont pris la décision de mener une « politique défaitiste et traître ». Était-ce simplement parce que ce sont de mauvaises gens ? Et s’ils étaient mauvais, pourquoi y en avait-il tant dans la direction des syndicats, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier ? Y a-t-il quelque chose dans la nature des syndicats qui attire tant de mauvaises gens qui font une « politique défaitiste et traître » ? On peut aussi se demander ce qui pousse la Spartacist League àsoutenir si vigoureusement des organisations qui attirent en si grand nombre des mauvaises gens qui passent leur temps à trahir et à faire battre les ouvriers qu’ils sont censés représenter.
Le problème posé par une telle approche subjective n’est pas seulement qu’elle esquive tous les problèmes réellement difficiles ; elle permet encore à la Spartacist League et aux autres groupes radicaux, nonobstant leur dénonciation des « dirigeants trompeurs » de garder ouverte la possibilité d’une conversion ; ils soutiennent ainsi la subordination permanente de la classe ouvrière aux syndicats et, finalement, à ces mêmes dirigeants trompeurs.
Cette perspective est explicite dans un article de Peter Taaffe, le principal dirigeant du British Socialist Party (l’ancienne Militant Tendency).[1] Les efforts faits par M. Taaffe pour déguiser son asservissement à la bureaucratie syndicale à l’aide de formules radicales sont plus comiques que convaincantes. Il donne d’abord une courte liste de tous les pays où la direction syndicale a été impliquée dans une trahison flagrante de la classe ouvrière. Comme l’inspecteur de police Louis dans le film Casablanca, Taaffe se montre profondément choqué de la corruption qu’il observe partout autour de lui, alors même que la bureaucratie lui glisse des récompenses politiques dans les poches. Le rôle des dirigeants syndicaux suédois, nous dit Taaffe, a été « scandaleux ». Le comportement des bureaucrates belges est « impudent et manifeste ». Les dirigeants irlandais offrent un « spectacle scandaleux » de trahison. En Grande-Bretagne déclare Taaffe, les ouvriers « ont payé un lourd prix pour l’impuissance des dirigeants droitiers ». Il fait remarquer avec regret la capitulation des dirigeants syndicaux au Brésil, en Grèce et aux Etats-Unis.
Mais pour Taaffe, le problème des syndicats se réduit à celui de chefs inadéquats qui souffrent d’une fausse idéologie : l’acceptation du marchécapitaliste. Les organisations elles-mêmes sont saines au fond. Sur la base de cette appréciation subjective, Taaffe critique les « groupuscules de gauche » autrement dit les sections du Comité international qui, se fondant sur Trotsky, insistent pour dire que la trahison des syndicats est l’expression d’une tendance fondamentale de leur évolution. Cette approche, « unilatérale » selon Taaffe, ne tient pas compte de la possibilité que des dirigeants syndicaux droitiers, « sous la pression de la base, d’une classe ouvrière mobilisée et en lutte » pourraient bien « être forcés de se dissocier de l’Etat et de diriger un mouvement d’opposition de la classe ouvrière ».[2]
Par conséquent, écrit Taaffe, la « principale tendance de la prochaine période » en Grande-Bretagne et ailleurs, sera celle d’ouvriers qui « forceront les syndicats à se battre pour leurs intérêts ». Le destin de la classe ouvrière dépend « de la régénération des syndicats ».[3]
Une des anciennes fractions du Workers Revolutionary Party avance un argument similaire. Elle insiste pour dire qu’il faut à tout prix éviter une lutte pour développer de nouvelles formes d’organisations ouvrières qui s’opposeraient à la domination des syndicats. « Toute politique simpliste invoquant la base et partant du principe abstrait que les dirigeants syndicaux couchent avec l’Etat et qu’il faille construire des organisations de rechange et les réunir, ne serait absolument pas à la hauteur des nouvelles conditions ».[4]
Je n’ai pas d’informations précises sur les rendez-vous nocturnes des chefs syndicaux en Grande-Bretagne ou ailleurs, mais leur opportunisme est tout sauf « abstrait », bien au contraire ; les patrons et l’Etat demandent quotidiennement aux dirigeants syndicaux de leur rendre des services perfides. Ils sont très rarement déçus.
La perspective que les syndicats finiront par se convertir apparaît bien plus ténue quand on comprend que les caractéristiques et les particularités de la bureaucratie dirigeante sont les manifestations subjectives de propriétés et de processus sociaux objectifs. Dénoncer les dirigeants syndicaux est permis et même nécessaire, mais seulement dans la mesure où cela ne remplace pas une analyse de la nature du syndicalisme.
Notre but est donc d’entreprendre une analyse du syndicalisme basée sur un examen historique des étapes décisives dans l’évolution de cette forme particulière du mouvement ouvrier. Le mouvement socialiste a assemblé ici, sur une période d’un siècle et demi, une immense expérience historique. Cette expérience lui donne tous les droits de se revendiquer le meilleur expert au monde et le plus éprouvé dans le domaine des syndicats.
Nous n’affirmons pas que le syndicalisme constitue une sorte d’erreur historique qui n’aurait jamais dû se produire. Il serait ridicule de nier qu’un phénomène aussi universel que le syndicalisme ne possédait pas de profondes racines dans la structure socio-économique de la société capitaliste. Il existe bien évidemment un clair lien entre le syndicalisme et la lutte des classes, mais seulement dans le sens que le conflit opposant les intérêts matériels des employeurs et ceux des ouvriers a poussé les ouvriers à s’organiser dans des syndicats. Il ne s’ensuit aucunement de ce fait objectif que les syndicats, en tant que forme particulière d’organisation socialement déterminée, s’identifient avec la lutte des classes (à laquelle, historiquement parlant, ils doivent leur existence) ou cherchent à la mener. L’histoire livre au contraire des preuves accablantes de ce qu’ils se consacrent bien plutôt à l’étouffer.
La tendance des syndicats à étouffer la lutte des classes a trouvé son expression la plus forte et la plus explicite dans leur attitude envers le mouvement socialiste. Aucune illusion n’a été plus tragique, surtout pour les socialistes, que l’idée que les syndicats étaient des alliés sûrs et même inévitables dans la lutte contre le capitalisme. Le développement organique des syndicats ne s’effectue pas en direction du socialisme, mais en opposition à lui. En dépit des circonstances qui ont conduit à leur apparition, c’est-à-dire même dans les pays où les syndicats devaient directement leur existence à l’initiative et à la direction des révolutionnaires socialistes, leur développement et leur consolidation ont inévitablement conduit à ce qu’ils s’opposent à la tutelle socialiste et s’efforcent avec résolution de s’en libérer. Seule une explication de cette tendance permet d’arriver à une compréhension scientifique du syndicalisme.
Les syndicats comme forme sociale
Il faut se souvenir que lorsque nous étudions le syndicalisme, nous traitons d’une forme sociale particulière. Il ne s’agit pas d’un assemblage éphémère, accidentel et informe d’individus, mais plutôt d’un rassemblement historiquement déterminé de gens organisés en classes et enraciné dans des rapports de production précis. Il est aussi important de réfléchir à la nature de la forme elle-même. Nous savons tous qu’il existe un rapport entre la forme et le contenu, mais cette relation se conçoit d’habitude comme si la forme n’était que l’expression du contenu. De ce point de vue, on pourrait concevoir la forme sociale comme n’étant que l’expression extérieure, plastique et infiniment malléable des relations sur lesquelles elle repose. Une meilleure compréhension des formes sociales permet de les voir comme des éléments dynamiques du processus historique. Dire que « le contenu se forme » signifie que la forme communique au contenu dont elle est l’expression des qualités et des caractéristiques bien précises. C’est à travers la forme que le contenu existe et se développe.
Cette excursion dans le royaume des catégories et des abstractions philosophiques deviendra peut-être plus parlante si on rappelle célèbre passage du premier chapitre du premier volume du Capital, où Marx demande : « D’où provient donc le caractère énigmatique du produit du travail, dès qu’il revêt la forme d’une marchandise ? Evidemment de cette forme elle-même. »[5] C’est-à-dire que lorsque le produit du travail prend la forme d’une marchandise – une transformation qui ne se produit qu’à un certain stade de développement de la société – il acquiert une certaine qualité, un caractère fétiche qu’il ne possédait pas auparavant. Lorsque les produits s’échangent sur le marché, les vrais rapports sociaux entre les hommes, dont les marchandises sont le résultat, prennent nécessairement l’apparence de rapports entre des choses. Le produit du travail est le produit du travail mais il acquiert pourtant de nouvelles propriétés sociales une fois qu’il prend, dans le cadre de nouveaux rapports de production, la forme d’une marchandise.
De même, un groupe de travailleurs est un groupe de travailleurs. Et pourtant, lorsque ce groupe prend la forme d’un syndicat, il acquiert, grâce à cette forme, de nouvelles propriétés sociales bien précises auxquelles les travailleurs sont inévitablement assujettis. Qu’est-ce que cela veut dire ? Les syndicats représentent la classe ouvrière dans un rôle socio-économique très distinct : comme vendeur d’une marchandise, la force de travail. Formés sur la base des rapports de production et des formes de propriété du capitalisme, les syndicats cherchent à obtenir pour cette marchandise le meilleur prix possible, compte tenu des conditions données du marché.
Bien sûr, il y a une immense différence entre ce que j’ai décrit en termes théoriques comme le « but essentiel » des syndicats et leurs activités concrètes dans le monde réel. La pratique réelle – l’abandon des intérêts les plus immédiats de la classe ouvrière – ne correspond guère aux « normes » conçues dans la théorie. Cette divergence ne contredit pas la conception théorique, mais elle est le résultat de la fonction socio-économique des syndicats. Sur la base des rapports de production capitalistes, les syndicats sont, par leur nature même, forcés d’adopter une attitude hostile envers la lutte des classes. Comme ils s’efforcent d’obtenir avec les employeurs des accords qui déterminent le prix de la force de travail et fixent les conditions générales dans lesquelles la plus-value sera extraite des ouvriers, les syndicats sont obligés de garantir que leurs membres fournissent leur force de travail selon les termes du contrat négocié. Comme le faisait remarquer Gramsci, « Les syndicats représentent la légalité et doivent viser à la faire respecter par leurs adhérents ».
La défense de la légalité signifie la répression de la lutte des classes. C’est pourquoi les syndicats sapent en fin de compte leur capacité à atteindre les buts limités qui sont officiellement les leurs. C’est cette contradiction qui cause l’échec du syndicalisme. Le conflit entre les syndicats et le mouvement révolutionnaire ne provient pas, fondamentalement, des fautes et faiblesses des dirigeants syndicaux – bien que cela ne manque pas – mais plutôt de la nature des syndicats eux-mêmes. Au cœur de ce conflit il y a l’opposition organique des syndicats au développement et à l’extension de la lutte des classes. Cette opposition devient d’autant plus acerbe, consciente et mortelle que la lutte des classes menace les rapports de production du capitalisme, c’est-à-dire les fondements socio-économiques du syndicalisme même.
Cette opposition, de plus, se concentre sur le mouvement socialiste qui représente la classe ouvrière, non pas dans son rôle étroit de vendeur de sa force de travail, mais dans sa qualitéhistorique d’antithèse révolutionnaire aux rapports de production capitalistes.
Ces deux aspects déterminants du syndicalisme – sa tendance à la répression de la lutte des classes et son hostilité au mouvement socialiste – ont été amplement confirmés par l’histoire. Sous ce rapport, l’histoire des syndicats en Angleterre et en Allemagne comporte des vues et des leçons importantes.
Le syndicalisme en Angleterre
On considère généralement l’Angleterre comme le berceau du syndicalisme moderne, le pays où, grâce à cette forme d’organisation, la classe ouvrière a accompli des progrès remarquables. Telle fut en effet l’impression que les syndicats firent sur Eduard Bernstein au cours de son séjour prolongé en Angleterre à la fin des années 1880 et dans les années 1890. Les prétendus succès des syndicats anglais convainquirent Bernstein que les luttes économiques de ces organisations, et non les efforts politiques du mouvement révolutionnaire, seraient l’élément décisif dans les avancées faites par la classe ouvrière et dans le passage graduel de la société au socialisme.
Tout ce qui est dit actuellement par les radicaux petits-bourgeois fut déjà dit il y a un siècle par le fondateur du révisionnisme moderne. Le fait que leurs arguments datent d’un siècle ne les rend pas, en soi, incorrects. J’admets volontiers que certains des arguments que j’utilise sont eux aussi centenaires, par exemple ceux avancés par Rosa Luxemburg contre Bernstein. Ces derniers ont cependant l’avantage de s’être vu justifiés au cours du siècle dernier, alors que ceux des néo-bernsteiniens ont été réfutés. En fait, les critiques de Bernstein notaient alors que son estimation des réussites économiques du syndicalisme anglais était nettement exagérée. En fait, l’ascendance du syndicalisme, dont la montée dans le mouvement ouvrier pour y jouer le rôle dominant avait commencé dans les années 1850, était une manifestation de la dégénérescence politique et de la stagnation intellectuelle qui suivirent la défaite du grand mouvement politique révolutionnaire de la classe ouvrière anglaise, le chartisme. Le mouvement chartiste représentait la culmination d’une fermentation politique, intellectuelle et culturelle qui toucha de larges couches de la classe ouvrière dans les décennies qui suivirent la révolution française. Longtemps après la défaite finale du chartisme en 1848-1849, Thomas Cooper, un de ses représentants les plus respectés, opposait l’esprit du vieux mouvement à la morne perspective petite-bourgeoise adoptée par les syndicats. Il écrivit dans son autobiographie :
Dans notre vieille époque chartiste, il est vrai, les ouvriers du Lancashire étaient en haillons et beaucoup manquaient souvent de nourriture. Mais leur intelligence était partout manifeste. On les voyait en groupes, discutant de la grande doctrine de la justice politique – que chaque adulte, que chaque homme, que toute personne sensée devait pouvoir voter aux élections des hommes qui feraient les lois selon lesquelles il serait gouverné. Ou bien, ils discutaient sérieusement les enneigements du socialisme. Vous ne verrez plus de tels groupes dans le Lancashire. Mais vous verrez des ouvriers bien habillés, les mains dans les poches, parler de leurs parts dans les coopératives et de sociétés de crédit foncier.[6]
Une nouvelle variété de chef ouvrier émergeait en même temps que les syndicats : le gentleman timide, avide de respectabilité bourgeoise et qui prêchait le nouvel évangile du compromis de classe prit la place du vieux chartiste révolutionnaire. Selon Theodore Rothstsein, un historien socialiste du chartisme :
Des hommes de grand talent, de grand tempérament, de grande et de profonde érudition, qui peu d’années auparavant avaient ébranlé les bases mêmes de la société capitaliste et avaient attiré des centaines de milliers d’ouvriers, étaient pour lors devenus des figures solitaires se mouvant dans l’obscurité, incompris par la majorité, compris seulement par les petits groupes d’élus, pendant que leurs places étaient prises par des hommes nouveaux ne possédant pas une fraction de leur intelligence, de leur talent, et de leur caractère, et qui de même attiraient des centaines de milliers d’ouvriers attirés par l’évangile superficiel de « comptez vos sous » et la nécessité d’arriver à un accord avec l’employeur sur ce sujet, même au prix de l’indépendance de classe.[7]
Rothstein évalue ainsi le syndicalisme :
L’élément distinctif de cette mentalité était l’acceptation de la société capitaliste, laquelle acceptation s’exprimait par le refus de l’action politique et la reconnaissance de la vulgaire économie politique de l’harmonie des intérêts des employeurs et de la classe ouvrière.[8]
Les défenseurs des syndicats ont argumenté que l’abandon de la lutte politique par les ouvriers anglais était nécessaire pour permettre à cette classe de concentrer son énergie sur les possibilités plus prometteuses offertes par la lutte économique. Cette théorie est réfutée par le fait que la montée du syndicalisme n’est pas allée de pair avec une intensification des luttes économiques mais plutôt avec leur répudiation générale par les nouveaux dirigeants de la classe ouvrière. Entre le début des années 1870 et le milieu des années 1890, les beaux jours du syndicalisme anglais, les salaires des ouvriers ont stagné. Que le syndicalisme n’ait pas été discrédité à cette époque s’explique par la forte baisse simultanée du prix des aliments de base, tels que la farine, les pommes de terre, le pain, la viande, le thé, le sucre, et le beurre.
Pendant les premières décennies du dix-neuvième siècle, alors que les sentiments révolutionnaires étaient très répandus chez les ouvriers, la bourgeoisie anglaise s’était âprement opposée à toute tentative d’organisation. Mais à la fin du siècle, elle en était venue à apprécier le service rendu par les syndicats dans la stabilisation du capitalisme – principalement leur rôle de barrière à la réapparition de tendances socialistes dans la classe ouvrière. Selon l’économiste allemand bourgeois, Brentano, si les syndicats devaient connaître un échec en Angleterre, cela ne
signifierait aucunement le triomphe des employeurs. Cela signifierait le raffermissement des tendances révolutionnaires partout dans le monde. L’Angleterre, qui jusqu’alors se vantait de l’absence d’un parti ouvrier révolutionnaire important, rivaliserait désormais en cela avec le Continent.[9]
Marx et Engels vécurent en exil en Angleterre durant la période de la montée des syndicats. Même avant leur arrivée en Angleterre, ils avaient reconnu l’importance du syndicalisme comme réponse de la classe ouvrière aux tentatives des employeurs de réduire leurs salaires. S’opposant au théoricien petit-bourgeois Pierre-Joseph Proudhon qui niait l’utilité et des syndicats et des grèves – affirmant que les augmentations de salaire obtenues par leurs efforts n’entraînaient que des hausses des prix – Marx insistait pour dire qu’ils constituaient deux composantes nécessaires de la lutte de la classe ouvrière pour défendre son niveau de vie.
Marx avait certes raison de critiquer les opinions de Proudhon, mais il faut se rappeler que ces premiers écrits datent de l’enfance des syndicats. La classe ouvrière n’avait qu’une expérience très limitée de cette nouvelle forme d’organisation. On ne pouvait alors écarter la possibilité que les syndicats ne se transforment un jour en instruments puissants de la lutte révolutionnaire ou du moins en précurseurs directs de tels instruments. Un tel espoir s’exprime dans l’observation de Marx en 1866 que comme « centres d’organisation » les syndicats jouaient pour la classe ouvrière le même rôle « que les communes et les municipalités du Moyen Âge… jadis pour la classe bourgeoise ».[10]
Marx s’inquiétait cependant déjà de ce que « les syndicats… ne sont pas encore tout à fait conscients de la force qu’ils représentent contre le système lui-même de l’esclavage salarié ». Mais il fallait qu’ils évoluent dans cette direction.
À part leur œuvre immédiate de réaction contre les manœuvres tracassières du capital, ils doivent agir maintenant comme foyers d’organisation de la classe ouvrière dans le grand but de son émancipation complète. Ils doivent soutenir tout mouvement politique et social tendant dans cette direction.
En se considérant et en agissant eux-mêmes comme les champions et les représentants de toute la classe ouvrière, ils réussiront à regrouper dans leur sein tous ceux qui ne sont pas organisés. Ils doivent s’occuper avec le plus grand soin des intérêts des métiers les plus mal payés, notamment des ouvriers agricoles que des circonstances particulièrement défavorables empêchent d’organiser une résistance organisée. Ils doivent faire naître ainsi la conviction dans les grandes masses ouvrières qu’au lieu d’être circonscrit dans des limites étroites et égoïstes, leur but tend à l’émancipation des millions de prolétaires foulés aux pieds.[11]
Marx cherchait à donner aux syndicats une orientation socialiste. Il encourageait les travailleurs à « ne pas s’exagérer » l’importance de la lutte engagée par les syndicats. Les syndicats ne devaient pas oublier qu’ils « luttent contre les effets et non contre les causes de ces effets, qu’ils ne peuvent que retenir le mouvement descendant, mais non en changer la direction, qu’ils n’appliquent que des palliatifs, mais sans guérir le mal ». Il était nécessaire que les syndicats entreprennent une lutte contre le système responsable de la misère des ouvriers ; Marx proposa donc aux syndicats qu’ils abandonnent leur mot d’ordre conservateur « Un salaire équitable pour une journée de travail équitable », et qu’ils« inscrivent sur leur drapeau le mot d’ordre révolutionnaire : ‘Abolition du salariat’ ».[12]
Mais les opinions de Marx ne firent pas grande impression et à la fin des années 1870 les commentaires de Marx et d’Engels sur les syndicats avaient pris un ton nettement plus critique. Alors que les économistes bourgeois exprimaient une sympathie grandissante pour les syndicats, Marx et Engels eurent grand soin de relativiser leur précédente approbation. Ils distinguèrent leur point de vue de celui de penseurs bourgeois tels que Lujo Brentano, dont l’enthousiasme pour les syndicats était dicté, selon Marx et Engels, par son désir de faire « des esclaves salariaux des esclaves salariaux satisfaits ».[13]
En 1879, on pouvait noter dans les écrits d’Engels à propos des syndicats un net ton de dégoût. Il faisait remarquer que les syndicats avaient introduit des statuts organisationnels qui interdisaient toute action politique, empêchant ainsi « toute participation à toute activité générale de la classe ouvrière en tant que classe ». Dans une lettre à Bernstein datée du 17 juin 1879, Engels se plaignait de ce que les syndicats avaient mené la classe ouvrière dans une impasse.
On ne doit pas dissimuler le fait qu’il n’existe pas au moment présent, ici, de véritable mouvement ouvrier au sens où il existe sur le continent, et je ne crois donc pas que vous manquerez grand-chose si dans un premier temps vous ne recevez pas de rapport sur les activités des syndicats d’ici.[14]
Dans un article écrit six ans plus tard pour contraster l’Angleterre de 1885 et celle de 1845, Engels ne prenait pas la peine de cacher son mépris pour le rôle conservateur joué par les syndicats. Formant une aristocratie à l’intérieur de la classe ouvrière, ils cultivaient les relations les plus amicales avec les employeurs pour s’assurer des positions confortables. Les syndicalistes, écrivit Engels avec un sarcasme mordant, « sont effectivement des interlocuteurs très affables pour tout capitaliste raisonnable pris individuellement et pour la classe capitaliste en général ».[15]
Les syndicats avaient pratiquement ignoré la masse des travailleurs pour qui l’état de misère et de précarité dans lequel ils vivent est aussi bas qu’il l’a jamais été, sinon plus bas encore. L’East-End de Londres est un cloaque grandissant de misère et de désolation, de famine lorsqu’ils sont sans travail et de dégradation physique et morale lorsqu’ils ont du travail.[16]
Les espoirs d’Engels furent réveillés, à la fin des années 1880, par le développement d’un nouveau mouvement syndicaliste militant parmi les couches les plus exploitées de la classe ouvrière. Des socialistes, y compris Eleanor Marx, étaient actifs dans ce nouveau mouvement. Engel réagit avec enthousiasme et satisfaction à ces développements.
Ces nouveaux syndicats composés d’hommes et de femmes non qualifiés sont entièrement différents des vieilles organisations de l’aristocratie ouvrière et ne peuvent suivre le même chemin conservateur… Et ils s’organisent dans des circonstances tout à fait différentes – tous les hommes et les femmes qui les dirigent sont des socialistes, et qui plus est des agitateurs socialistes. En eux, je vois le véritable début du mouvement ici.[17]
Mais il ne fallut pas longtemps pour que ces « nouveaux » syndicats adoptent les mêmes tendances conservatrices que les anciens. Ce fut une vérification précoce de la conception théorique que nous considérons décisive pour l’analyse des syndicats : que la nature de ces institutions n’est pas déterminée par la position sociale et le statut de groupes particuliers d’ouvriers qui y sont organisés. Ce sont des facteurs qui n’influencent tout au plus que certains aspects secondaires de la politique syndicale et rendent peut-être certains syndicats plus, ou moins, militants que la moyenne. Mais en dernière analyse, la forme du syndicat qui découle des rapports sociaux et de production du capitalisme – à quoi il faut ajouter le cadre de l’Etat-nation – et y est intégré, exerce une influence décisive qui détermine l’orientation de son « contenu », c’est-à-dire de ses membres ouvriers.
La social-démocratie allemande et les syndicats
Sur le continent, en Allemagne surtout, on tirait des conclusions théoriques de ces premières expériences avec le syndicalisme. Les socialistes allemands considéraient les syndicats anglais, non comme des précurseurs du socialisme, mais comme l’expression organisationnelle de la domination politique et idéologique de la classe ouvrière par la bourgeoisie. Cette attitude critique n’était pas seulement le fait d’une compréhension théorique, elle reflétait aussi un rapport de forces très différent dans le mouvement ouvrier entre le parti politique marxiste et les syndicats. En Allemagne, l’impulsion pour le développement d’un mouvement ouvrier de masse n’était pas venue des syndicats mais du Parti social-démocrate qui avait réussi entre 1878 et 1890 – la période des lois antisocialistes de Bismarck – à devenir la direction reconnue de la classe ouvrière. A l’initiative du SPD, on fonda des syndicats dits « libres » principalement comme base de recrutement pour le mouvement socialiste.
L’influence des syndicats, épaulés par le SPD dont ils tiraient leurs dirigeants et leurs conceptions politiques, commença à s’étendre dans les années 1890. Mais les effets prolongés d’une longue dépression industrielle imposaient des limites au nombre de leurs adhérents et en 1893 encore, le rapport entre électeurs sociaux-démocrates et syndicalistes était de huit à un. Au SPD, on exprima néanmoins la crainte que les syndicats puissent chercher à rivaliser avec le parti dans l’influence sur la classe ouvrière. Les syndicats nièrent fortement avoir de telles intentions et leur dirigeant, Carl Legien, les qualifia en 1893, au congrès du parti à Cologne, d’ « écoles préparatoires » du parti et de « meilleur moyen d’agitation » de celui-ci.
En 1895 toutefois, avec la reprise économique, les syndicats allemands grandirent rapidement et le nouveau rapport de forces aggrava les tensions entre le parti et les syndicats. En 1900, le nombre de leurs membres atteignait 600.000. Quatre ans plus tard, il atteignait le million. Plus l’écart baissait entre le nombre des électeurs du SPD et celui des membres des syndicats, plus augmentait la dépendance du SPD par rapport aux syndicats.
Si les dirigeants syndicaux ont évité d’apporter leur soutien politique àBernstein alors qu’il déployait l’étendard du révisionnisme, il était largement entendu dans le parti que ses théories ne pouvaient mener qu’à une réorientation du mouvement socialiste allemand selon le modèle anglais, où les syndicats réformistes supplanteraient le parti politique révolutionnaire comme axe principal du mouvement ouvrier.
Dans leurs polémiques contre Bernstein, les principaux théoriciens du SPD faisaient particulièrement attention à ses efforts pour dépeindre les syndicats comme l’indispensable bastion du mouvement socialiste. C’est Rosa Luxemburg qui joua le premier rôle dans ce combat. Son œuvre principale sur ce sujet est Réforme ou Révolution, où elle ne fait qu’une bouchée de l’affirmation de Bernstein selon laquelle les efforts des syndicats contrecarrent efficacement les mécanismes d’exploitation du capitalisme et mènent, bien que lentement, à une socialisation de la société. Luxemburg souligna que c’était tout simplement faux : l’activité des syndicats ne menait pas à l’abolition de l’exploitation. Cette activitécherchait au contraire àassurer que le prolétariat reçoive dans le cadre de l’exploitation capitaliste, sous forme de salaire, le meilleur prix permis par le marché.
Ce que pouvait réaliser l’activité des syndicats en matière d’augmentation du salaire ouvrier trouvait ses limites dans les fluctuations du marché et la dynamique générale de l’expansion capitaliste. La société capitaliste, prévenait Luxemburg, n’allait pas « au-devant d’une époque de développement victorieux de ses forces mais de difficultés croissantes du mouvement syndical. »[18] Ainsi, quelles que soient les avancées provisoires obtenues par les syndicats, ils se vouaient, dans la mesure où leur action restait dans les limites du système capitaliste, à un « travail de Sisyphe ». Les dirigeants syndicaux ne pardonnèrent jamais à Luxemburg cette métaphore bien sentie qui offrait une évaluation si terriblement juste et presciente de l’activité des syndicats.
Ce résumé rend à peine justice à l’analyse par Luxemburg des raisons pour lesquelles les syndicats pouvaient tout au plus atténuer, et ce temporairement, l’exploitation de la classe ouvrière dans le capitalisme. Sa critique de Bernstein est particulièrement pertinente quand elle nie que l’activité des syndicats soit intrinsèquement ou implicitement socialiste ou que leur travail contribue nécessairement à la victoire de la cause socialiste. Luxemburg ne niait pas que les syndicats, dans la mesure où ils étaient dirigés par des socialistes, pouvaient rendre des services importants au mouvement révolutionnaire. Elle espérait y contribuer par sa critique (nous traiterons ailleurs la question de savoir si ce but était réalisable). Mais elle mettait en garde contre toute illusion qu’il puisse exister des tendances socialistes organiques dans le mouvement syndical en tant que tel.
Précisément les syndicats anglais, écrivait Luxemburg,
dont le représentant classique est l’ouvrier-gentleman rassasié, correct, étroit, borné, pensant et sentant bourgeoisement, prouv[ent], par conséquent que le mouvement syndical en soi n’a encore rien de socialiste et que, même, dans certaines circonstances, il peut constituer une entrave directe au développement de la conscience socialiste, de même qu’au contraire, la conscience socialiste peut être, dans certaines conditions, un obstacle à l’obtention de résultats purement syndicaux.[19]
Ce passage est aujourd’hui encore une réplique cinglante à tous ceux qui s’adaptent servilement aux syndicats et à leur bureaucratie et ne peuvent concevoir un mouvement ouvrier autrement que sous forme syndicale. Il démontre clairement qu’il n’existe aucun lien implicite ou indissoluble entre le syndicalisme et le socialisme. Ils ne suivent pas tous deux, par nécessité, des trajectoires parallèles vers un même but général. Le syndicalisme, qui est par nature « complètement non-socialiste » comme l’a noté Luxemburg, sape au contraire le développement de la conscience socialiste. De plus, les principes politiques des socialistes, qui exigent qu’ils basent leurs actions sur les intérêts historiques de la classe ouvrière, vont à l’encontre des objectifs pratiques des syndicats.
En Angleterre, les syndicats se sont développés sur les ruines du chartisme et indépendamment du mouvement socialiste. En Allemagne en revanche, les syndicats sont apparus sous l’influence directe du mouvement socialiste. Leurs dirigeants étaient assidûment formés à l’école de Marx et d’Engels. Et pourtant, les syndicats allemands ne s’avérèrent en fin de compte pas plus attachés au socialisme que les syndicats anglais. Au tournant du siècle, enhardis par l’affluence de centaines de milliers de nouveaux membres, les syndicats montrèrent leur aversion face à l’influence politique du parti et leur subordination à ses buts politiques. Cela s’exprima par un nouveau programme : celui de la neutralitépolitique. Un nombre grandissant de chefs syndicaux se mit à argumenter qu’il n’y avait pour leurs organisations aucune raison les obligeant à se montrer particulièrement loyales vis-à-vis des campagnes du SPD. En fait, insistaient-ils, la domination du SPD privait les syndicats de la possibilité de recruter des membres parmi les ouvriers se désintéressant de la politique socialiste ou s’y opposant. Parmi les représentants les plus importants de cette tendance, Otto Huéinsistait pour dire que les syndicats ne pouvaient servir les « intérêts professionnels (non de classe) » de leurs membres que s’ils adoptaient une position neutre sur le plan politique. Hué déclara : « Vers quelle destination politique la neutralitésyndicale conduit les ouvriers, peut et doit être d’une profonde indifférence pour les dirigeants syndicaux. »
Les syndicats et la grève de masse
Entre 1900 et 1905, les tensions augmentèrent entre le parti et les syndicats. Les chefs syndicaux continuaient, en tant que délégués aux congrès du SPD, de voter en faveur de l’orthodoxie socialiste. Leur hostilité innée au socialisme comme mouvement révolutionnaire n’avait pas encore atteint le point où ils étaient prêts à s’opposer ouvertement à l’objectif politique de lutte pour le pouvoir du SPD. Tout changea avec les événements de 1905, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Allemagne.
L’explosion révolutionnaire qui eut lieu en Russie affecta fortement la classe ouvrière allemande. Les travailleurs suivaient avec un immense intérêt les nouvelles détaillées des luttes révolutionnaires publiées par la presse socialiste. De plus, une vague de grèves acharnées coïncidant avec les événements russes et inspirée par eux, se produisit dans toute l’Allemagne, surtout dans les mines de la Ruhr. Les propriétaires des mines opposèrent une résistance farouche au militantisme des ouvriers. Les syndicats furent pris de court par l’intransigeance du patronat des mines, à laquelle ils n’avaient aucune réponse efficace. Les grèves furent annulées, ce qui ébranla la confiance des ouvriers dans la tactique syndicale traditionnelle.
Dans cette nouvelle situation Luxemburg, soutenue par Kautsky, argumenta que les événements de Russie avaient une importance paneuropéenne et avaient révélé aux travailleurs allemands le potentiel d’une nouvelle forme de lutte de masse : la grève politique. L’idée d’une grève politique de masse eut beaucoup de soutien dans la classe ouvrière. Mais les chefs syndicaux furent horrifiés par les implications des arguments de Luxemburg. Si les ouvriers suivaient les théories de Luxemburg, les syndicats se trouveraient embarqués dans des « aventures révolutionnaires » qui n’intéressaient aucunement les fonctionnaires syndicaux. Des grèves de masse coûteraient d’immenses sommes aux syndicats et feraient disparaître de leurs comptes en banque les réserves d’argent dont leurs chefs étaient si fiers.
Pour empêcher une telle catastrophe, les dirigeants des syndicats décidèrent de lancer une attaque préventive contre Luxemburg et les autres radicaux du SPD. Au congrès syndical tenu à Cologne en mai 1905, on établit une commission spéciale pour préparer un rapport qui définirait l’attitude des syndicats à l’égard de la grève de masse. Le chef de cette commission, Theodore Bömelberg, déclara :
Mais pour mieux construire notre organisation, il nous faut le calme dans le mouvement ouvrier. Nous devons faire en sorte que cesse dans le mouvement syndical allemand la discussion [sur la grève de masse] et qu’on s’occupe de la résolution de l’avenir au moment approprié.[20]
Le congrès syndical adopta une résolution qui était en réalité une déclaration de guerre à l’aile gauche du SPD et qui disait que la discussion sur une grève de masse était interdite à l’intérieur des syndicats. Elle appelait les ouvriers à « ne pas se laisser distraire des petites tâches quotidiennes destinées à renforcer les organisations ouvrières par la diffusion de telles idées ».[21]
Le SPD fut ébranlé par la révolte des chefs syndicaux contre le parti. Kautsky déclara que le congrès avait révélé l’ampleur de l’aliénation des syndicats vis-à-vis du parti, et qu’ « il y avait une étrange ironie du destin dans le fait qu’au congrès des syndicats le souhait de tranquillité des syndicats soit proclamé dans une année qui était plus révolutionnaire que toute autre depuis une génération ». Il était évident pour Kautsky que « les syndicalistes commençaient à trouver plus important d’avoir des caisses remplies que de se préoccuper de la qualité morale des masses ».
La haine des chefs syndicaux envers l’aile gauche du SPD prit des dimensions pathologiques. Rosa Luxemburg en particulier devint la cible continuelle de leurs attaques virulentes. Otto Hué, l’éditeur du journal du syndicat des mineurs, encourageait tous ceux qui souffraient d’un tel « excès d’énergie ‘révolutionnaire’ » à se rendre en Russie « au lieu de lancer des discussions sur la grève générale depuis leurs stations balnéaires. »[22] Les attaques contre Luxemburg s’intensifièrent alors même qu’elle croupissait dans une prison polonaise après avoir été arrêtée pour ses activités révolutionnaires. Écœuré par ces violentes attaques personnelles contre celle qui était encore une amie et une alliée, Kautsky dénonça la persécution d’une pionnière « de la lutte de classe prolétarienne ». Ce n’était pas Luxemburg, écrivait-il, qui menaçait les relations entre le parti et les syndicats, mais bien plutôt « la haine bornée de ces éléments vis-à-vis de toute forme du mouvement ouvrier qui se fixe un but plus élevé qu’une augmentation de cinq centimes de l’heure ».[23]
Pendant un temps, la direction du SPD s’opposa aux chefs syndicaux, mais aussi prudemment que possible. Au congrès du parti à Iéna, en septembre 1905, Bebel présenta une résolution habilement rédigée qui reconnaissait en partie la validité d’une grève politique de masse mais seulement comme arme défensive. En retour, les syndicats acceptèrent la formulation de Bebel mais pour un temps seulement. Au congrès du parti à Mannheim, en septembre 1906, les dirigeants syndicaux exigèrent et obtinrent du SPD le passage d’une résolution qui établissait le principe de l’ « égalité » entre les syndicats et le parti. Cela signifiait que sur toutes les questions touchant aux affaires qui concernaient directement les syndicats, le parti devait élaborer une politique qui leur serait acceptable. Malgré des objections vigoureuses, les chefs du parti collaborèrent étroitement avec les représentants syndicaux pour étouffer bureaucratiquement la discussion et firent passer la résolution en force.
Dès lors, le SPD fut effectivement gouverné par la commission générale des syndicats. Luxemburg notait que les relations entre le parti et les syndicats étaient comme celles de la mégère paysanne disant à son mari : « Quand des conflits surgiront entre nous, on fera comme ça : quand nous tomberons d’accord, c’est toi qui décideras. Quand nous ne serons pas d’accord, c’est moi qui déciderai. »
Dans leurs conflits avec Luxemburg et les forces révolutionnaires à l’intérieur du SPD, les chefs syndicaux affirmaient volontiers qu’ils avaient une bien meilleure idée que les théoriciens révolutionnaires de ce que voulait l’ouvrier moyen. Préoccupés par leurs abstractions et visions utopiques, Luxemburg et les révolutionnaires de son acabit n’avaient pas vraiment de réponses pratiques aux problèmes auxquels étaient confrontés les ouvriers dans les mines et les usines. C’était bien beau de la part des théoriciens de rêver à un futur cataclysme révolutionnaire et à l’utopie socialiste qui en sortirait, mais pour ce qui était de l’ici et du maintenant, les ouvriers trouvaient bien plus important d’avoir quelques marks supplémentaires sur leur bulletin de paie.
Il est sans doute vrai que les arguments des chefs syndicaux reflétaient l’attitude qui fut celle d’importantes couches d’ouvriers dans les années où éclata le débat sur la grève de masse. Il est même possible que si les ouvriers avaient pu voter sur la question en 1905 ou 1906, davantage auraient voté en faveur de la position de Legien que de celle de Luxemburg. Mais quand on considère l’attitude des ouvriers dans le conflit entre les marxistes et les chefs syndicaux réformistes, il faut se rappeler ceci : les représentants syndicaux étaient pour ainsi dire « engagés » institutionnellement et constitutionnellement à une politique qui partait de la dépendance organique des syndicats vis-à-vis des rapports de production capitalistes et de la structure institutionnelle de l’Etat-nation. La classe ouvrière n’était pas elle, en tant que force sociale révolutionnaire, pareillement attachée au programme gradualiste d’adaptation réformiste.
Le développement des contradictions internes du système capitaliste désagrégea le tissu du compromis social en Allemagne. Les tensions de classe s’aggravant, les ouvriers adoptèrent une attitude plus hostile et plus agressive face aux employeurs et à l’Etat. En 1910 -1911, il y eut de claires indications que les arguments de Luxemburg commençaient à trouver un écho dans de larges couches de la classe ouvrière. Surtout à la suite des grèves de 1912-1913 qui échouèrent face à l’âpre résistance des employeurs, le mécontentement des ouvriers augmenta à l’égard des syndicats officiels.
Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en août 1914 interrompit provisoirement ce processus de radicalisation. En 1915-1916 cependant, le mécontentement social exacerbé par la guerre submergea les digues élevées par les syndicats. Les vieux arguments bureaucratiques contre la grève politique de masse reçurent finalement leur réponse dans le déclenchement de la révolution allemande en octobre et novembre 1918. Ainsi que Luxemburg l’avait prévu théoriquement et que la révolution russe l’avait anticipé dans la pratique, le caractère révolutionnaire du mouvement de masse se manifesta dans de nouvelles formes d’organisation – les comités de base et en particulier les conseils ouvriers – qui étaient issues de l’opposition aux syndicats officiels.
Les expériences de la classe ouvrière anglaise et allemande représentent le plus grand test historique du syndicalisme. Nous pourrions, si nous avions assez de temps, complémenter et développer notre analyse des conflits entre le socialisme et le syndicalisme par d’innombrables exemples tirés de bien des pays et couvrant toutes les décennies du siècle, jusqu’à la période présente.
La nécessité de la conscience socialiste
Le but de cette conférence n’est pas de fournir autant d’exemples que possible de la trahison des syndicats. Il est plutôt de confirmer la nécessité de la conscience socialiste et de la lutte pour développer celle-ci dans la classe ouvrière. C’est là que réside la signification du parti marxiste révolutionnaire. Même si une renaissance de militantisme syndical spontanédevait avoir lieu (et une telle chose serait impossible sans rébellion de la base contre les vieilles institutions bureaucratiques), le développement d’un mouvement si prometteur dépendrait du travail indépendant du parti marxiste, qui se battrait pour apporter la conscience socialiste dans la classe ouvrière.
Tous ceux qui insistent pour dire qu’on ne peut contester l’autorité des syndicats sont contre la lutte pour le marxisme dans la classe ouvrière. Cliff Slaughter,[24] par exemple, dénonce les marxistes [du Comité international] « qui persistent à penser qu’ils ont pour mission de ‘développer la conscience’, d’‘intervenir politiquement’, de ‘politiser’ les luttes qui surgissent spontanément dans la classe ouvrière ».[25]
Cette déclaration confirme le fait que Slaughter répudie le marxisme et embrasse l’anarchisme des classes moyennes. Nous approchons de la fin d’un siècle qui a été le témoin des plus terribles tragédies historiques. Le prix payé en sang versé pour les échecs et les trahisons des nombreux mouvements révolutionnaires de ce siècle est incalculable. Les conséquences politiques de révolutions trahies ont fait des centaines de millions de victimes. Au cours de cette décennie, nous avons vu les conséquences de la désorientation de la classe ouvrière sur l’ancien territoire de l’URSS. Et pourtant, au milieu de cette désorientation politique universelle, Slaughter dénonce ceux qui cherchent à la surmonter en s’appuyant sur la science socialiste.
On ne sert pas la classe ouvrière en glorifiant sa spontanéité, c’est-à-direle niveau de conscience dominant et les formes d’organisation existantes. Dans le cas de Slaughter et d’ex-marxistes similaires, de tels éloges de la spontanéité ne servent qu’à masquer leur propre collaboration avec la bureaucratie des partis et des syndicats. Nous continuons d’insister sur le fait que l’avenir de la classe ouvrière dépend de la force de notre intervention politique et de notre succès à élever sa conscience et ne voyons aucune raison de nous en excuser.
Nous nous tenons fermement sur les bases posées par les grands fondateurs et représentants du socialisme scientifique. Nous rejetons la déclaration de Slaughter comme une répudiation des principes essentiels qui ont constitué la raison d’être du mouvement marxiste dès ses débuts. Le prolétariat est le sujet historique actif du projet socialiste. Mais le socialisme n’est pas sorti directement de la classe ouvrière et n’aurait jamais pu le faire. Il a sa propre histoire intellectuelle. Marx n’a jamais prétendu que sa conception des tâches historiques du prolétariat était conforme à ce que pourrait être l’ « opinion publique » générale d’une vaste majorité d’ouvriers à un moment donné de leur développement. Il est absurde même de suggérer que Marx ait consacré toute sa vie àformuler des idées qui ne feraient que reproduire ce que l’ouvrier moyen pouvait penser par lui-même.
Si la conscience socialiste était engendrée par le développement spontané de la lutte des classes, il n’y aurait aucune raison d’organiser cette université d’étéinternationale. Quel besoin y aurait-il de conférences sur l’histoire, la philosophie, l’économie politique, la stratégie et la culture révolutionnaires si la classe ouvrière, avec ses organisations de masse existantes et le niveau actuel de sa conscience historique et politique, pouvait automatiquement se mettre à la hauteur des tâches posées par le développement de la crise mondiale du capitalisme ?
Considérons les événements qui servent de toile de fond à cette université. Alors même que nous parlons, les économies des pays de l’Asie du sud-est sont en crise. Pratiquement du jour au lendemain, l’existence de centaines de millions de personnes se trouve en danger. En Indonésie, la valeur de la monnaie a chuté de 22% avant-hier. En six mois, la roupie indonésienne a perdu presque 80% de sa valeur. Le FMI impose un programme brutal d’austérité et dans ces conditions, l’éruption de conflits sociaux massifs est inévitable.
L’issue de ces conflits ne dépend-elle pas de l’assimilation par la classe ouvrière indonésienne des leçons tragiques de sa propre histoire qui constitue un autre chapitre cauchemardesque de l’histoire du vingtième siècle ? Ne faut-il pas passer en revue avec les travailleurs, étudiants et intellectuels indonésiens les événements de 1965-1966 – au cours desquels le Parti communiste le plus important du monde en dehors de ceux d’URSS et de Chine, comptant plus d’un million d’adhérents, s’est révéléimpuissant face au coup d’Etat de Suharto ? Plus d’un demi-million de personnes furent massacrées alors par la contre-révolution. Les rivières de Sumatra et de Bali étaient obstruées par les cadavres. Les exécutions de prisonniers arrêtés à la suite du coup d’Etat de Sukarno se prolongèrent jusque dans les années 1990. Que de questions et de problèmes demeurent sans réponse et ne sont pas éclaircis ! Les leçons stratégiques de cette période constituent la base pour la revanche historique que les travailleurs indonésiens doivent prendre sur les crimes commis par la bourgeoisie indonésienne, encouragée par l’impérialisme américain et j’ajouterai, australien.
Il ne s’agit pas ici d’un problème indonésien, mais d’une tâche historique mondiale. Nous terminons donc cette école comme nous l’avons commencée, en insistant sur le fait que l’avenir de l’humanité au vingt-et-unième siècle dépend de l’assimilation des leçons et des expériences stratégiques du vingtième. Et s’il me fallait résumer en quelques mots la principale conclusion àlaquelle nous sommes parvenus à la fin de notre examen de ce siècle troublé, c’est que le destin de l’humanité est inéluctablement lié à la lutte pour le développement de la conscience et de la culture socialiste dans la classe ouvrière. Cette lutte trouve son expression politique dans la construction du parti mondial de la révolution socialiste.
Peter Taafe, « Trade Unions in the Epoch of Neo-Liberalism », Socialism Today. Traduit de l’anglais
Ibid.
Ibid.
Workers International Press, N°1, février 1997, p. 21. Traduit de l’anglais.
Karl Marx, Le Capital, Livre I, Garnier-Flammarion, Paris 1969, p. 69
Cité dans Theodore Rothstein, From Chartism to Labourism (Londres, Lawrence and Wishart, 1983), pp. 183-184. Traduit de l’anglais.
Ibid., p. 195
Ibid., p. 197
Ibid., p. 273
Karl Marx et Friedrich Engels, Le parti de classe, Tome II : Activité et organisation (F. Maspero, Paris, 1973), « Instructions pour les délégués du Conseil central provisoire de l’A.I.T sur les différentes questions à débattre au Congrès de Genève (3-8 septembre 1866) », p. 133.
Ibid., p. 135.
Karl Marx, Prix, salaire et profit, (Les Balustres, Paris, 2016), p. 113
Karl Marx et Friedrich Engels, Werke : Band 22 (Dietz Verlag, Berlin, 1966), p. 96. Traduit de l’allemand.
Karl Marx et Friedrich Engels, Werke : Band 34 (Dietz Verlag, Berlin, 1966), p. 378. Traduit de l’allemand.
Karl Marx et Friedrich Engels, Werke : Band 21 (Dietz Verlag, Berlin, 1966), p. 194. Traduit de l’allemand.
Ibid., p. 195.
Karl Marx et Friedrich Engels Werke : Band 37, « Lettre d’Engels à Laura Lafargue, 17 octobre 1889 », p. 188. Traduit de l’allemand.
Rosa Luxemburg, Réforme sociale ou révolution ?, (Éditions Spartacus, Paris, 1972), p. 33.
Ibid., p. 96.
Carl E. Schorske, Die große Spaltung : Die deutsche Sozialdemokratie 1905-1917, Berlin, 1981, p. 64. Traduit de l’allemand.
Ibid.
Ibid., p. 66
Karl Kautsky, « Genossin Luxemburg über die Gewerkschaften », Vorwärts, numero 89, 18-4-1906, dans : Leo Stern, édit., Die Russische Revolution von 1905-1907 (Spiegel der deutschen Presse, Berlin 1961), p. 1549. Traduit de l’Allemand.
Cliff Slaughter est un ancien dirigeant du Workers Revolutionary Party qui a rompu politiquement avec le Comité International de la Quatrième Internationale en 1986.
Cliff Slaughter, « Review of Istvan Mezsaros’ ‘Beyond Capital’ », Workers International Press, n°3, (Londres, juin 1997). Traduit de l’anglais.