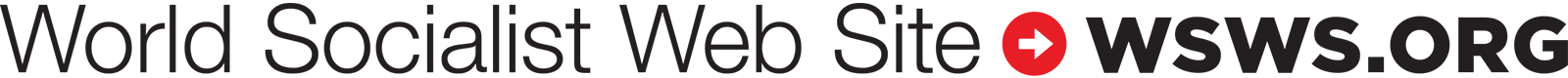Conférence tenue le 14 août 2005 lors de l’université d’été du Socialist Equality Party (Etats-Unis) à Ann Arbor, Michigan.
Comprendre le vingtième siècle
Nous commençons aujourd’hui une semaine de conférences consacrées au marxisme, à la révolution d’Octobre et aux fondations historiques de la Quatrième Internationale. Au cours de ces conférences, nous examinerons les événements historiques, les controverses théoriques et les luttes politiques qui ont conduit à la formation de la Quatrième Internationale. Ces conférences se concentreront sur les quarante premières années du vingtième siècle. Ce cadre nous est imposé en partie par le temps dont nous disposons. Il y a des limites à ce qu’on peut accomplir en une semaine et travailler sur les quarante premières années du siècle passé est déjà une entreprise ambitieuse. Il y a cependant une certaine logique à se concentrer sur la période entre 1900 et 1940.
Lorsque Léon Trotsky fut assassiné en août 1940, tous les événements qui avaient déterminé les caractéristiques politiques essentielles du vingtième siècle avaient déjà eu lieu. La Première Guerre mondiale qui avait éclaté en août 1914 ; la prise de pouvoir du Parti bolchévique en octobre 1917 et la création ultérieure de l’Union soviétique comme premier État ouvrier : l’avènement des États-Unis en tant que plus puissant État impérialiste ; l’échec de la révolution allemande en 1923 ; la dégénérescence bureaucratique de l’Union soviétique ; la défaite de l’Opposition de gauche et l’expulsion de Trotsky du Parti communiste et de la Troisième Internationale en 1927 ; la trahison de la révolution chinoise en 1926-1927 ; le krach boursier de Wall Street et le début de la dépression capitaliste mondiale en 1929 ; l’arrivée au pouvoir d’Hitler et la victoire du fascisme allemand en 1933 ; les procès de Moscou en 1936-1938 et la campagne de génocide politique dirigée contre les intellectuels et la classe ouvrière socialistes en URSS ; la trahison et la défaite de la révolution espagnole en 1937-1939 sous l’égide du Front populaire stalinien ; le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale en septembre 1939 et le début de l’extermination des juifs en Europe.
Ces quatre décennies ont défini les caractéristiques politiques du 20esiècle. Les principaux problèmes politiques auxquels devait être confronté le prolétariat international après la Deuxième Guerre mondiale ne pouvaient être compris qu’à travers les leçons stratégiques des principales expériences révolutionnaires et contre-révolutionnaires de la période ayant précédé la Deuxième Guerre mondiale.
L’analyse de la politique des partis sociaux-démocrates après la Deuxième Guerre mondiale exigeait une compréhension des implications historiques de l’effondrement de la Seconde Internationale en août 1914. Il fut seulement possible de comprendre la nature de l’Union soviétique, des régimes établis en Europe de l’Est après la Deuxième Guerre mondiale et du régime maoïste établi en Chine en octobre 1949 à travers une étude de la révolution d’octobre et de la dégénérescence prolongée du premier État ouvrier. Donner une réponse aux problèmes posés par la vague des grandes révolutions anti-impérialistes et anticoloniales qui a déferlé sur l’Asie, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique Latine après 1945, exigeait une étude méticuleuse des controverses politiques et théoriques ayant trait à la théorie de la révolution permanente formulée par Trotsky en 1905.
C’est dans la dernière décennie de l’existence de l’URSS que le lien entre connaissance historique, analyse politique et orientation s’est montré de la façon la plus manifeste. Lorsque Mikhaïl Gorbatchev prit le pouvoir en mars 1985, le régime stalinien était dans une situation désespérée. La détérioration de l’économie soviétique ne pouvait plus être dissimulée une fois que les prix du pétrole, dont la montée rapide dans les années 1970 avait engendré des recettes exceptionnelles à court terme, ont commencé à chuter fortement. Quelles mesures le Kremlin allait-il prendre pour inverser le déclin ? Les questions politiques se trouvèrent immédiatement enchevêtrées avec les questions restées sans réponse de l’histoire soviétique.
Pendant plus de soixante ans, le régime stalinien avait mené une campagne implacable de falsification historique. Les citoyens soviétiques ignoraient largement les faits de leur propre histoire révolutionnaire. Les œuvres de Trotsky et de ceux qui partageaient ses idées avaient été censurées et supprimées pendant des décennies. Il n’existait aucune histoire soviétique digne de foi. Chaque nouvelle édition de l’encyclopédie soviétique officielle révisait l’histoire conformément aux intérêts et aux instructions du Kremlin. Comme le fit remarquer une fois notre regretté camarade Vadim Rogovine, en URSS le passé était aussi imprévisible que l’avenir !
Pour les diverses factions de la bureaucratie et de la nomenklatura privilégiée qui étaient en faveur du démantèlement de l’industrie nationalisée, du retour à la propriété privée et de la restauration du capitalisme, la crise économique soviétique constituait la « preuve » que le socialisme avait échoué et que la révolution d’Octobre avait été une erreur catastrophique à l’origine de toutes les tragédies ultérieures de l’Union soviétique. Les remèdes économiques avancés par ces défenseurs du marché se fondaient sur une interprétation de l’histoire soviétique selon laquelle le stalinisme était le résultat inévitable de la révolution d’octobre.
On ne pouvait répondre aux défenseurs de la restauration capitaliste simplement sur le terrain de l’économie. La réfutation des arguments pro-capitalistes nécessitait plutôt un examen de l’histoire soviétique qui prouvait que le stalinisme ne découlait ni nécessairement ni inévitablement de la révolution d’Octobre. Il fallait montrer qu’une alternative au stalinisme était non seulement théoriquement concevable, mais encore qu’elle avait vraiment existé, sous la forme de l’Opposition de gauche dirigée par Léon Trotsky.
Je répète aujourd’hui à peu près ce que j’ai dit devant une assistance d’étudiants et de professeurs en Union soviétique, à l’Institut des archives historiques de l’Université de Moscou, en novembre 1989. J’ai commencé ma conférence sur « L’avenir du socialisme » en faisant remarquer que « pour parler de l’avenir, il fallait se pencher longuement sur le passé. Car comment peut-on discuter du socialisme aujourd’hui sans traiter des nombreuses controverses qui agitent le mouvement socialiste ? Et bien sûr quand nous parlons de l’avenir du socialisme nous parlons du sort de la révolution d’octobre – un événement d’importance planétaire qui a eu une profonde influence sur la classe ouvrière dans chaque pays. Une grande partie de ce passé, surtout en Union soviétique, est encore enveloppé de mystère et entouré de falsifications ». [1]
Il existait alors en Union soviétique un intérêt croissant pour les questions historiques. Ma propre conférence, organisée avec moins de vingt-quatre heures de préparation en réponse à une invitation impromptue du directeur de l’Institut des archives historiques, attira un auditoire de plusieurs centaines de personnes. La publicité se fit presque exclusivement de bouche à oreille. La nouvelle se répandit vite qu’un trotskyste américain parlerait à l’Institut et l’assistance fut nombreuse.
Même si pendant la courte période de la glasnost, il n’était pas entièrement nouveau qu’un trotskyste parle en public, une conférence faite par un trotskyste américain tenait encore de la sensation. On était assoiffé de vérité historique. Comme l’a récemment noté le camarade Fred Williams dans sa critique de la lamentable biographie de Staline par Robert Service, le périodique soviétique Argumenti i Fakty(Arguments et Faits), un petit périodique avant l’ère de la glasnost, vit son tirage augmenter de façon exponentielle et atteindre trente-trois millions de lecteurs, grâce à la publication d’essais et documents longtemps supprimés et relatifs à l’histoire soviétique. [2]
La classe ouvrière et l’histoire
Effrayée par l’intérêt général porté au marxisme et au trotskysme, la bureaucratie chercha à court-circuiter ce processus intellectuel de clarification historique qui encouragerait un renouveau de la conscience socialiste et accéléra sa campagne pour un démantèlement de l’URSS. La façon dont la bureaucratie orchestra la dissolution de l’URSS en décembre 1991 – la culmination de la trahison stalinienne anticipée par Trotsky plus d’un demi-siècle auparavant – est un sujet qui reste à examiner dans le détail. Mais il est indéniable qu’un des facteurs essentiels ayant permis de miner la résistance populaire à la dissolution de l’URSS – dont les résultats catastrophiques ne sont devenus que trop évidents – fut une ignorance de l’histoire. Le poids de décennies de falsification historique n’a pu être surmonté à temps pour que la classe ouvrière soviétique s’oriente politiquement, défende ses intérêts sociaux indépendants et s’oppose à la dissolution de l’Union soviétique et à la restauration du capitalisme.
Cette tragédie historique comporte une leçon. Sans une connaissance approfondie de l’expérience historique par laquelle elle est passée, la classe ouvrière ne peut défendre ses intérêts sociaux même les plus élémentaires et encore moins mener un combat politiquement conscient contre le capitalisme.
La conscience historique est un élément essentiel de la conscience de classe. Ces mots de Rosa Luxemburg sont aussi pertinents aujourd’hui que lorsqu’ils furent écrits au début de 1915, moins d’un an après le commencement de la Première Guerre mondiale et après la capitulation du parti social-démocrate allemand au militarisme et à l’impérialisme prussiens.
Il [le prolétariat moderne] n’a d’autre maître que l’expérience historique. Le chemin pénible de sa libération n’est pas pavé seulement de souffrances sans bornes, mais aussi d’erreurs innombrables. Son but, sa libération, il l’atteindra s’il sait s’instruire de ses propres erreurs. Pour le mouvement prolétarien, l’autocritique, une autocritique sans merci, cruelle, allant jusqu’au fond des choses, c’est l’air, la lumière sans lesquels il ne peut vivre.
Dans la guerre mondiale actuelle, le prolétariat est tombé plus bas que jamais. C’est là un malheur pour toute l’humanité. Mais c’en serait seulement fini du socialisme au cas où le prolétariat international se refuserait à mesurer la profondeur de sa chute et à en tirer les enseignements qu’elle comporte. [3]
La conception de l’histoire que nous soutenons, qui accorde à la connaissance et à l’assimilation théoriques de l’expérience historique un rôle si décisif dans la lutte pour l’émancipation de l’humanité, s’oppose à toutes les tendances actuelles de la pensée bourgeoise. La désintégration politique, économique et sociale de la société bourgeoise se reflète aussi dans sa déchéance intellectuelle. Dans une période de réaction politique, comme le notait Trotsky, l’ignorance montre les dents.
La forme particulière d’ignorance véhiculée par les représentants universitaires de la pensée bourgeoise les plus habiles et les plus cyniques, le postmodernisme, repose sur l’ignorance et le mépris de l’histoire. Le rejet postmoderniste de l’importance de l’histoire et du rôle essentiel attribué à celle-ci par tous les courants de pensée sociale véritablement progressistes est indissolublement lié à un autre élément de leurs conceptions théoriques : la négation et la répudiation explicite de la vérité objective en tant que but de la recherche philosophique.
Le rejet postmoderniste de l’histoire
Qu’est-ce donc que le postmodernisme ? Le professeur Keith Jenkins, un représentant de cette tendance, explique qu’aujourd’hui,
Nous vivons aujourd’hui dans la condition générale de la postmodernité. Nous n’avons pas d’autre choix. Car la postmodernité n’est pas une « idéologie » ou une position à laquelle nous pouvons choisir ou non de souscrire. La postmodernité est précisément notre condition, notre destin. Et cette condition a été causée par l’échec général – un échec qu’on peut distinguer très clairement alors que la poussière retombe sur le vingtième siècle – de cette expérience d’existence sociale que nous appelons la modernité. C’est l’échec général, mesuré à sa propre aune, de la tentative commencée vers le 18e siècle en Europe de générer grâce à la raison, à la science et à la technologie, un niveau de bien-être personnel et social au sein de formations sociales dont on pourrait dire qu’elles essayaient, en légiférant en faveur d’une émancipation de plus en plus grande de leurs citoyens/sujets, de devenir, au mieux, des « communautés de droits civiques ».
… Il n’y a pas – et il n’y a jamais eu – de fondations « réelles » du genre de celles censées être à la base de l’expérience du moderne. [4]
Permettez-moi de « déconstruire » ce passage. Pendant plus de deux cents ans, depuis le 18e siècle, il y a eu des gens, qui s’inspirant de la science et de la philosophie du Siècle des Lumières, ont cru au progrès et à la perfectibilité humaine, et qui voulaient la transformation révolutionnaire de la société en se fondant sur ce qu’ils estimaient être une compréhension scientifique des lois de l’histoire. Il y avait des marxistes qui croyaient que l’Histoire (avec un grand H) est un processus régi par des lois et déterminé par des forces qui existent indépendamment de la conscience subjective individuelle, mais que l’homme peut découvrir et comprendre et sur lesquelles il peut agir dans l’intérêt du progrès humain.
Mais pour les postmodernistes, de telles conceptions se sont avérées être de naïves illusions. Maintenant, nous sommes mieux au fait ; l’Histoire avec un grand H n’existe pas. Il n’y a même pas d’histoire avec un h minuscule comprise en tant que processus objectif. Il n’existe que des « narrations » ou des « discours » au vocabulaire changeant dont on se sert pour parvenir à un but quelconque subjectivement déterminé.
Dans cette optique, l’idée même de tirer des « leçons » de « l’histoire » est vouée à l’échec. Il n’y a rien à étudier et rien à apprendre. Jenkins insiste pour dire :
Il nous faut seulement comprendre à présent que nous vivons dans des formations sociales qui n’offrent pour nos actions et nos croyances aucune raison légitime, ontologique, épistémologique ou éthique, au-delà du statut de la conversation finalement auto-référentielle (rhétorique)... Nous reconnaissons donc aujourd’hui qu’il n’y a jamais eu et qu’il n’y aura jamais de chose telle qu’un passé exprimant une quelconque essence. [5]
Traduit en bon français, ce passage de Jenkins dit 1) que le fonctionnement des sociétés humaines, passées ou présentes, ne peut être compris selon des lois qu’on peut ou pourrait découvrir et que 2) il n’y a aucun fondement objectif à ce que les gens peuvent penser, dire, ou faire concernant la société dans laquelle ils vivent. Les gens qui se disent historiens peuvent avancer telle ou telle interprétation du passé, mais le remplacement d’une interprétation par une autre ne signifie pas un progrès vers quelque chose de plus vrai objectivement que ce qu’on avait écrit auparavant, car il n’existe aucune vérité objective dont on puisse s’approcher. On remplace une façon de parler du passé par une autre pour des raisons qui correspondent au dessein subjectivement conçu de l’historien.
Les tenants de cette conception proclament la disparition de la modernité mais ils refusent d’examiner les jugements historiques et politiques sous-jacents, sur lesquels reposent leurs conclusions. Ils ont, bien sûr, des positions politiques qui s’expriment dans leurs vues théoriques. Le professeur Hayden White, une des sommités du postmodernisme, écrit :
Or je suis contre les révolutions, qu’elles proviennent « d’en bas » ou « d’en haut » dans la hiérarchie sociale et qu’elles soient dirigées par des chefs qui prétendent comprendre la science de la société et de l’histoire ou par ceux qui célèbrent la « spontanéité » politique. [6]
La légitimité d’une conception philosophique donnée n’est pas automatiquement réfutée par les idées politiques de l’individu qui l’avance. Mais la trajectoire antimarxiste et antisocialiste du postmodernisme est si évidente qu’il est impossible de dissocier sa conception théorique de sa perspective politique.
Jean-François Lyotard
Cette conception s’exprime dans les écrits du philosophe français Jean-François Lyotard et du philosophe américain Richard Rorty. Je commencerai par le premier. Lyotard était directement engagé dans la politique socialiste, car en 1954 il a rejoint Socialisme ou Barbarie, une organisation ayant fait scission en 1949 d’avec le PCI (Parti communiste internationaliste), la section française de la Quatrième Internationale. Cette scission se fit à cause du rejet par ce groupe de la définition de Trotsky selon laquelle l’URSS était un État ouvrier dégénéré. Le groupe Socialisme ou Barbarie, dont les principaux théoriciens étaient Cornelius Castoriadis et Claude Lefort, prit la position que la bureaucratie n’était pas une strate sociale parasitaire, mais une nouvelle classe sociale exploitante. Lyotard resta dans ce groupe jusqu’au milieu des années 1960 ; il avait alors entièrement rompu avec le marxisme.
On associe surtout Lyotard à la répudiation de la « grande narration » de l’émancipation humaine, dont la légitimité selon lui a été réfutée par les événements du 20e siècle. Selon lui,
Chacun des grands récits d’émancipation, à quelque genre qu’il ait accordé l’hégémonie, a pour ainsi dire été invalidé dans son principe au cours des cinquante dernières années. – Tout ce qui est réel est rationnel, tout ce qui est rationnel est réel : « Auschwitz » réfute la doctrine spéculative. Au moins ce crime, qui est réel, n’est pas rationnel. – Tout ce qui est prolétarien est communiste, tout ce qui est communiste est prolétarien : « Berlin 1953, Budapest 1956, Tchécoslovaquie 1968, Pologne 1980 » (j’en passe) réfutent la doctrine matérialiste historique : les travailleurs se dressent contre le Parti. – Tout ce qui est démocratique est par le peuple et pour lui, et inversement : « Mai 1968 » réfute la doctrine du libéralisme parlementaire. Le social quotidien fait échec à l’institution représentative. – Tout ce qui est libre jeu de l’offre et de la demande est propice à l’enrichissement général, et inversement : les « crises de 1911, 1929 » réfutent la doctrine du libéralisme économique, et la « crise de 1974-1979 » réfute l’aménagement postkeynésien de cette doctrine. [7]
Ce passage résume le mélange de démoralisation, de désorientation, de pessimisme et de confusion à la base de tout le projet théorique postmoderne de Lyotard. L’argument qu’Auschwitz réfute toutes les tentatives d’une compréhension scientifique de l’histoire n’est pas une trouvaille de Lyotard. Il y a une idée semblable à la base des écrits d’après-guerre d’Adorno et de Horkheimer, les fondateurs de l’École de Francfort. La déclaration de Lyotard selon laquelle Auschwitz était à la fois réel et irrationnel est une déformation simpliste de la conception dialectique révolutionnaire de Hegel. La prétendue réfutation de Lyotard se base sur une vulgaire assimilation du réel, concept philosophique, à ce qui existe à un moment donné. Mais comme le disait Engels, la réalité telle que Hegel la comprend « n’est aucunement … un attribut qui revient de droit en toutes circonstances et en tout temps à un état de choses social ou politique donné ». [8] Ce qui existe peut être si totalement en conflit avec le développement de la société humaine qu’il en devient socialement et historiquement irrationnel, donc irréel, non viable et voué à l’échec. Dans ce sens profond, l’impérialisme allemand – dont le nazisme et Auschwitz étaient des produits – démontre la vérité du précepte philosophique de Hegel.
Les soulèvements ouvriers contre le stalinisme ne réfutent pas le matérialisme historique. Ils réfutent plutôt la politique de Socialisme ou Barbarie que Lyotard avait épousée. Trotsky avait prédit de tels soulèvements. Le groupe Socialisme ou Barbarie avait attribué aux bureaucraties staliniennes un degré de pouvoir et de stabilité que n’avait pas cette caste parasitique. De plus, Lyotard suggère une équivalence entre le communisme comme mouvement révolutionnaire et les partis communistes, qui étaient en fait les organisations politiques des bureaucraties staliniennes.
Quant à la réfutation du libéralisme économique et parlementaire, elle avait été faite par les marxistes bien avant les événements cités par Lyotard. Sa référence à Mai 68 comme marquant la chute du libéralisme parlementaire est particulièrement grotesque. Et la guerre civile espagnole ? Et la chute de la république de Weimar ? Et la trahison du Front populaire en France ? Tous ces événements eurent lieu plus de trente ans avant les événements cités par Lyotard. Ce que Lyotard présente comme de grandes innovations philosophiques ne sont guère que les manifestations de pessimisme et de cynisme de la petite-bourgeoise universitaire anciennement de gauche déçue et en mouvement vers la droite.
Richard Rorty
Richard Rorty établit sans complexe un rapport entre son rejet du concept de vérité objective et son opposition à la politique socialiste révolutionnaire. Pour Rorty, l’effondrement des régimes staliniens en Europe de l’Est et la dissolution de l’Union soviétique ont fourni aux intellectuels l’occasion longtemps attendue de renoncer une fois pour toutes à tout engagement intellectuel (ou même émotif) pour la cause de la perspective socialiste révolutionnaire. Dans son essai intitulé « La fin du léninisme, Havel, et l’espoir social », Rorty déclare :
J’espère que les intellectuels utiliseront la fin du léninisme comme l’occasion de se libérer de l’idée qu’ils savent ou devraient savoir quelque chose sur les forces profondes et sous-jacentes, les forces qui déterminent le destin des communautés humaines.
Nous autres intellectuels prétendons avoir un tel savoir depuis que nous avons ouvert boutique. Autrefois, nous disions savoir que la justice régnerait le jour où les rois deviendraient philosophes ou les philosophes rois ; nous prétendions le savoir d’après une étude détaillée de l’âme humaine. Plus récemment nous avons affirmé qu’elle ne régnerait que lorsque le capitalisme serait renversé et la culture décommercialisée. Nous prétendions le savoir sur la base d’un entendement de la forme et du mouvement de l’Histoire.
J’espère que nous en sommes arrivés au point où nous pourrons finalement nous libérer de la conviction, commune à Platon et à Marx, qu’il doit y avoir de grands procédés théoriques pour découvrir comment en finir avec l’injustice, par opposition aux modes d’action expérimentaux à petite échelle. [9]
Que s’ensuivrait-il d’une telle renonciation théorique ? Rorty offre ses suggestions pour réorienter la politique « de gauche ».
Je crois le moment venu de bannir l’utilisation des termes « capitalisme » et « socialisme » du vocabulaire politique de la gauche. Ce serait une bonne idée de cesser de parler de « la lutte anticapitaliste » et d’y substituer quelque chose de banal et de non théorique, tel que « la lutte contre la misère humaine évitable ». Plus généralement, j’espère que nous pourrons banaliser tout le vocabulaire de la délibération politique de gauche. Je suggère que nous commencions à parler de cupidité et d’égoïsme au lieu d’idéologie bourgeoise, à parler de salaires de misère et de licenciements au lieu de la marchandisation du travail, et de dépenses par élève variables selon les écoles et d’accès différentiel aux soins médicaux plutôt que de division de la société en classes. [10]
Faut-il sérieusement traiter ceci de philosophie politique ? Ce que Rorty traite de « banalisation » mérite plutôt le nom de castration intellectuelle et politique. Il propose de bannir de la discussion les conquêtes de plus de deux cents ans de pensée théorique. La conception qui se trouve derrière cette suggestion est que le développement de la pensée est un processus subjectif arbitraire. Les mots, les concepts théoriques, les catégories logiques et les systèmes philosophiques ne sont que des constructions purement verbales, qu’on évoque de façon pragmatique dans l’intérêt de divers buts subjectifs. L’affirmation que le développement de la pensée théorique est un processus objectif exprimant une compréhension humaine de la nature et de la société qui évolue, s’approfondit, devient plus précise et plus complexe, ne constitue pour Rorty qu’un article de foi hégélien-marxiste. Comme il l’affirme ailleurs : « Il n’existe aucune activité appelée savoir dont la nature reste à découvrir et pour laquelle les scientifiques sont particulièrement doués. Il n’y a que le processus consistant à justifier ses croyances devant une assistance ». [11]
Ainsi, des termes tels que « capitalisme », « classe ouvrière », « socialiste », « plus-value », « travail salarié », « exploitation » et « impérialiste » ne sont pas des concepts qui expriment et désignent une réalité objective. Rorty suggère que nous parlions de « la lutte contre la misère humaine évitable ». Acceptons un instant cette brillante suggestion. Nous sommes immédiatement confrontés à un problème. Comment définir la misère ? Comment allons-nous déterminer quelles formes de misère humaine sont évitables ? Sur quelle base devons-nous affirmer que la misère est évitable ou même qu’elle est à éviter ? Quelle réponse donner à ceux qui affirment que la misère est la condition de l’humanité, une conséquence du péché originel ? Et même si nous arrivons à éluder les arguments des théologiens et à concevoir la misère en termes laïcs, en tant que problème socio-économique, nous aurions toujours à faire au problème d’analyser les causes de la misère.
Un programme pour abolir « la misère humaine évitable » exigerait donc une analyse des structures économiques de la société. Dans la mesure où une telle recherche serait conduite de façon tant soit peu honnête, les croisés luttant contre la « misère humaine évitable » se heurteraient aux phénomènes et rapports de la « propriété », du « profit » et des « classes ». Ils pourraient avoir recours à des euphémismes pour décrire ces phénomènes sociaux mais cela ne les empêcherait pas d’exister objectivement.
Les conceptions théoriques de Rorty abondent en incohérences et en contradictions patentes. Il déclare catégoriquement qu’il n’y a aucune « vérité » à découvrir ou à connaître. On suppose qu’il considère comme vraie sa découverte de la non-existence de la vérité, car elle constitue le fondement de sa philosophie. Mais quand on lui demande d’expliquer cette grossière incohérence, Rorty évite le problème en proclamant qu’il refuse de se soumettre à l’énoncé de la question, qui a ses racines dans les formes traditionnelles du discours philosophique, qui remonte à Platon. La vérité, insiste Rorty, est un de ces vieux problèmes à présent dépassé et à propos desquels on ne peut avoir une discussion philosophique intéressante. Il note avec cynisme que lorsque le problème de la vérité est soulevé, il « préfère simplement changer de sujet ». [12]
La clef de la compréhension des concepts philosophiques de Rorty se trouve dans ses prises de position politiques. Bien qu’il ait plusieurs fois cherché à minimiser le lien entre la philosophie et la politique, il serait difficile de trouver un autre philosophe contemporain dont les conceptions théoriques s’inscrivent si nettement dans une position politique, c’est-à-dire dans son refus et son rejet de la politique marxiste révolutionnaire. Rorty ne tente pas d’analyser et de réfuter systématiquement le marxisme. Le programme socialiste (que Rorty assimile largement au sort de l’URSS) a échoué et il y a, en ce qui le concerne, fort peu d’espoir qu’il réussisse à l’avenir. Il n’y a rien à retirer du naufrage de la vieille gauche marxiste. Plutôt que de s’engager dans de nouvelles luttes de doctrine sur les principes historiques, les programmes et, pire que tout, la vérité objective, il vaut mieux se cantonner à la politique du plus petit dénominateur commun. Telle est la philosophie de Rorty et tel est le discours de la plupart des universitaires américains postmodernes.
Pour Rorty (et nous le verrons, pour beaucoup d’autres), les « événements de 1989 ont convaincu ceux qui persistaient à ne pas abandonner le marxisme qu’il fallait chercher un autre moyen de concevoir notre époque et d’avoir un projet pour un avenir meilleur que le présent, un moyen qui abandonne les références au capitalisme, à un mode de vie bourgeois, à une idéologie bourgeoisie, et à la classe ouvrière ». [13] Le moment est venu, selon lui, de
cesser d’utiliser « l’Histoire » comme le nom d’un objet autour duquel nous tissons nos fantasmes de pouvoir réduire la misère. Nous devrions avouer la justesse de l’argument de Francis Fukuyama (dans son célèbre essai La fin de l’Histoire) que si vous rêvez toujours à la révolution totale, au radicalement autre à l’échelle historique et mondiale, les événements de 1989 montrent que la chance n’est plus de votre côté. [14]
L’impact de 1989
Cette sorte d’ironie cynique exprime bien la démoralisation et la prostration qui se sont abattues sur le milieu des universitaires de gauche et des radicaux devant la réaction politique après l’effondrement des régimes staliniens. Au lieu de tenter une analyse sérieuse des racines historiques, politiques, sociales et économiques de la dissolution des régimes staliniens, ces tendances se sont rapidement adaptées au climat prévalant de réaction, de peur, et de pessimisme.
Expliquant la capitulation politique devant la vague réactionnaire stalinienne et fasciste pendant les années 1930, Trotsky faisait observer que la force non seulement conquiert, mais encore convainc. La soudaine dissolution des régimes staliniens, qui surprit totalement tant de radicaux et d’intellectuels gauchisants, les laissa désarmés théoriquement, politiquement et même moralement face au déferlement du triomphalisme bourgeois et impérialiste qui suivit le démantèlement du mur de Berlin. Les innombrables tendances de la politique petite-bourgeoise de gauche furent déconcertées par la soudaine disparition des régimes bureaucratiques et affirmèrent ensuite que leur disparition représentait l’échec du marxisme.
Il y avait, outre de la lâcheté, une part importante de malhonnêteté intellectuelle dans l’affirmation que le marxisme avait été discrédité par la dissolution de l’URSS. Le professeur Brian Turner écrivit par exemple que « l’autorité de la théorie marxiste a été sévèrement contestée, notamment par l’incapacité du marxisme à prévoir l’effondrement total du communisme en Europe de l’Est et en Union soviétique ». [15] L’ignorance seule n’explique pas de telles déclarations. Les universitaires de gauche qui ont écrit de pareilles choses n’étaient pas entièrement ignorants de l’analyse trotskyste de la nature du régime stalinien, qui avertissait que la politique de la bureaucratie mènerait en fin de compte à la chute de l’URSS.
Le Comité International a publié de nombreuses déclarations qui prévoyaient la trajectoire catastrophique du stalinisme. Avant la disparition de l’URSS, les radicaux de gauche petits-bourgeois jugeaient que de tels avertissements n’étaient que des élucubrations sectaires. Après la disparition de l’Union soviétique, il leur était plus facile de rendre le marxisme responsable de l’échec du « socialisme existant réellement » que d’entreprendre un examen critique de leur propre attitude politique. Furieux et déçus, ils estimaient à présent que leur engagement politique, intellectuel et affectif pour le socialisme avait constitué un mauvais placement qu’ils regrettaient amèrement. Leur attitude a été résumée par l’historien Eric Hobsbawm, longtemps membre du Parti communiste anglais et défenseur du stalinisme pendant des décennies. Il écrivit dans son autobiographie :
Maintenant, le communisme est mort. L’URSS et presque tous les États et sociétés construits sur son modèle, ces produits de la révolution d’octobre 1917 qui nous inspira, se sont si complètement effondrés, ne laissant qu’un paysage de ruine matérielle et morale, qu’il est évident aujourd’hui que l’échec devait être inscrit dans l’entreprise dès le début.[16]
L’affirmation de Hobsbawm que la révolution d’octobre était une entreprise condamnée constitue une capitulation aux arguments des adversaires droitiers invétérés du socialisme. Les idéologues de la réaction insistent pour dire que l’effondrement de l’Union soviétique est la preuve irréfutable que le socialisme est une vision utopique insensée.
Robert Conquest, dans un livre rédigé dans le style de l’inquisition, Reflections on a Ravaged Century (Réflexions sur un siècle ravagé), condamne « l’idée archaïque selon laquelle l’utopie peut être construite sur terre en réponse millénariste à tous les problèmes humains. » [17] L’historien polonais-américain Andrzej Walicki a proclamé que « le destin mondial du communisme... indique que la vision elle-même était intrinsèquement irréalisable. Les immenses énergies déployées pour la mettre en œuvre étaient donc vouées à l’échec ». [18] L’historien américain récemment décédé, Martin Malia, développe ce thème dans son livre La Tragédie soviétique où il déclare : « La faillite du socialisme intégral ne vient pas de ce qu’il a été mis à l’épreuve pour la première fois au mauvais endroit, elle est dans l’idée socialiste en soi. À l’origine de cette faillite, il y a le refus de comprendre que le non-capitalisme complet est une impossibilité en soi ». [19]
Richard Pipes et la propriété
On trouvera une explication de l’ « impossibilité intrinsèque » du socialisme dans Property and Freedom (Propriété et liberté), un livre écrit par le professeur Richard Pipes de l’Université de Harvard, le doyen des historiens antimarxistes américains de la guerre froide. Dans ce livre, Pipes donne un fondement zoologique à sa théorie de la propriété :
Une des constantes de la nature humaine, à l’épreuve des lois et de la manipulation pédagogique, c’est l’instinct de la possession. C’est un point commun à toutes les créatures, universel aux animaux et aux enfants aussi bien qu’aux adultes à chaque niveau de civilisation, ce qui explique que ce n’est pas un sujet de morale pertinent. Au niveau le plus fondamental, c’est l’expression de l’instinct de survie. Mais au-delà, il constitue une caractéristique de base de la personnalité humaine, pour qui les réussites et les acquisitions sont une sorte d’épanouissement personnel.
Et dès lors que l’épanouissement de la personne est l’essence de la liberté, celle-ci ne peut pas prospérer là où la propriété et l’inégalité qu’elle engendre sont éliminées de force. [20]
Les formes de la propriété et leur conceptualisation légale ont évolué historiquement. L’assimilation exclusive de la propriété à la propriété personnelle ne date que du 17e siècle. Au cours des périodes historiques précédentes, la propriété était conçue dans un sens beaucoup plus large et même communautaire. Pipes utilise une définition de la propriété qui est entrée en vigueur seulement lorsque les rapports de marché sont devenus prédominants dans la vie économique. La propriété s’entendit alors surtout comme le droit d’un individu « d’exclure les autres de l’utilisation ou de la jouissance de telle chose… ». [21]
Je crois qu’on ne s’avance pas trop en disant que cette forme de propriété, dont le rôle prédominant est une chose relativement récente dans le genre humain, est plus ou moins inconnue dans le reste du monde animal. En tout état de cause, pour ceux d’entre vous qui vous inquiétez de ce que deviendront vos iPods, maisons, voitures et autres objets précieux de propriété personnelle sous le socialisme, je puis vous assurer que la seule forme de propriété que le socialisme cherche à abolir est la propriété privée des moyens de production.
Le seul aspect positif des récents écrits du professeur Pipes – ceux publiés à la suite de la dissolution de l’URSS – est que le rapport entre ses œuvres tendancieuses précédentes sur l’histoire soviétique et son agenda politique de droite devient explicite. Pour Pipes, la révolution d’octobre et la création de l’Union soviétique ont représenté un assaut contre les prérogatives de la possession et de la propriété. C’était l’apogée d’un mouvement mondial de masse pour l’égalité sociale, ce terrible fruit des idéaux du Siècle des Lumières. Mais ce chapitre de l’histoire est maintenant terminé.
« Le droit de possession, proclame Pipes, doit être rétabli à sa juste place sur l’échelle des valeurs au lieu d’être sacrifié à l’idéal irréalisable de l’égalité sociale et d’une sécurité économique généralisée ». [22] Qu’entraînerait la restauration des droits de propriété demandée par Pipes ?
Le concept entier d’État-providence tel qu’il a évolué dans la deuxième moitié du vingtième siècle est incompatible avec la liberté individuelle. Abolir l’assistance publique avec ses divers « programmes » et « droits » fictifs et rendre à nouveau responsables de l’assistance sociale les familles et les œuvres caritatives privées qui en étaient chargées avant le vingtième siècle contribuerait grandement à résoudre cette impasse. [23]
Pour les élites au pouvoir, la fin de l’Union soviétique représente le début d’une restauration planétaire de l’ancien régime capitaliste et le rétablissement d’un ordre social où les droits de propriété, l’exploitation du travail et l’accumulation de richesse personnelle seront libérés de toute contrainte. Ce n’est aucunement une coïncidence que les presque quinze ans qui ont suivi la chute de l’URSS ont vu un accroissement ahurissant de l’inégalité sociale et une concentration de la richesse parmi le un pour cent (et surtout le 0,1 pour cent) le plus riche de la population mondiale. L’assaut mondial contre le marxisme et le socialisme est, en substance, le reflet idéologique de ce processus réactionnaire et historiquement rétrograde.
La démoralisation des intellectuels de la classe moyenne
Ce processus ne se manifeste pas seulement dans les diatribes antimarxistes de l’extrême droite. La décomposition intellectuelle de la société bourgeoise se montre aussi dans la capitulation démoralisée des restes de la gauche petite bourgeoise face à l’offensive idéologique de l’extrême droite. Les librairies du monde entier sont pleines de livres écrits par d’anciens radicaux repentants qui proclament à qui veut l’entendre le naufrage de leurs rêves et espoirs. Ils semblent éprouver une satisfaction perverse à clamer leur désespoir, leur découragement et leur impuissance. Ils ne se tiennent bien sûr pas responsables de leur échec. Non, ils ont été les victimes du marxisme qui leur a promis une révolution socialiste et n’a pas honoré sa promesse.
Les confessions faites dans ces mémoires ne sont pas seulement pitoyables, elles sont presque comiques. Voulant conférer à leurs catastrophes personnelles une sorte d’importance historique mondiale, leurs auteurs finissent par se rendre ridicules. Le professeur Ronald Aronson par exemple, un philosophe méconnu, commence son volume After Marxism (Après le marxisme) par ce chant funèbre existentialiste :
Le marxisme est mort et nous sommes seuls. Jusqu’à récemment, pour tant de ceux qui sont à gauche, être seul était une impensable affliction – une perte complète de repères, une condition d’orphelin. En tant que dernière génération du marxisme, nous avons la tâche historique et peu enviable de l’enterrer. [24]
Un thème ordinaire de ces candidatsfossoyeurs est que la dissolution de l’Union soviétique a ébranlé leur équilibre politique mais aussi affectif. Quelles qu’aient pu être leurs critiques politiques de la bureaucratie du Kremlin, ils n’avaient jamais cru que sa politique mènerait à la destruction de l’URSS ; autrement dit, ils n’avaient jamais accepté l’analyse de Trotsky de la nature contre-révolutionnaire du stalinisme. Aronson confesse ainsi que
L’immobilité et la lourdeur mêmes de l’Union soviétique comptaient pour quelque chose de positif dans notre espace psychique collectif et nous permettaient de garder vivant l’espoir qu’une réussite socialiste pourrait encore en sortir. Elles fournissaient une toile de fond sur laquelle on pouvait considérer et discuter des alternatives, y compris pour certains l’espoir qu’une autre version du marxisme demeurait viable. Mais plus maintenant. Nous aurons beau essayer de sauvegarder de la disparition du communisme ses possibilités théoriques, le grand projet historique et mondial de lutte et de transformation associé au nom de Karl Marx semble avoir pris fin.
Et comme le savent les postmodernistes, une vision entière du monde s’est effondrée en même temps que le marxisme. Non seulement les marxistes et les socialistes, mais d’autres radicaux ainsi que ceux qui se considéraient comme libéraux et progressistes, ont perdu leur orientation. [25]
Aronson révèle involontairement le petit secret sordide d’une si grande partie de la politique radicale d’après-guerre : l’étendue de sa dépendance des bureaucraties ouvrières réformistes et staliniennes. Cette dépendance avait une base sociale concrète dans les rapports politiques et de classe de la période d’après la Deuxième Guerre mondiale. Pour corriger les maux politiques et sociaux de leur propre milieu de classe, d’importantes parties de la petite bourgeoisie dépendaient des ressources dontdisposaient les puissantes bureaucraties ouvrières. Faisant partie de ces bureaucraties ou alliées à elles, les radicaux mécontents de la classe moyenne pouvaient menacer du poing la classe dirigeante et en obtenir des concessions. La chute de l’URSS, suivie presque sur-le-champ de la désintégration des organisations ouvrières réformistes du monde entier, priva les radicaux du patronage bureaucratique sur lequel ils s’appuyaient. Soudain, ces malheureux voyageurs de commerce de la politique radicale se retrouvaient seuls.
On tient plus ou moins pour acquis parmi ces tendances que le rôle historique attribué à la classe ouvrière par le marxisme classique était une erreur fatale. Ils sont tout au plus prêts à accepter qu’à un certain moment, dans le passé lointain, cela aurait pu être été justifié. Mais certainement pas maintenant. Aronson déclare :
Il y a en fait de nombreux indices pour soutenir la thèse que le projet marxiste a pris fin à cause des transformations structurelles du capitalisme et même de la classe ouvrière. La centralité de la catégorie fondamentale du marxisme, le travail, a été mise en question par l’évolution du capitalisme lui-même, de même que la primauté de la classe. [26]
Ceci est écrit alors que l’exploitation de la classe ouvrière progresse mondialement pour atteindre un niveau que ni Marx ni Engels n’aurait pu imaginer. Le processus d’extraction de la plus-value du travail humain a déjà été fortement intensifié par la révolution dans l’informatique et la technologie de communication. La campagne impitoyable et de plus en plus brutale menée pour abaisser les salaires, réduire et éliminer les prestations sociales et rationaliser la production, se poursuit avec férocité.
Mythes utopiques et irrationalisme
« Il n’y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir ». S’il n’existe aucune véritable force sociale capable de mener une lutte révolutionnaire contre le capitalisme, comment peut-on même concevoir une alternative à l’ordre existant ? Ce dilemme sous-tend une autre forme de pessimisme politique contemporain, l’utopisme. Cherchant à faire revivre les stades pré-marxistes et utopiques de la pensée socialiste, les néo-utopistes déplorent et dénoncent les efforts de Marx et d’Engels pour donner au socialisme un fondement scientifique.
Pour les néo-utopistes, le marxisme classique a trop fait sienne la préoccupation du dix-neuvième siècle avec la découverte de forces objectives. Cette conception sous-tendait la préoccupation du mouvement socialiste avec la classe ouvrière et son éducation politique. Selon les néo-utopistes, les marxistes accordent une confiance exagérée et imméritée à la force objective des contradictions capitalistes. De plus, ils ont sous-estimé le pouvoir et la force de persuasion de l’irrationnel.
Pour sortir de ce dilemme, il faut selon les néo-utopistes adopter et propager les « mythes » qui peuvent inspirer et stimuler. Que de tels mythes correspondent ou non à la réalité importe peu. Une figure centrale de cette création de mythes néo-utopique, Vincent Geoghegan, critique Marx et Engels pour avoir manqué « d’établir une psychologie. Ils n’ont laissé qu’un très mince héritage sur les complexités de la motivation humaine et la majorité de leurs successeurs immédiats n’ont pas ressenti le besoin de combler cette lacune ».[27] A la différence des socialistes, se lamente Geoghegan, ce fut l’extrême-droite, principalement les nazis, qui comprit la puissance des mythes et de leur imagerie.
Ce furent les nationaux-socialistes qui réussirent à créer la vision d’un Reich millénaire en se basant sur les concepts romantiques de chevaliers teutons, de rois saxons, et les instances mystérieuses « du sang ». La gauche n’a que trop souvent abandonné la partie, maugréant que la réaction appelle la réaction. [28]
Cet appel à l’irrationalisme avec ses implications politiques réactionnaires vient, par une sorte de logique perverse, du point de vue qu’il n’existe aucun fondement objectif pour la révolution socialiste. Ce qui manque dans ces jérémiades sur l’échec du marxisme et, bien sûr, de la classe ouvrière, c’est la moindre tentative de découvrir, à partir d’une étude précise des événements, des partis et des programmes, les causes des victoires et des défaites du mouvement révolutionnaire au 20e siècle. Dans son édition pour l’an 2000, le Socialist Register nous apprenait qu’il fallait « ajouter une nouvelle couche conceptuelle au marxisme, une dimension autrefois absente ou sous-développée ».[29] Voilà bien la dernière chose à faire. Ce qui est nécessaire au contraire, c’est d’appliquer la méthode matérialiste historique et dialectique à l’étude et à l’analyse du 20e siècle.
Le bilan de la IVe Internationale
Le Comité international de la IVe internationale n’a jamais nié que la dissolution de l’Union soviétique représentait une défaite majeure pour la classe ouvrière. Mais cet événement, le résultat de décennies de trahisons staliniennes, n’a invalidé ni la méthode marxiste ni la perspective du socialisme. Ni l’une ni l’autre ne sont en rien impliquées dans la chute de l’URSS. L’opposition marxiste à la bureaucratie stalinienne est née en 1923 avec la formation de l’Opposition de gauche. La décision de Trotsky de fonder la Quatrième Internationale, conjointement avec son appel à une révolution politique à l’intérieur de l’URSS, s’appuyait sur sa conclusion que la défense des avancées sociales de la révolution d’Octobre et la survie même de l’URSS en tant qu’État ouvrier dépendaient du renversement violent de la bureaucratie.
Le Comité international est sorti en 1953 de la lutte à l’intérieur de la IVe Internationale contre la tendance menée par Ernest Mandel et Michel Pablo, qui argumentait que la bureaucratie soviétique subissait, après la mort de Staline, un processus d’auto-réforme politique, un retour progressif aux principes du marxisme et du bolchévisme, qui invalidait l’appel lancé par Trotsky à une révolution politique.
L’histoire de la IVe Internationale et du Comité international témoigne de la perspicacité politique de l’analyse du stalinisme développée sur les bases de la méthode marxiste. Personne ne nous a démontré comment les crimes et les trahisons de la bureaucratie stalinienne avaient réfuté le marxisme. Un des représentants de la confrérie universitaire gauchisante nous dit :
Argumenter que l’effondrement du communisme organisé en tant que force politique et la destruction du socialisme en tant que société n’ont aucune importance pour la crédibilité du marxisme reviendrait à dire que la découverte des ossements du Christ dans un cimetière israélien, l’abdication du pape et la cessation du christianisme seraient sans incidence sur la cohérence intellectuelle de la théologie chrétienne. [30]
La métaphore est mal choisie, car les adversaires marxistes du stalinisme, c’est-à-dire les trotskystes, n’ont jamais considéré le Kremlin comme le Vatican du mouvement socialiste. La IVe Internationale n’a jamais, que je sache, adhéré au dogme de l’infaillibilité de Staline, bien qu’on ne puisse pas en dire autant des opposants radicaux et petits-bourgeois du mouvement trotskyste.
Les sceptiques sont difficiles à satisfaire. Même si le marxisme ne peut être tenu responsable des crimes de Staline, disent-ils, la dissolution de l’Union soviétique ne témoigne-t-elle pas de l’échec du projet socialiste révolutionnaire ? Cette question trahit l’absence 1) d’une large perspective historique, 2) d’une connaissance des contradictions et des réalisations et de la société soviétique et 3) d’une connaissance théoriquement fondée du contexte politique international dans lequel s’est déroulée la Révolution russe.
La révolution russe ne constitue elle-même qu’une étape dans la transition du capitalisme au socialisme. Quels précédents avons-nous qui indiqueraient le laps de temps approprié pour l’achèvement d’un si vaste projet historique ? Les bouleversements sociaux et politiques qui ont accompagné la transition d’une forme de société agraire et féodale vers une société industrielle et capitaliste ont duré plusieurs siècles. La dynamique du monde moderne – avec sa complexe et croissante interconnectivité économique, technologique et sociale – exclut une période si prolongée de transition du capitalisme au socialisme ; toutefois, l’analyse de processus historiques au cours desquels se produisent les transformations économiques les plus fondamentales, les plus complexes et les plus étendues, rend nécessaire l’étude d’un cadre temporel bien plus large que ceux utilisés pour l’étude d’événements ordinaires.
La durée de vie de l’Union soviétique n’a néanmoins pas été négligeable. Lorsque les bolchéviks prirent le pouvoir en 1917, peu d’observateurs hors de Russie pensaient que le nouveau régime durerait plus d’un mois. L’État qui émergea de la révolution d’Octobre dura soixante-quatorze ans, presque trois quarts de siècle. Le régime subit durant ce temps une terrible dégénérescence politique. Mais cette dégénérescence, qui a culminé avec la dissolution de l’Union soviétique par Gorbatchev et Eltsine en décembre 1991 ne signifie pas que la prise de pouvoir par Lénine et Trotsky en octobre 1917 était un projet futile et voué à l’échec. Déduire le chapitre final de l’Union soviétique directement de la prise de pouvoir bolchévique, sans tenir compte des nécessaires processus médiateurs, est une violation des lois historiques. Une étude sérieuse de l’histoire de l’URSS ne permet pas de confondre ainsi les événements. L’aboutissement de l’histoire soviétique n’était pas prédéterminé. Le développement de l’Union soviétique aurait pu prendre une autre direction. Les erreurs et les crimes de sa direction politique, concentrée sur la défense des intérêts de la caste bureaucratique parasitaire, ont joué un rôle décisif dans la destruction finale de l’URSS.
La dissolution de l’Union soviétique en 1991 n’invalide pas la signification historique de la révolution russe et de ses suites. Il s’agit du plus grand événement du 20e siècle, et elle fait partie des très grands événements de l’histoire mondiale. Son impact sur la vie de milliards de personnes – y compris sur la classe ouvrière américaine – fut immensément progressiste. Notre opposition au stalinisme n’est nullement affaiblie par la reconnaissance des réalisations socialescolossales de l’Union soviétique. En conséquence de la révolution, le pays a subi une transformation économique, sociale et culturelle sans précédent dans l’histoire de l’humanité. En outre, on ne saurait exagérer l’impact de la révolution d’octobre sur la conscience des nations opprimées du monde entier. Elle a été le point de départ de tous les mouvements révolutionnaires du 20e siècle.
L’Union soviétique n’était pas, nous insistons sur ce fait, une société socialiste. Le niveau de planification demeurait rudimentaire. Le programme de construction du socialisme dans un seul pays initié par Staline et Boukharine en 1924, projet sans fondement dans la théorie marxiste, répudia la perspective internationaliste qui avait inspiré la révolution d’octobre. L’Union soviétique représentait néanmoins la naissance d’une nouvelle formation sociale, édifiée sur la base d’une révolution ouvrière. Le potentiel de l’industrie nationalisée fut clairement démontré. L’Union soviétique ne pouvait échapper à l’héritage de l’arriération russe – pour ne pas parler de celle des républiques d’Asie Centrale – mais ses avancées dans le domaine de la science, de l’éducation, de l’assistance sociale et des arts sont réelles et importantes. Si les avertissements marxistes-trotskystes des implications catastrophiques du stalinisme semblaient si peu plausibles même à ceux qui, à gauche, étaient critiques du régime stalinien, c’est que les réalisations de la société soviétique étaient si substantielles.
La place de la révolution d’Octobre dans l’histoire mondiale
On ne peut comprendre la nature et l’importance de la révolution d’octobre que si on la replace dans le contexte politique mondial où elle s’est produite. Si la révolution d’octobre n’était qu’une aberration historique, il faudrait en dire autant de tout le 20e siècle. On ne peut nier la légitimité de la révolution d’Octobre que si on peut affirmer de façon plausible qu’il n’y avait, pour la prise de pouvoir bolchévique, aucun fondement substantiel dans les contradictions et courants profonds du capitalisme européen et international au début du vingtième siècle.
Mais une telle affirmation est réfutée par le fait que c’est la Première Guerre mondiale qui forme le cadre historique de la Révolution russe et de la prise de pouvoir bolchévique. Les deux événements sont inextricablement liés, non seulement dans le sens que la guerre a affaibli le régime tsariste et créé les conditions d’une révolution. La révolution d’Octobre était une manifestation différente de la même crise de l’ordre capitaliste international qui avait produit la guerre. Les contradictions de l’impérialisme mondial avaient porté le conflit entre l’économie internationale et le système capitaliste d’États-nations au point d’explosion en août 1914. Ces mêmes conditions étaient à la base du déclenchement de la Révolution russe. Les chefs de l’Europe bourgeoise avaient cherché à résoudre le chaos du capitalisme mondial d’une manière. Les dirigeants de la classe ouvrière révolutionnaire, les bolchéviks, en ont cherché une autre pour sortir du même chaos.
Pour éluder les implications historiques et politiques de ce lien plus profond entre la guerre mondiale et la révolution russe, les universitaires ont tendance à insister sur les aspects accidentels et contingents de la Première Guerre mondiale. Ils soutiennent que la guerre n’était pas inévitable en août 1914 et que la crise déchaînée par l’assassinat de l’archiduc Franz Ferdinand à Sarajevo aurait pu se résoudre pacifiquement. Ces arguments appellent deux observations.
D’abord, alors que d’autres solutions étaient envisageables, les gouvernements austro-hongrois, russe, allemand, français et enfin anglais choisirent consciemment et délibérément la guerre. Toutes ces puissances ne désiraient pas forcément la guerre, mais elles décidèrent toutes en fin de compte que la guerre était préférable à un accord négocié qui aurait pu compromettre certains de leurs intérêts stratégiques. Les dirigeants de l’Europe bourgeoise poursuivirent la guerre alors que son coût en vies humaines se chiffrait par millions. Jusqu’au déclenchement de la révolution sociale, d’abord en Russie puis en Allemagne, qui modifia les relations de classe et imposa la fin de la guerre, les puissances belligérantes n’entamèrent aucune négociation sérieuse pour rétablir la paix.
Ensuite, le déclenchement d’une guerre mondiale désastreuse avait longtemps été prédit par les dirigeants socialistes de la classe ouvrière. Dès les années 1880, Engels avait mis en garde contre une guerre où une bonne partie de l’Europe serait dévastée par la lutte des puissances capitalistes industrialisées. Une guerre, écrivait Engels à Adolf Sorge en janvier 1888, « entraînerait une dévastation à l’échelle de la Guerre de Trente Ans. Et rien ne pourrait être résolu rapidement, malgré les forces militaires colossales… Si la guerre était menée jusqu’au bout, sans désordres intérieurs, il s’en suivrait un épuisement tel que l’Europe n’en a pas vécu depuis deux cents ans ». [31]
Un an plus tard, en mars 1889, Engels écrivait à Lafargue que la guerre était
la plus terrible des éventualités.... Il y aura entre dix et quinze millions de combattants, une dévastation sans précédent rien que pour les nourrir, une répression universelle et forcée de notre mouvement, une recrudescence du chauvinisme dans tous les pays, et finalement un affaiblissement dix fois pire qu’avant 1815, une période de réaction basée sur l’inanition des peuples alors saignés à blanc – et avec cela un faible espoir que cette horrible guerre amènerait une révolution – cela me remplit d’horreur. [32]
Au cours des vingt-cinq ans qui suivirent, le mouvement européen socialiste plaça au centre de son agitation politique la lutte contre le capitalisme et le militarisme impérialiste. L’analyse faite du lien entre le militarisme, le capitalisme et l’impérialisme par les meilleurs théoriciens du mouvement socialiste et leurs innombrables avertissements qu’une guerre impérialiste était quasi inévitable réfutent l’affirmation que les événements d’août 1914 étaient accidentels, imprévus et indépendants des contradictions insolubles de l’ordre capitaliste mondial.
En mars 1913, moins de dix-huit mois avant le début de la guerre mondiale, l’analyse suivante fut faite des implications de la crise dans les Balkans :
[…] européen, déjà très instable, a été ébranlé. Il est difficile de prévoir si ceux qui ont entre les mains le destin de l’Europe décideront d’envenimer les choses et de déclencher une guerre dans toute l’Europe. [33]
L’auteur de ces lignes était Léon Trotsky.
Du caractère prétendument accidentel et contingent de la Première Guerre mondiale, les avocats universitaires du capitalisme déduisent la nature fortuite de tous les autres épisodes déplaisants de l’histoire du capitalisme au vingtième siècle : la Grande Dépression, la montée du fascisme et le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Il s’agissait d’erreurs de jugement, d’accidents imprévisibles, et de l’action de certains méchants. Comme nous le déclare François Furet, l’historien français récemment décédé :
L’intelligence de notre époque n’est possible que si nous nous libérons de l’illusion de la nécessité : le siècle n’est explicable, dans la mesure où il l’est, que si on lui rend son caractère imprévisible…
Furet déclare que « l’histoire de notre siècle, comme celle des précédents, eût pu se passer autrement : il suffit d’imaginer par exemple une année 1917 en Russie sans Lénine, ou une Allemagne de Weimar sans Hitler ».[34]
Dans la même veine, le professeur Henry Ashby Turner de l’université de Yale, écrit tout un livre pour démontrer que l’arrivée d’Hitler au pouvoir était largement accidentelle. Oui, il y avait bien certains problèmes durables de l’histoire allemande, pour ne pas parler de quelques événements malheureux tels que la Guerre mondiale, le Traité de Versailles, et la Dépression mondiale. Mais, fait plus important, « la chance – la plus capricieuse des contingences – était sans aucun doute du côté d’Hitler ». [35] Il y avait aussi « les affinités et aversions personnelles, les offenses, les amitiés perdues et le désir de revanche » qui ensemble ont influencé la politique allemande de façon imprévisible. Et oui, il y eut aussi « la rencontre fortuite entre Papen et le baron von Schröder au Club des seigneurs » qui tourna finalement à l’avantage d’Hitler. [36]
On se demande : si seulement von Papen avait attrapé un rhume et était resté au lit au lieu d’aller au Club des gentlemen, le cours du 20esiècle aurait peut-être été différent ! Il est également possible que nous devions tout le développement de la physique moderne à cette glorieuse pomme qui tomba par hasard sur la tête de Newton.
Si l’histoire n’est qu’un récit « conté par un idiot, plein de bruit et de fureur, qui ne signifie rien », à quoi bon l’étudier ? La solution aux problèmes du monde dans lequel nous vivons – problèmes qui menacent l’humanité de catastrophe – exige non seulement une connaissance exhaustive des faits historiques du 20e siècle, mais encore l’assimilation sérieuse des leçons enseignées par les nombreux événements tragiques vécus par la classe ouvrière au cours du siècle dernier.
A l’approche de l’an 2000, de nombreux volumes consacrés à l’étude du siècle finissant ont paru en librairie. L’appellation du « Court 20esiècle » gagna une certaine popularité comme caractérisation de cette période. Le terme fut répandu principalement par Eric Hobsbawm qui soutint que les caractéristiques ayant déterminé le vingtième siècle apparurent d’abord au commencement de la Première Guerre mondiale et disparurent avec la désintégration de l’URSS en 1991. Quelles qu’aient été les intentions de Hobsbawm, cette conception tendait à encourager l’argument que les événements décisifs du 20e siècle constituaient une déviation surréelle de l’histoire normale et non le résultat de contradictions sociales, économiques et politiques créées par le capitalisme.
Je rejette cette définition et crois que ce serait bien mieux de caractériser cette époque comme le siècle inachevé. Le calendrier nous dit bien sûr que le 20e siècle est terminé. Mais toutes les horreurs auxquelles la classe ouvrière fut confrontée au siècle dernier – la guerre, le fascisme, et même la possibilité de l’extinction de toute civilisation humaine – nous menacent encore aujourd’hui. Nous ne parlons pas, à la façon des existentialistes, de dangers et de dilemmes immanents à une nature inévitablement désespérée de la condition humaine. Non, nous parlons des contradictions du mode de production capitaliste que les plus grands révolutionnaires du 20e siècle – Lénine, Luxemburg et Trotsky – ont lutté pour comprendre à un stade bien plus précoce de leur développement. Ce qui n’a pu être résolu au siècle précédent doit l’être dans celui-ci. Il existe sinon un véritable danger que ce siècle soit le dernier de l’humanité. C’est pourquoi l’étude de l’histoire du 20e siècle et l’assimilation de ses leçons sont une question de vie ou de mort.
The USSR and Socialism : The Trotskyist Perspective (L’URSS et le socialisme : la perspective trotskyste), Detroit, Labour Publications, 1990, pp.1-2. Traduit de l’anglais.
Disponible sous : https ://www.wsws.org/en/articles/2005/06/stal-j02.html. Traduit de l’anglais.
Rosa Luxemburg, La crise de la social-démocratie : Brochure de Junius (Les Amis de Spartacus, Paris, 1993), p. 29.
Keith Jenkins, On « What is History ? : From Carr and Elton to Rorty and White (Routledge, London and New York, 1995), pp. 6-7. Traduit de l’anglais.
Ibid., p. 7-9.
Hayden V. White, The Content and the Form : Narrative Discourse and Historical Representation (John Hopkins University Press, Baltimore, 1990), p. 63. Traduit de l’anglais.
Jean-Paul Lyotard, Le postmoderne expliqué aux enfants : Correspondance 1982-1985 (Éditions Galilée, Paris, 1986), pp. 52-53.
Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande, (Éditions sociales, Paris, 1976), p. 11.
Richard Rorty, Truth and Progress (Cambridge : Cambridge University Press, 1998), p. 228. Traduit de l’anglais.
Ibid., p. 229.
Richard Rorty, Philosophy and Social Hope(Penguin, London and New York, 1999), p. 36. Traduit de l’anglais.
Cité dans Jenkins, p. 105. Traduit de l’anglais
Truth and Progress, p. 233.
Ibid., p. 229.
Brian S. Turner, Préface, dans : Karl Löwith, Max Weber and Karl Marx, (Routledge, London and New York, 1993), p. 5. Traduit de l’anglais.
Eric J. Hobsbawm, Franc-tireur : autobiographie (Ramsay, Paris, 2005), p. 157.
Robert Conquest, Le féroce XXe siècle : Réflexions sur les ravages des idéologies (Éditions des Syrtes, Paris, 2001), p. 19.
Andrzej Walicki, Marxism and the Leap to the Kingdom of Freedom : The Rise and Fall of the Communist Utopia(Stanford University Press, Stanford, California, 1995), p. 278. Traduit de l’anglais.
Martin E. Malia, La Tragédie soviétique : Histoire du socialisme en Russie, 1917-1991 (Éditions du Seuil, Paris, 1995), p. 302.
Richard Pipes, Property and Freedom (Alfred A. Knopf, New York, 1999), p. 286. Traduit de l’anglais.
C.B. Macpherson, The Rise and Fall of Economic Justice and Other Essays (Oxford University Press, Oxford, 1987), p. 77. Traduit de l’anglais.
Property and Freedom, p. 287. Traduit de l’anglais.
Ibid., p. 284.
Ronald Aronson, After Marxism (Guilford Press, New York, 1995), p. 1. Traduit de l’anglais.
Ibid., pp. vii-viii.
Ibid. p. 56.
Vincent Geoghegan, Utopianism and Marxism(Methuen, London and New York, 1987), p. 68. Traduit de l’anglais.
Ibid., p.72.
Leo Panitch et Sam Gindin, Necessary and Unnecessary Utopias : Socialist Register 2000 (Merlin Press, Suffolk, 1999), « Transcending Pessimism : Rekindling Socialist Imagination », p. 22. Traduit de l’anglais.
Turner, dans : Max Weber and Karl Marx, p. 5. Depuis que Mr. Turner a écrit ce passage, un pape en exercice – Benoît XVI – a abdiqué, sans effet notable, positif ou négatif, sur la « cohérence intellectuelle de la théologie chrétienne ».
Friedrich Engels, « Lettre à Friedrich Adolph Sorge, 7 Janvier 1888 » dans : Marx-Engels Werke : Band 37(Dietz Verlag, Berlin, 1967), p. 11. Traduit de l’allemand.
Ibid., p. 171.
Léon Trotsky, Les Guerres balkaniques 1912-1913 (Éditions Science marxiste, Paris, 2002), pp. 63-64.
François Furet, Le passé d’une illusion : essai sur l’idée communiste au XXe siècle (Éditions Robert Laffont, Paris, 2003), p. 16)
Henry Ashby Turner, Hitler, janvier 1933 : Les trente jours qui ébranlèrent le monde (Éditions Calmann-Lévy, Paris, 1997), p. 222.
Ibid.