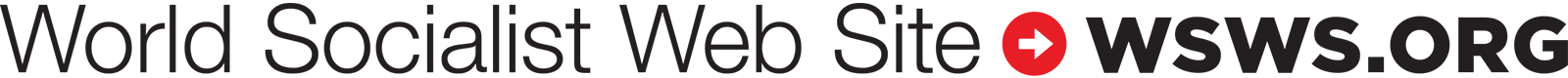Une semaine après que le président américain Trump a lancé sa guerre économique contre le monde sous la bannière des soi-disant « tarifs réciproques », la Chine s’est vu imposer un tarif de 104 pour cent sur ses marchandises à partir de mercredi.
Cette décision fait suite à la décision de Trump d'imposer à la Chine un tarif supplémentaire de 50 pour cent, suite à l'imposition d'un tarif par cette dernière de 34 pour cent sur les produits américains en réponse à la décision américaine d'imposer des tarifs de 54 pour cent la semaine dernière.
Lorsque l’on prend en compte les tarifs précédents, imposés d’abord par la première administration Trump et puis maintenus par le président Biden, l’ensemble des droits de douane imposés la Chine s’élève actuellement à environ 120 pour cent. Un niveau jamais vu auparavant.
Les dernières mesures ont suscité une forte résistance de la part de Pékin.
Un porte-parole du ministère du Commerce a déclaré :
Si les États-Unis continuent de mettre en œuvre ces mesures tarifaires renforcées, la Chine prendra résolument des contre-mesures pour protéger ses propres droits et intérêts.
Si les États-Unis persistent à suivre leur propre voie, la Chine se battra jusqu’au bout.
Alors que d'autres pays cherchent à dialoguer et à négocier, Pékin se prépare à une bataille majeure. Le conflit généralisé entre les deux premières économies mondiales aura des répercussions mondiales, et les conséquences seront sévères pour tous les pays, encore plus importantes qu'elles ne l'ont déjà été jusqu’à maintenant.
Le responsable du ministère a déclaré que l'escalade des tarifs était
une erreur aggravée par une autre, qui révèle une fois de plus la nature coercitive des États-Unis. La Chine n'acceptera jamais cela.
La guerre économique contre la Chine implique les pays d'Asie du Sud-Est, qui ont été frappés par certains des tarifs douaniers les plus élevés, notamment la Malaisie à 24 pour cent, le Vietnam à 46 pour cent, le Cambodge à 49 pour cent, l'Indonésie à 32 pour cent et la Thaïlande à 37 pour cent. Ces tarifs menacent de dévaster leur économie.
L'objectif de ces mesures n'est pas d'égaliser ou d'équilibrer les échanges commerciaux entre les États-Unis et ces pays. Même les responsables de l'administration Trump, dans leurs moments les plus déments, n'y croient pas, car les pays concernés sont loin d’avoir les moyens économiques nécessaires.
Les hausses de tarifs douaniers contre la région servent deux objectifs : l’un économique et l’autre géopolitique.
Suite à la première vague de hausses de droits de douane imposées par Trump à la Chine lors de son premier mandat, de nombreuses entreprises ont délocalisé certaines de leurs activités destinées au marché américain vers la région, dans le cadre d'une stratégie baptisée « Chine plus un », afin d'éviter les droits de douane. Cette option est désormais fermée.
Les objectifs géopolitiques sont le résultat d’une situation qui évolue depuis quinze ans.
Depuis que le président Obama a lancé son « pivot vers l’Asie » anti-Chine en 2011, annoncé devant le parlement australien, de nombreux pays de la région cherchent à maintenir un équilibre entre la Chine, à laquelle ils sont profondément liés économiquement, et les États-Unis.
La guerre tarifaire de Trump contre eux est une déclaration que l'époque de telles manœuvres est révolue. Ils doivent en finir avec leur neutralité et se ranger derrière les États-Unis dans leur offensive militaire toujours plus intense contre Pékin, sous peine d'être durement touchés.
Il est fort possible que des négociations soient menées avec eux au sujet des droits de douane. Mais ces discussions ne se limiteront pas à des aspects économiques, car, comme l'a déclaré le régime Trump, toute baisse des droits de douane exigerait que les pays, au premier rang desquels figure la Chine, « s'alignent sur les États-Unis en matière d'économie et de sécurité nationale ».
Alors que Trump déclare la guerre au monde, les répercussions sont importantes, tant sur l’économie réelle que sur le fragile système financier américain.
Jusqu’à présent, les hausses de tarifs douaniers ont porté un coup dur aux consommateurs, qui achètent une vaste gamme de biens d’une valeur de plusieurs milliards de dollars provenant de Chine, ainsi qu’aux entreprises qui dépendent des importations en provenance de Chine et de nombreux autres pays du monde entier pour leurs processus de production.
Près de la moitié des importations américaines sont des biens intermédiaires utilisés par les entreprises américaines pour achever le produit final. Par le passé, les droits de douane frappaient les produits finis importés. Mais cette époque est révolue avec le développement de la production mondialisée au cours des quatre dernières décennies.
La structure des coûts des entreprises américaines, grandes et petites, a été amplifiée à tel point que pour contrer cet effet de la seule manière possible dans le système capitaliste, elles doivent mettre en place des programmes de réduction des coûts par le biais de licenciements, tout en intensifiant l'exploitation de ceux qui restent afin de maintenir leurs profits. Ce processus a déjà commencé, avec des licenciements induits par les droits de douane.
Jusqu'à présent, l'effet le plus palpable de la guerre tarifaire s'est fait sentir sur les marchés financiers. Wall Street a connu jeudi et vendredi derniers sa quatrième plus forte baisse de l'après-guerre, avec des milliers de milliards de dollars de perte de capitalisation boursière.
Après une journée de transactions mouvementées lundi, le marché s'est finalement stabilisé avec de très faibles pertes.
Mais la chute s'est poursuivie mardi. L'indice S&P 500 a chuté de 1,6 pour cent, tandis que le NASDAQ a perdu 2 pour cent.
Les fortes chutes du marché ont donné lieu à une altercation entre deux figures clés de l'entourage de Trump : Elon Musk, le milliardaire à la tête du DOGE, et Peter Navarro, conseiller principal pour le commerce et l'industrie, le principal faucon anti-Chine.
Mardi matin, Musk a traité Navarro d’« idiot » et de « parfait imbécile », après que Navarro a déclaré dans une interview télévisée que Musk n'était qu'un « assembleur de voitures » et que dans son opposition au nouveau régime tarifaire, il « protégeait ses propres intérêts ».
L'attaque d'Elon Musk exprime l'opposition de certains milieux de l'oligarchie financière, qui craignent que les mesures de Trump ne tuent la poule aux œufs d'or. Leurs immenses fortunes ne sont pas le fruit de l'autarcie et de l'isolement des États-Unis par rapport à l'économie mondiale, mais de l'exploitation de la mondialisation à leur avantage.
Et un facteur important dans l’accumulation de leur richesse a été la suprématie du dollar, qui a permis aux États-Unis d’accumuler des dettes à des niveaux historiquement sans précédent, permettant l’accumulation de vastes fortunes par le biais du parasitisme et de la spéculation.
Mais l’isolationnisme économique prôné par Trump, dans lequel Navarro joue un rôle de premier plan, remet en question le rôle mondial du dollar.
Outre la chute des marchés qui se poursuit, un nouveau développement très significatif indique qu’une nouvelle crise financière pourrait être en préparation.
La première réaction aux hausses de droits de douane a été une baisse du rendement des obligations du Trésor, conséquence des achats des investisseurs en quête de refuge, craignant que les mesures de Trump ne provoquent une récession. [Le prix des obligations et leur rendement sont inversement proportionnels : plus la demande augmente, plus leur rendement diminue.]
Mais lundi et mardi encore, la tendance a pris l'autre direction. Lundi, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a bondi de 0,19 point de pourcentage, soit la plus forte hausse journalière depuis le 22 septembre. Mardi, dans un contexte d'enchères qualifiées de «faibles » pour l'achat de 58 milliards de dollars de nouvelles dettes publiques, le rendement a encore augmenté de 0,11 point de pourcentage.
Dans un marché où les variations, à la hausse comme à la baisse, sont généralement très faibles, une hausse totale de 0,3 pour cent est considérée comme importante.
Selon le Financial Times :
La baisse considérable de mardi est le dernier signe de la façon dont certains investisseurs abandonnent même des actifs à très faible risque alors que […] les tarifs douaniers de Trump sur ses principaux partenaires commerciaux provoquent une intense volatilité sur les marchés.
L'un des moteurs de cette baisse est la multiplication des appels de marge effectués par les banques, qui financent les fonds spéculatifs et autres opérateurs de marché. En échange de crédits, elles exigent un dépôt de liquidités. Mais face à la chute rapide de la valeur des actifs détenus par ces fonds, les banques lancent une demande, un appel de marge, pour que davantage d'argent soit placé chez elles.
Vendredi dernier, il a été rapporté que certains fonds spéculatifs avaient été frappés par les appels de marge les plus importants depuis le début de la pandémie en 2020. Cela a provoqué une ruée vers les liquidités, les fonds spéculatifs versant de l'argent aux banques afin de maintenir leurs lignes de crédit, dont ils dépendent.
Le danger est que, les fonds spéculatifs fonctionnant avec des modèles économiques très similaires et face à la chute généralisée des cours des actions et des autres actifs financiers, la ruée vers les liquidités puisse conduire à une immense liquidation et déclencher une crise financière.
L’oligarchie financière prend clairement très au sérieux la crise qui s’aggrave.
La classe ouvrière doit faire de même. D'autant plus que, contrairement aux élites dirigeantes qui développeront des mesures pour se protéger, elle ne dispose d'aucun mécanisme de « sauvetage » au sein du système capitaliste.
Il lui faut donc faire une évaluation objective de la situation et, sur cette base, élaborer la stratégie politique nécessaire pour lutter pour ses intérêts indépendants.
Cette évaluation doit commencer par la compréhension que la « folie » actuelle n'est pas le fruit du cerveau enfiévré de Trump. Il n'est que l'expression la plus flagrante de la profonde folie du système capitaliste qu'il représente.
Cette folie – les guerres commerciales et économiques destructrices, le danger croissant d’une troisième guerre mondiale, la menace omniprésente d’une crise financière dévastatrice, la perspective d’une dépression et une liste interminable d’autres maux et dangers dans des conditions où les ressources matérielles et la productivité accrue du travail ont créé les conditions pour le progrès de l’humanité – signifie que le système capitaliste est devenu historiquement dépassé et doit être renversé.
Les dieux rendent fous ceux qu'ils veulent perdre, a-t-on dit.
Mais le système capitaliste ne sera pas renversé automatiquement. Il ne prendra fin qu’à travers l’intervention consciente de la lutte politique de la classe ouvrière pour le socialisme international.
(Article paru en anglais le 9 avril 2025)